
La question est assez simple, et en même temps gênante. Comment rendre compte d’un spectacle qui défie toute exégèse, fascinant par les images qu’il laisse imprimées, fascinant par l’ambiance qu’il crée.
A‑t‑on vraiment envie de se lancer dans une analyse de toutes les idées, de tous les symboles, alors qu’au-delà de l’analyse, il y a simplement l’incroyable magnétisme de cette production. À l’inverse de la production de Krzysztof Warlikowski en début d’été à Munich, qui nécessite l’exégèse pour en comprendre les choix dramaturgiques et surtout celui très discuté de la protagoniste, l’impression laissée au contraire par le spectacle de Castellucci, très complexe, où chaque image est motivée ou chaque geste fait sens, c’est qu’il se suffit à lui-même, qu'il suffit tel quel au spectateur, complètement magnétisé et sonné à la fin du spectacle.
Un seul point doit faire l’unanimité, il s’agit d’un des spectacles les plus puissants du metteur en scène italien, et surtout, avec le parti pris musical de Franz Welser-Möst, l’un des plus complets, car fosse et scène se répondent en écho et en contraste. On a besoin de ce torrent musical pour vivre pleinement, intensément, émotionnellement, le parti pris scénique glacé et fulgurant de Castellucci.
Il faut le souligner d’emblée, ce spectacle est une sorte d’expérience de l’extrême, inoubliable.
Ce spectacle est une reprise. Et une reprise, c’est avoir en face des artistes (c’est exactement la même distribution qu’en 2018) qui après un an, ont renfilé leurs habits, et leurs habitudes : on a à faire à une troupe, rompue à un exercice, et donc complètement habitée.

C’est d’abord une expérience visuelle que de considérer la Felsenreitschule, merveilleuse et unique pour les arcades percées dans le conglomérat. et ces arcades pour l’occasion sont obturées, constituant un mur lisse et glacial, pendant que le sol est un miroir doré, et que le toit est discrètement ouvert sur le jour qui s’éteint. Nous sommes au fond d’une fosse, au bas d’un mur, dans un monde sans issue, à la lumière merveilleusement sculptée par Castellucci lui-même qui signe aussi mise en scène, décor et costumes. Et les 1237 spectateurs sont comme bloqués, prisonniers par cet espace, fascinant par sa clôture même. D’où le silence très pesant qui accompagne la pantomime initiale, à la lumière pâle du jour qui finit dans l’ouverture entrebâillée du toit, et du son obsessionnel des grillons, qui renvoient à la chaleur d’un Orient rêvé.
La pierre, affirmée dès le départ à la fois dans le nom du lieu FELSENreitschule (manège des rochers) et sur le rideau de scène avec cette citation du fronton des deux entrées du tout proche tunnel du Mönschberg, percé au XVIIIe « Te saxa loquuntur » (les pierres parlent de toi), « Te » visant le spectateur, c’est à dire l’homme en général, mais ce « Te » est agressivement adressé à ce public qui attend le spectacle, un avertissement qui sonne comme un de ces avertissements inscrits au-dessus des portes de lieux consacrés ((On pense irrésistiblement à l'avertissement à la Porte de l'Enfer de Dante : lasciate ogne speranza, voi ch'intrate/ Vous qui entrez, abandonnez toute espérance)) et qui le prend évidemment pour lui, entouré, prisonnier de la pierre glaciale qui délimite l’espace. La pierre qui tout on long du spectacle va faire apparaître des ombres gigantesques, de la lune d’abord dont il est tant question dans le texte dès le début, et puis l’ombre portée de Jochanaan, comme métaphore de cette voix d’outre-tombe qui résonne, autant que l’ombre portée grandit.
Ce « Te » initial implique le public : on va donc parler de ce « Te » qui est moi, et va m’impliquer dans ce que je vais voir comme image de mes fantasmes ou de mes rêves, ou de mes visions. Ce « te » tue toute distanciation, le spectacle va nous envelopper, nous impliquer, nous prendre, nous sonner.
La question de la matière brute ou polie est aussi prégnante, de ce monde minéral initial qui est conglomérat, c’est à dire diversité, émerge aussi un métal, l’Or, symbole d’unicité, de pureté et de propreté, presque immaculée, présent dans des objets divers, coupes géantes, trône, cercles que des géomètres semblent vouloir utiliser. Il contraste par ses reflets et par sa profondeur même avec ce mur sans reflets et sans issue. ce mur fait de cette matière brute qui servit à construire la cathédrale, la Felsenreitschule étant initialement une immense latomie. D’où évidemment le lien entre le lieu qui servit à construire une cathédrale, devenu aujourd’hui le lieu de représentation d’une histoire marginale des Écritures. Le Christianisme, dans sa glorification et ses scories…
Au fond de cette fosse où nous nous trouvons va bientôt s'ouvrir une autre fosse, celle de Jochanaan, un trou parfaitement circulaire dans le sol qui répond à la lune parfaitement ronde dont l’ombre occupe le mur, un trou sombre et aussi noir que cette lune, ce noir tranchant avec l’or du sol, ce noir d’où va émerger l’étalon noir, ce noir d’où on entend une voix lointaine, terrible. Ce noir où la lune n’est qu’un soleil noir « Cet affreux soleil noir d’où rayonne la nuit »((Victor Hugo, Les Contemplations, Ce que dit la bouche d’Ombre)). D’ailleurs, les vers de Victor Hugo traduisent de manière exacte l’impression qui va se dégager :
Hommes, plus bas que vous, dans le nadir livide,
Dans cette plénitude horrible qu’on croit vide,
Le mal, qui par la chair, hélas ! vous asservit,
Dégorge une vapeur monstrueuse qui vit !
Là sombre et s’engloutit, dans des flots de désastres,
L’hydre Univers tordant son corps écaillé d’astres ;
Là, tout flotte et s’en va dans un naufrage obscur ;
Dans ce gouffre sans bord, sans soupirail, sans mur,
De tout ce qui vécut pleut sans cesse la cendre ;
Et l’on voit tout au fond, quand l’œil ose y descendre,
Au-delà de la vie, et du souffle et du bruit,
Un affreux soleil noir d’où rayonne la nuit !

Au milieu de ce monde glacial et pétrifié, on verra les hommes bien sûr, tous habillés pareil, comme interchangeables, vêtus de noir aux barbes peintes en rouge sang, en redingote avec chapeau, comme quelque personnage kafkaïen d’un labyrinthe mental inextricable, (tandis qu’Hérodias se distingue par son visage peint en vert) et puis va apparaître cette minuscule tache blanche qu’est Salomé, toute faiblesse et fragilité. Ombre contre lumière, noirceur anonyme contre blancheur clairement identifiable, une petite lumière comme une petite flamme, vivante, remuante. Salomé se définit d’abord ici par sa taille, menue, presque écrasée par le mur, par la pierre, par les ombres, puis par la présence et l'ombre de Jochanaan.

Qu’il reste des points obscurs dans ce travail c’est d’autant plus stimulant et laisse de l’espace à une réflexion future : qu’en est-il par exemple de cette inscription Ιω πρό ? qui se réduit à la fin en ω, comme ci cette dernière lettre de l’alphabet grec désignait une fin (Salomé de l’alpha à l’oméga..), mais comme si Ιω (étrangement sans accent) renvoyait à la légende grecque où la femme, transformée en génisse était souvent assimilée à la lune ? Et ce πρό qui signifie aussi bien « en avant » qu’« auparavant », comme si le temps était vu ici dans ses origines comme son futur…à suivre…
Écrasée, mais incroyablement puissante. Asmik Grigorian a cette capacité à être répulsive par ce désir débordant, mais adolescente par l’aspect, presque la Salomé décrite par Flaubert dans Hérodias… « Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite », un être qui au contraire des autres, des comparses en quelque sorte, est immédiatement identifiable : qui peut identifier Narraboth au milieu des autres ou même Hérode, s’il ne s’asseyait pas sur son trône ? Salomé elle, est de suite définie, d'abord par son digne costume blanc, puis dans une nuisette tout aussi immaculée : elle est visuellement définie, mais pas psychologiquement : car elle est tout et son contraire, innocente et coupable, monstre naissant et enfant, aimable et maudite.

Émergeant de la fosse, Jochanaan est un être tout noir, qui se définit dans l’opéra d’abord par une voix venue d’outre-tombe, mais émergeant de la même fosse, un cheval noir qui tourne, dont on ne voit que la tête, une tête qu’on retrouvera coupée, nageant dans une mare de lait à la fin de l’opéra…Le cheval qui fait partie de la mythologie de Castellucci, est ici vivant, racé, comme représentant de l’intégralité/intégrité du monde, au milieu de toute cette pierre, de toute cette nuit, de tout ce noir, la vie, irréductible, animale, puissante.
Des images brutes, immenses comme l’ombre portée de Jochanaan écrasant tout, gigantesque : ici Jochanaan n’est pas un personnage, il n’est que cette ombre, à la limite du réel qui volens nolens nous paralyse, nous fascine, nous laisse interdits.
À cette écrasante présence visuelle répond une écrasante présence sonore ; nous sommes écrasés d’image et de son, un son phénoménal dont les Wiener Philharmoniker ont le secret quand ils le veulent, avec une précision redoutable, tranchant comme une lame, une symphonie de couleurs qui répond aux rares couleurs de la scène. Welser-Möst donne ici sans doute l’une de ses plus magnifiques prestations, à des années lumières de l’approche aussi passionnante de Petrenko, qui exaltait presque une suavité, une douceur de l’œuvre. Rien de cela ici, mais un sentiment d’écrasement, qui va aller croissant.
Salomé, c’est une blancheur immaculée qui est image de l’innocence… Pas tout à fait immaculée puisque dans son dos une tache de sang (visiblement menstruel) minuscule, et qu’elle ne peut voir, sur son habit blanc trahit la perte de l’innocence, l’entrée dans le monde du désir. Salomé arrive en scène comme immaculée, mais en réalité déjà « maculée » à son insu, presque déjà impure.
Cette pureté perdue, elle se retrouve dans les scènes finales, où Salomé n’embrasse pas la tête de Jochanaan, mais embrasse le vide d’un corps sans tête, qu’on lui a apporté : l’objet du désir est celui qui échappe en permanence, celui qui n’est jamais satisfait, elle n’aura donc pas la satisfaction de baiser la tête, elle embrassera le vide : la seule tête présente, celle de l’étalon dont il était question plus haut, est une tête-métaphore. En l’absence de l’objet, on cherche des substituts.

Mais dans ce cercle qui contient et la tête de l’étalon et le corps sans tête, on a versé du lait, du lait symbole de vie, de maternité, de nourriture, et aussi de pureté. Le lait immaculé, que Salomé piétine comme replongeant dans une sorte d’innocence nourricière, peut-être le lait de la vache Iô/Ιω ou le lait maternel (Herodias s'en approche…). Cette flaque de lait, aussi blanche que la lune omniprésente est noire, où repose la tête du cheval et le corps sans tête de Jochanaan sur lequel Salomé va placer la tête de cheval, claire indication de la présence du cheval comme substitut du Baptiste, devient une sorte de dernier champ clos des désirs.
Jochanaan de son côté est vu comme une sorte d’être presque animal (ce n’est pas un hasard si Castellucci utilise un étalon noir comme métaphore du Baptiste) qui domine monstrueusement la frêle (?) Salomé, couvert de noir, peint en noir, habillé en noir, dont l’ombre portée sur le mur fait penser à celle gigantesque de la lune, comme si la jeune fille était entourée de forces obscures qui en déterminaient le destin. Sa présence dans la fosse, un trou noir dans le sol doré, crée ce motif qui va nous conduire à la mort de Salomé, engloutie dans la fosse elle aussi, qui chante les derniers vers comme noyée, comme rejoignant dans le trou Jochanaan, une sorte de Senta s’engloutissant dans les flots. Cette image d’une rare puissance est peut-être celle qui reste, accompagnée par le déchaînement musical orchestré par Franz Welser-Möst.
En effet, Franz Welser-Möst refuse dans sa direction tout ce qui pourrait ressembler à de la complaisance, ou de la tendresse : son travail est coupant, sans bavure, collant parfaitement à la monumentalité granitique de la mise en scène et du décor. Mais il n’est pas monotlithique : il sait moduler, calculer les crescendos, modérer le volume ou en calculer avec soin des effets et l’intensité. Une interprétation glaciale, hypercontrôlée où les Wiener Philharmoniker, dans leur élément, presque dans leur ADN, montrent une richesse de timbres, une luxuriance, une symphonie des couleurs dont on avait presque oublié qu’ils étaient capables. Les bois sont sublimes, notamment la clarinette (initiale) et le basson, les cuivres sans aucune scorie (ce qui n’est pas toujours le cas). Ici Franz Welser-Möst fait de l’orchestre un protagoniste essentiel, engagé, en cohérence avec la vision du metteur en scène. L’intensité de la direction est telle qu’elle éclaire le travail scénique et multiplie le potentiel visuel de la production. La clarté de l’approche et la limpidité de la lecture laissent entendre chaque détail, aussi bien le lyrisme post romantique que les sons d'une modernité plus acérée. Il en résulte une des lectures les plus convaincantes qu’il nous ait été donné d’entendre du drame musical de Strauss.
Mais il est aussi soutenu par une distribution incroyablement engagée, particulièrement préparée et convaincue, et totalement convaincante. Une distribution qui dans son ensemble avec une diction exemplaire (essentiel pour faire ressortir le drame de Wilde) a poli la partition, dans ses moindres recoins et ses moindres inflexions, aussi bien les rôles de complément comme les Juifs (Matthäus Schmidlechner, Mathias Frey, Kristofer Lundin, Joshua Whitener, David Steffens) les nazaréens (Tilmann Rönnebeck, Pawel Trojak) les soldats (Peter Kellner, Dashon Burton), que le page de Christina Bock, sonore et juvénile.

Le Narraboth à la fois lyrique et presque extrême de Julien Prégardien, au beau timbre, a des couleurs déchirantes, alors qu’aussi bien Anna Maria Chiuri (Herodias affirmée) que John Daszak, Hérode un peu plus pâle qu’attendu, sont presque étouffés par la mise en scène qui les laisse dans un relatif anonymat, et finit par les engloutir dans cette immense lune en forme de ballon de l’image finale, comme engloutis par un trou noir, sans qu’ils n’en puissent mais.

Tout le monde est anonyme face aux deux protagonistes, le Jochanaan de Gabor Bretz, plus impressionnant scéniquement que vocalement, dans son costume mi-homme, mi chamane, une vision animale que la voix plutôt douce, et souvent couverte, notamment lorsqu’il chante de la fosse semble contredire. Ce chanteur nous avait naguère plus impressionné et la voix semble manquer de profondeur ou de projection, même si la prestation reste respectable.
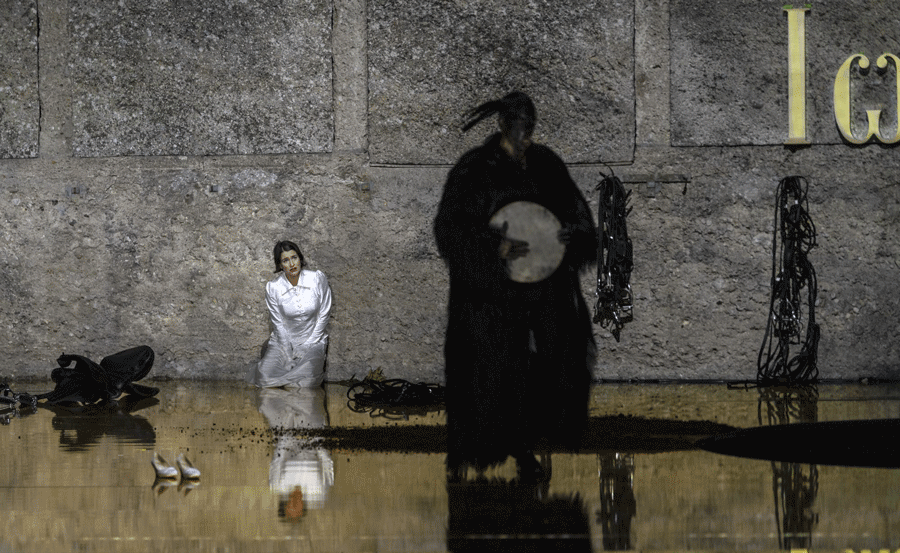
À l’inverse, la frêle Asmik Grigorian emplit à elle seule, vocalement et physiquement, le vaste plateau de la Felsenreitschule. Elle y est simplement stupéfiante, voire unique.
Stupéfiante parce qu’elle exprime tout à la fois l’innocence et la rouerie, le désir naissant, indompté et presque naïf, avec des gestes sensuels à son insu. Elle est tour à tour vierge (ou jeune mariée) offerte à Jochanaan, elle cherche désespérément une bouche qui lui restera à jamais inaccessible, parce que Castellucci évite de lui faire faire tout ce qu’on voit habituellement, aussi bien la danse des sept voiles, sorte de symbole de l’érotisme décadent fin XIXe, et le baiser à la tête de Jochanaan sur un plateau d’argent.
A la place de la danse, lovée sur le trône d’Hérode à la manière fœtale, elle reste fixe, comme offerte et engloutie par une pierre qui tombe des cintres, comme Hérode et Hérodias le seront par la lune, comme elle même s’engloutira, se noiera dans la fosse. Elle devient presque matière, en s’y fondant.
Le final est la recherche désespérée du baiser, là où lui est livré non la tête mais le corps du prophète, et la recherche de l’objet de désir devient une sorte de recherche désespérée du vide, qui renvoie évidemment aux replis psychanalytiques du mythe.
Asmik Grigorian est tout cela, elle est jeune femme, elle est enfant (Castellucci montre aussi Salomé, encore plus écrasée et presque dépassée, dans un corps de petite fille), elle est à la fois innocente et diabolique, consciente et inconsciente, et scandaleusement offerte. Et vocalement, ce corps menu projette une voix au volume impressionnant, à la diction impeccable, à la projection incroyable, une ligne de chant jamais prise en défaut, avec une expressivité stupéfiante : il faut l’entendre séduire d’une manière si enfantine Narraboth, il faut l’entendre au contraire ce corps tendu très adulte cherchant le corps du prophète.
La Salomé d’Asmik Grigorian est le jour et la nuit, la lumière et l’obscurité, la pureté et la souillure, elle est une totalité, la totalité du personnage voulu par Castellucci et peut-être Strauss, et son volume vocal dépasse largement le flot sonore émergeant de l’orchestre. Une création, incroyable. Sans doute d'autres théâtres lui réclameront Salomé, mais elle est pour moi comme une prêtresse dédiée à cette mise en scène, comme liée par le sang et la sève. Unique.
Pourra-t-on s’étonner que le mensuel allemand Opernwelt ait à peine élu Asmik Grigorian chanteuse de l’année et cette production de Salomé production d’opéra de l’année ?

