
Pier Luigi Pizzi, magicien de la scénographie
La génération actuelle d’amateurs d’opéra peut sans doute difficilement comprendre ce que peut représenter pour le théâtre en Italie, mais aussi ailleurs, Pier Luigi Pizzi. Rien qu’en France, on a vu notamment outre sa fameuse Semiramide, Les Troyens qui ont ouvert l’Opéra-Bastille et bien d'autres opéras . Rien qu’à l’Opéra de Paris on lui doit neuf productions et dix scénographies.
Si ce n’est pas un metteur en scène révolutionnaire, c’est par le décor et un sens inné de l’esthétique et des contrastes de couleurs, mais aussi par les costumes qu’il laissera une trace profonde dans l’histoire du spectacle en Italie et ailleurs.
Pizzi est en effet d’abord un génial décorateur. C’est à lui qu’on doit les sublimes décors du Ring de Luca Ronconi à la Scala en 1974 et 1975, et poursuivi à Florence en 1979 et 1981. C’est aussi à lui qu’on doit les premières grandes productions de répertoire baroque, Orlando de Haendel (avec Horne), Ariodante du même Haendel, Alceste de Gluck, Hippolyte et Aricie de Rameau, dans les années 80 où l’on découvrait ce répertoire.
Pizzi est un compagnon de route du Festival de Pesaro, et pourtant, comme signalé en introduction, il n’avait jamais mis en scène Il Barbier di Siviglia, ni à Pesaro ni ailleurs. Comment s’étonner alors qu’on lui ait demandé cette nouvelle production ? Ce qui est plus étonnant, c’est qu’il ait réussi encore à surprendre, et à faire de cette production le phare inattendu de l'édition 2018.
Il y a d’abord le décor, (ci dessous les maquettes) blanc et clair et trois espaces, d'abord pour l'acte I , deux ambiances :
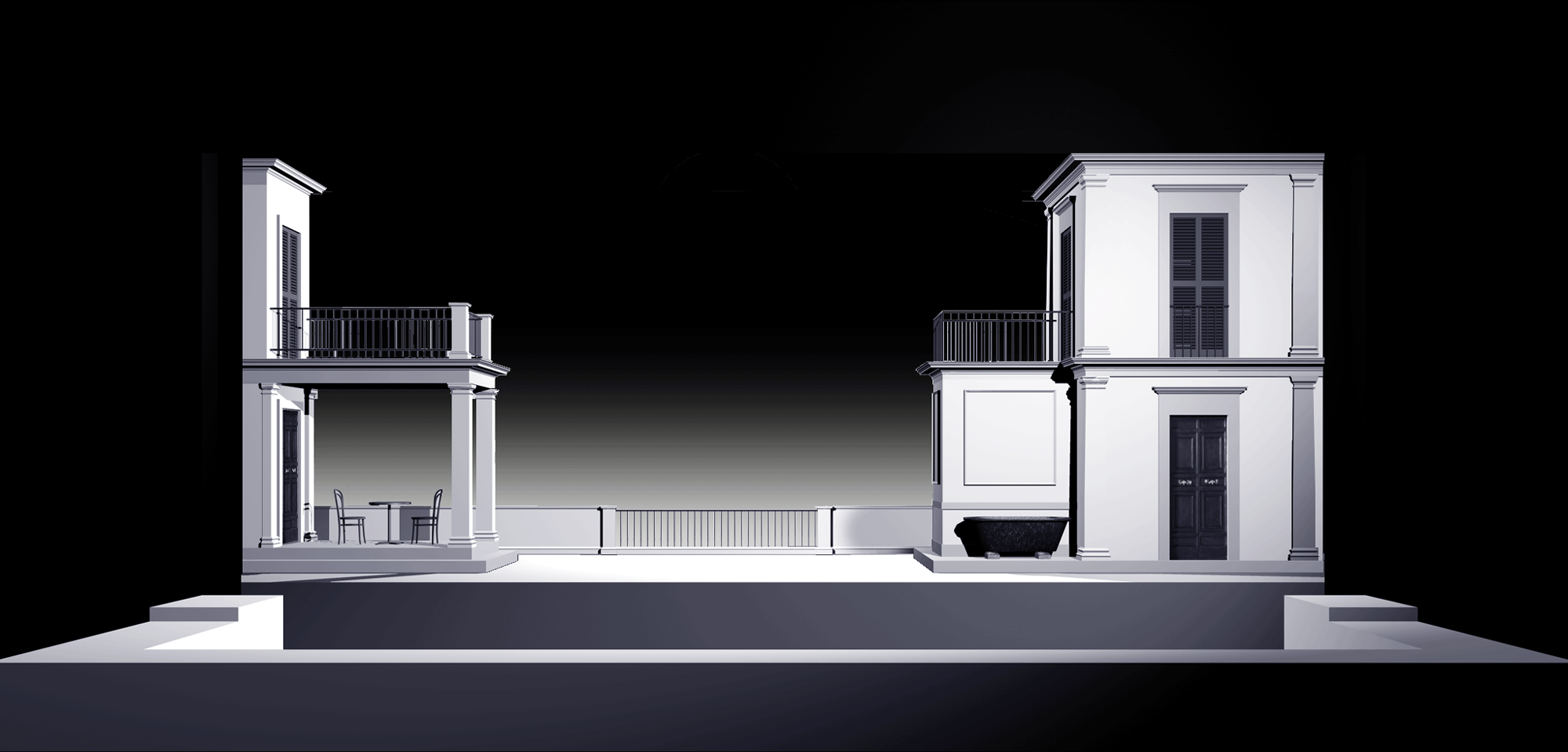
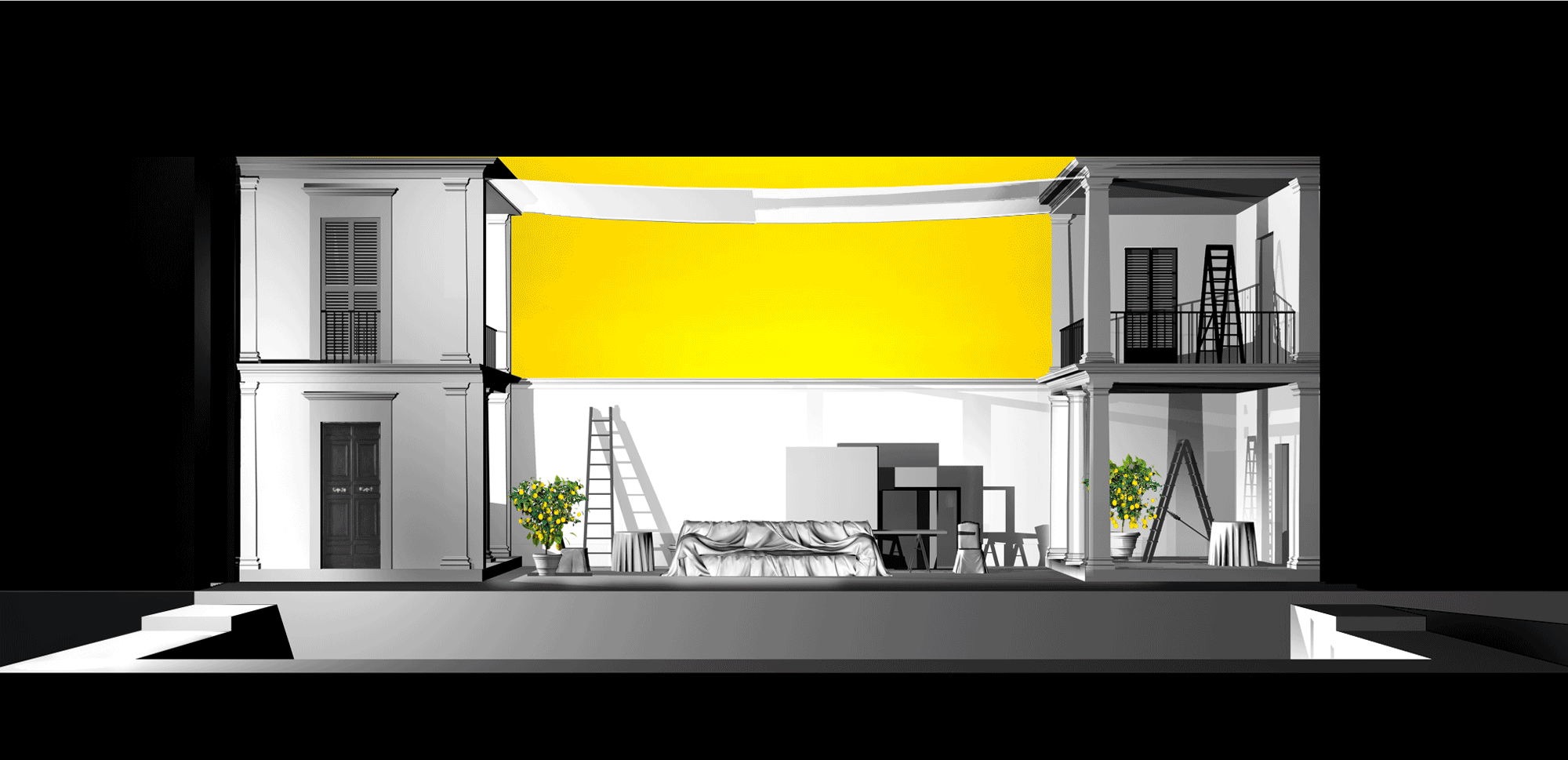
et pour tout l'acte II, une seule ambiance, plus intérieure :

Ainsi cela commence à l’extérieur, de nuit, avec des jeux d’ombres et de lumières sublimes, puis dans la cour intérieure qu’on devine écrasée de soleil et protégée par un tissu blanc qui épouse tout l’espace.
Le deuxième acte se déroule tout entier dans le même espace, plus confiné, un peu moins aéré, où vont se nouer et dénouer les nœuds de l’intrigue.
Dans ces espaces, des costumes à la fois élégants et simples : tout en noir et blanc (dominant dans l’ensemble) pour les hommes avec quelques taches de couleur pour les femmes, pastel pour Rosina, pourpre pour Berta, une couleur pourpre qu’on retrouve dans la robe de chambre de Bartolo.

Une mise en scène d'une précision d'horloge
La première scène détermine les rôles par les costumes : noir et blanc pour tous les musiciens, pour Fiorello, puis Figaro. Almaviva apparaît au balcon torse nu, puis descend et s’habille, chemise blanche, pantalon noir et une magnifique cape damassée vermillon, qui fait tache de couleur et isole le personnage de haut rang qu’il est. Si bien qu’on a l’impression en cette première scène où Fiorello et Almaviva sont sous les fenêtres de Rosine, de revivre le début du second acte de Don Giovanni : même scène de séduction, même relief de l’aristocrate, même fenêtre fermée.

Pizzi joue des lumières et des ombres, des gestes, des mouvements eux-mêmes esthétisés et surtout il construit une mécanique qui colle à la musique, aidé en cela par des interprètes de très haut niveau. Il nous fait comprendre que l’opéra bouffe de Rossini est une sorte de mécanique à la Feydeau : tout doit être en phase, tout doit être d’une précision d’horloge, sinon, cela ne marche pas. D’où la nécessité d’un orchestre qui donne aussi le tempo : on serait chez Wagner, on dirait « Gesamtkunstwerk » : chez Rossini et notamment dans le Rossini bouffe, si scène et orchestre ne vont pas sur les mêmes rythmes, sur les mêmes points d’orgue, tout l’effet comique disparaît corps et biens.

Ce que nous montre aussi Pizzi, c’est que les idées doivent fuser, jamais grossières, toujours élégantes : le comique rossinien n’est jamais vulgaire. Ainsi de ce travail se dégage une suprême élégance, dès le départ, le déploiement des musiciens dans l’ombre fait penser à un origami vivant.
Si le cadre de l’Adriatic Arena n’est pas idéal pour un spectacle d’un tel raffinement, il a l’avantage d’un espace scénique large qui fait se déployer la scénographie.
Il y a entre la première partie virevoltante et très ouverte et aérée, et la deuxième plus confinée une sensible différence, y compris dramaturgique : dans la deuxième partie, les perturbateurs (Figaro, Almaviva) sont dans la place et installés et font basculer toute la maisonnée, Basilio compris, pour isoler complètement un Bartolo pris au piège. Tout est vif, alerte, étonnamment juvénile et frais. Il faut aussi souligner l’élégance des costumes à peine hispanisants pour Figaro, et jamais chargés : les robes diverses de Rosina sont toutes de la même coupe, seule la couleur change, mais toujours dans les tons pastel. Le décor monumental fait de façades blanches, pourrait être de Séville, mais d’ailleurs, dans un climat méditerranéen, avec une fontaine qui fait penser à ces fontaines romaines dans laquelle va se laver Figaro (ça c’est une signature typique de Pizzi) ainsi que l’idée des auvents en tissu blanc qui allègent étrangement l’ensemble, signes de l’écrasante chaleur ; enfin un détail minuscule mais qui fait signe aussi : le citronnier en pot que Figaro apporte qui renvoie à des spectacles précédents du maître qui n’hésite pas à se citer.

Étonnante aussi la manière dont sont gérés les mouvements, les relations entre les personnages, les gestes : on se souvient de Pizzi comme un peintre d’ambiance, non toujours comme un metteur en scène qui travaille sur le personnage. Et pourtant ici, Beaumarchais oblige, les rapports entre les personnages sont soignés, Bartolo-Basilio, Rosina-Berta (il est vrai que la magnifique Elena Zilio a une incroyable présence), le virevoltant Figaro de Davide Luciano ou Fiorello (William Corrò), qui ne chante qu’au début mais toujours présent comme organisateur fidèle des mauvais coups, et Ambrogio, personnage muet, compagnon de Berta (Armando de Ceccon), qui remplit totalement la scène par ses maladresses. Enfin , l’utilisation du podium qui entoure l’orchestre (un souvenir du Viaggio a Reims de Ronconi qui reste la plus mythique des productions de Pesaro), avec les ensembles qui se chantent presque dans la salle mettent le chant et la technique au plus proche des spectateurs en donnant un effet encore plus festif et joyeux à l’ensemble.
Ainsi le détail, le petit fait vrai, la joie permanente, la vivacité d’ensemble rendent ce Barbier presque stendhalien, et on connaît l’amour de Stendhal pour Rossini.

Une distribution d'une remarquable homogénéité
On l’a souligné, une telle mise en scène doit être servie par des artistes complètement immergés dans la folie rossinienne et dans le style voulu. La distribution dans son ensemble a été accueillie au final par un long triomphe très mérité. Faite à la fois de jeunes chanteurs et de rossiniens historiques, elle est d’abord d’une homogénéité remarquable : il n’y a pas un seul maillon faible et s’il y a quelques petites faiblesses, elles sont compensées par une intelligence technique et interprétative hors pair.
Dans les « grands anciens », et même si on vient de l’entendre à Lyon dans un Philippe II de Verdi, méditatif et sombre, Michele Pertusi est un rossinien historique intimement lié aux grands moments de Pesaro (il compte une vingtaine de rôles rossiniens à son répertoire). Son Basilio n’a peut-être plus le volume sonore exigé (on se souvient de ce que Ruggero Raimondi à la grande époque en faisait) et le timbre est légèrement voilé, mais quel style ! Avec un phrasé parfait, une expressivité rare, des accents et des couleurs d’une telle variété, il donne une véritable leçon de chant rossinien et « La calunnia » reste un morceau d’anthologie.

Pietro Spagnoli avec une petite vingtaine de rôles rossiniens à son répertoire, est un Bartolo au timbre relativement clair, lui aussi impayable ; il maîtrise style et technique de manière époustouflante. Accents, rythmes, sillabati sont d’une telle perfection qu’on en reste ébahi d’admiration pour la performance. Jamais ridicule, jamais exagéré, toujours élégant et toujours précis, son Bartolo est lui aussi anthologique.
Devant de tels monstres sacrés du chant rossinien, les plus jeunes de la distribution ne déméritent pas. William Corrò est un Fiorello à la belle présence scénique, même si la voix ne projette pas suffisamment dans le vaste hall de gare qu’est l’Adriatic Arena, même aménagée acoustiquement.

On sait que Maxim Mironov a une grosse dizaine de rôles rossiniens à son répertoire et chante régulièrement à Pesaro. Sa technique de fer, ses aigus et suraigus stratosphériques, sa faculté à dominer les agilités l’y ont prédisposé. Mais il a aussi une diction italienne parfaite, une belle émission, même si le timbre est légèrement nasal ce que d’aucuns lui reprochent. On pourrait peut-être demander plus de couleurs pour un chant qui reste quelquefois monochrome dans une sorte de perfection froide, mais
il reste que son Almaviva est exceptionnel, incluant le redoutable air final « cessa di più resistere » exécuté avec des cadences stratosphériques et un aigu final tenu qui a tourneboulé la salle. Prodigieux.
Sa Rosina est japonaise, Aya Wakizono (entendue déjà au Festival Donizetti de Bergamo en 2017) : voix de mezzo bien projetée et homogène, sans aucun problème de justesse, avec des graves notables. Seul peut-être le registre central mériterait d’être travaillé, mais les aigus, les suraigus, les agilités, les cadences sont vraiment tout à fait extraordinaires et elle compose une Rosine juvénile, vive, alerte, qui remplit la scène. Une vraie promesse.
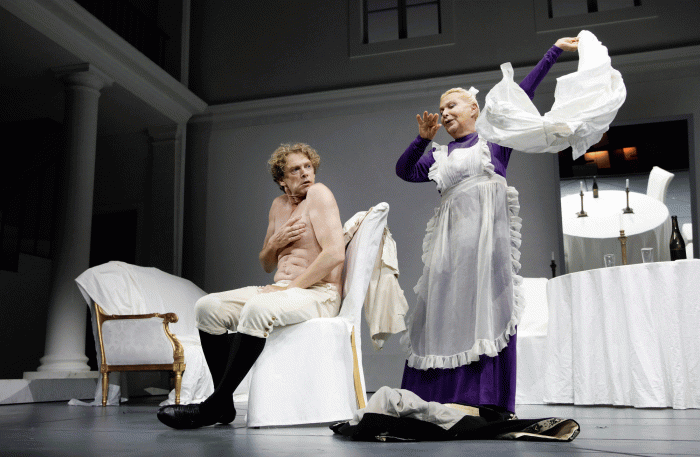
Elena Zilio est Berta. Pour un lecteur français, Elena Zilio n’est peut-être pas un nom évocateur ; pour un spectateur italien, au contraire, c’est une longue carrière de plus de quatre décennies, jamais en haut de l’affiche mais toujours impeccable qui s’est désormais spécialisée dans les rôles de caractère qu’elle chante sur les grandes scènes internationales. Son air « il vecchiotto cerca moglie » fait un tabac, tant le style, le phrasé, l’expression, la couleur en font l'un des très grands moments de la soirée, et que dire aussi de sa présence vocale affirmée dans les ensembles. Très grande artiste, qui communique immédiatement avec le public.
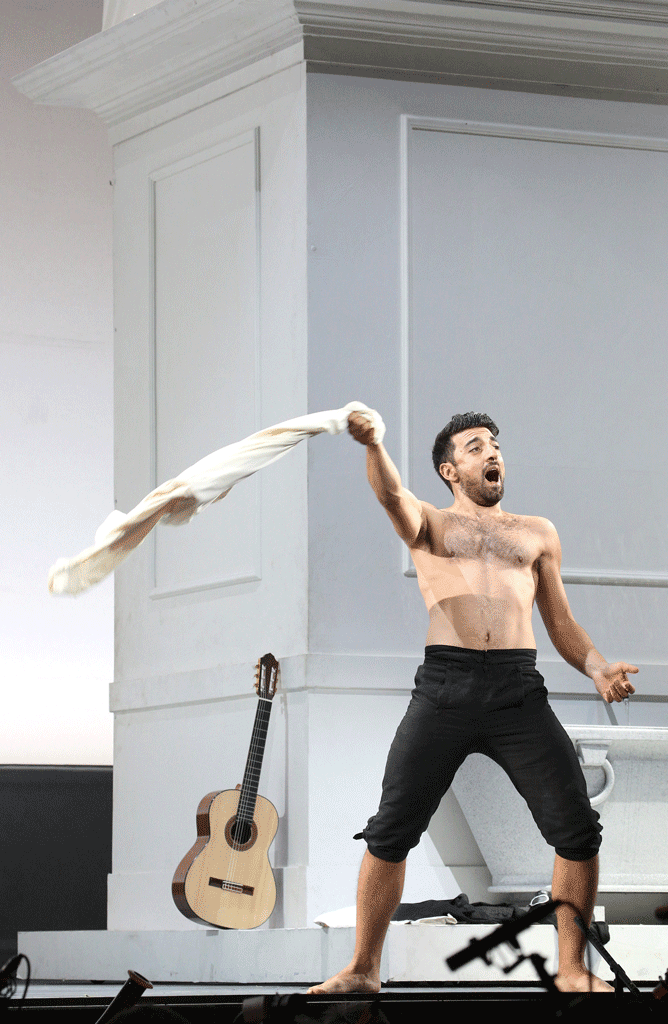
Figaro, c'est le jeune Davide Luciano, dont la carrière commence à exploser. Désormais familier des grands rôles de baryton-basse dont Figaro (Mozart et Rossini) Leporello et Don Giovanni, il est un Figaro incroyable de vivacité, de sveltesse. Il court, il saute, il se lave, il tourbillonne, avec peut-être la seule voix du plateau à vaincre totalement la fatalité de l’acoustique hasardeuse du lieu : une voix sonore, magnifiquement projetée, aux aigus triomphants mais homogène sur tout le registre, une voix typiquement italienne, aux accents idiomatiques et au style rossinien (formé à Pesaro auprès d’Alberto Zedda) impeccable, sillabati à se pâmer, phrasé exemplaire : un Figaro qui s’installe d’emblée dans les références actuelles, à ne pas manquer.

Un accompagnement musical attentif aux chanteurs et au rythme scénique
Et pourtant qu’il est difficile de poser sa voix confortablement dans une salle qui n’est pas faite pour l’opéra, et encore moins pour Rossini. Certes, dans la vaste nef, le dispositif scène salle est isolé, sorte de parallélépipède dont on a limité les échos et évité que les voix ne se perdent dans les hauteurs : il reste que même très près, une partie du volume se dilue dans l’espace et cela pénalise les chanteurs qui ont moins de projection. Il faudra bien que la question lancinante des travaux du palais des sports ou d’une salle qui puisse contenir au moins 1500 spectateurs soit résolue.
Cela se pose aussi pour l’orchestre, et pour le chœur, ici du Teatro Ventidio Basso d’Ascoli Piceno (encore une très belle salle) bien préparé par Giovanni Farina, avec un phrasé clair et des interventions bien calibrées, même si le chœur n’est pas essentiel dans l’œuvre.
L’orchestre est l’excellent Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de Turin, le meilleur orchestre symphonique italien avec Santa Cecilia. Et cela s’entend, cuivres sans scories, précision des attaques, belles sonorités des cordes. Depuis deux saisons, c'est l'orchestre de référence à Pesaro et c'est une arrivée très bienvenue.
Yves Abel, le chef franco-canadien, les dirige avec une rare précision, un geste sûr et un souci de la transparence. Il suit aussi le plateau avec attention avec un résultat d’une rare homogénéité. J’avoue avoir été agréablement surpris et séduit par une approche que je n’attendais pas aussi convaincante. Il est vrai que je n’avais pas entendu Yves Abel depuis de longues années. Il a déjà dirigé à Pesaro il Barbiere di Siviglia en 1997 dans la mise en scène critiquée alors de Luigi Squarzina. Il revient avec une interprétation mûre, dominée, à la fois vive et profonde, jamais à la superficie, jamais démonstrative, qui soigne les couleurs et les rythmes, en phase parfaite avec la mise en scène.
Voici enfin un Barbiere di Siviglia « di qualità » à Pesaro, grâce à un ensemble virtuose où chacun prend sa place, dans une production qui devrait faire date et qui mériterait de devenir culte, tout comme celle de Michieletto pour des raisons différentes, à l’instar de celle de Ponnelle à Salzbourg et à la Scala, tout en méritant des reprises régulières à Pesaro. Evviva, encore une fois.

