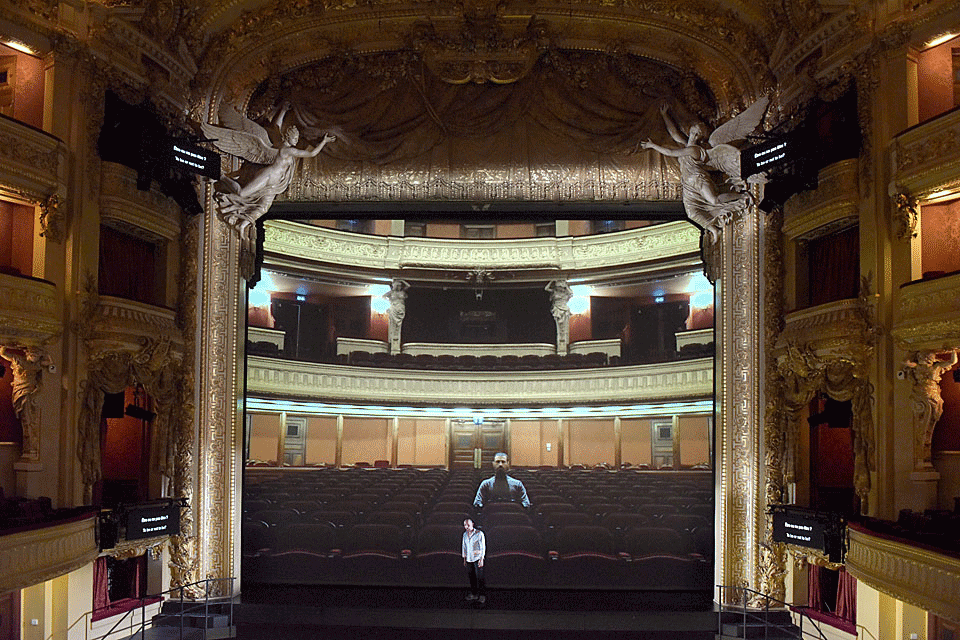
La présence de l’image, filmée en temps réel, ou préenregistrée, sous forme de vidéo, de photo, d’extraits de films, de décors animés ou de fresque lumineuse (mapping) est devenue en quelques années une « écriture scénique » dont le spectacle vivant semble ne plus pouvoir se passer. Au théâtre, comme à l’opéra ou au ballet, le traditionnel décor ne suffit plus et la plupart des metteurs en scène ont intégré cette « matière vivante » pour apporter à leur travail un indispensable contrepoint. Pour Cyril Teste qui signe son premier ouvrage lyrique Salle Favart, tout dans cet Hamlet adapté de la pièce de Shakespeare appelle l’image, du découpage des scènes, au choix dramaturgique, des ellipses aux partis pris très personnels qui émaillent le livret coécrit par Barbier et Carré. Partant de ce postulat, son travail s’emploie à raconter non plus seulement l’histoire d’Hamlet, mais à montrer la réalisation d’un film qui retrace celle d’un interprète en train de réaliser un film sur Hamlet, dans lequel il tient également le rôle-titre. Les principaux protagonistes sont ainsi filmés en « contrechamp »par une équipe technique, dans l’Opéra-Comique lui-même, avant de se retrouver dans la salle pour jouer Hamlet sur un plateau ou de nombreux machinistes s’activent à placer et à déplacer quantité d’accessoires, nécessaires aux différents tableaux.
Gros plans de visages projetés sur la partie haute du rideau de scène, images animées sur des écrans ou des rideaux qui défilent sur des rails rythment ainsi ce « tournage », peut être fantasmé par son « réalisateur », si l’on s’en tient aux paroles proférées par Hamlet resté seul durant son monologue du 3ème acte : « Etre ou ne pas être ! O mystère ! Mourir, dormir, rêver peut-être ». Si le procédé est intéressant, sans pour autant être novateur, Castorf, Warlikowski, Tcherniakov, Bieito, van Hove sans oublier Sellars et Viola dans un désormais mythique Tristan und Isolde sont passés par là, il est regrettable que Cyril Teste et son Collectif ne soient pas allés jusqu’au bout de cette mise en abîme et aient perdu en cours de route leur inspiration après la saisissante reconstitution de la Mort de Gonzague, dans laquelle Hamlet révèle à l’assistance que son père a été tué par son frère et par sa propre épouse.
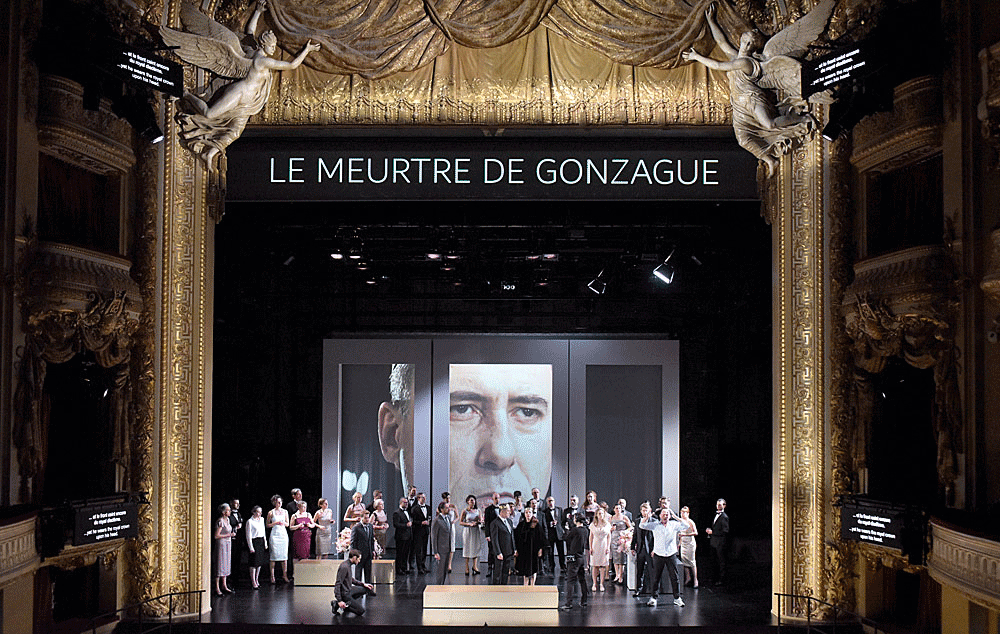
L’ensemble réalisé avec soin est astucieux, de qualité, parfois naïf, notamment lorsque le metteur en scène donne le sentiment de découvrir certains effets alors qu’ils ont été inventé il y a cinquante ans (le spectre assis à l’orchestre tel un spectateur, les entrées par la salle…).

Dans un tel contexte il n’est pas surprenant qu’un artiste de la trempe de Stéphane Degout habitué à travailler avec Pommerat, Mitchell ou Honoré, évolue dans cet univers comme un poisson dans l’eau.
Cet Hamlet qu’il a déjà expérimenté sous la houlette d’Olivier Py, semble lui coller à la peau au point de ne faire plus qu’un avec lui. Adhérant totalement à cette proposition, il se révèle un prodigieux comédien doublé d’un chanteur exceptionnel, libre, habité, d’une expressivité et d’une puissance inégalables dans ce répertoire où sa diction parfaite fait merveille.
Egalement très investie, Sabine Devieilhe qui a fait ses classes avec Warlikowski dans l’oratorio de Haendel Il trionfo del tempo e del disinganno à Aix en 2016, chante et joue le rôle d’Ophélie avec beaucoup de conviction et occupe le plateau sans faiblir pendant sa longue scène de folie au 4ème acte, malgré le tempo dilaté choisi par Langrée, seul moment contestable qui retire à cette page si particulière une partie de son intense beauté.
Laurent Alvaro a les épaules de Claudius même si la voix n’a pas toujours la stabilité requise, Jérôme Varnier impose sa forte présence au Spectre alors que Sylvie Brunet (Gerturde) admirable chanteuse aux graves granitiques, s’avère une comédienne plus limitée par rapport à l’engagement de ses collègues. Dans des rôles anecdotiques mais indispensables, Juien Behr, malgré un aigu défectueux est un honorable Laërte, Kevin Amiel (Marcellus, 2ème Fossoyeur), Yoann Dubruque (Horatio, 1er Fossoyeur) et Nicolas Legoux (Polonius) de solides comprimari entouré par un très bon chœur Les Eléments. Longtemps laissée pour compte et malmenée par des chefs indélicats, la partition de Thomas trouve en Louis Langrée l’interprète idéal, le défenseur absolu d’un compositeur de grand talent, orchestrateur original et subtil, injustement méprisé. Sous sa battue sensuelle tout frissonne, palpite et gronde, de nombreuses pages retrouvant grâce à lui des allures de chef‑d’œuvre.

