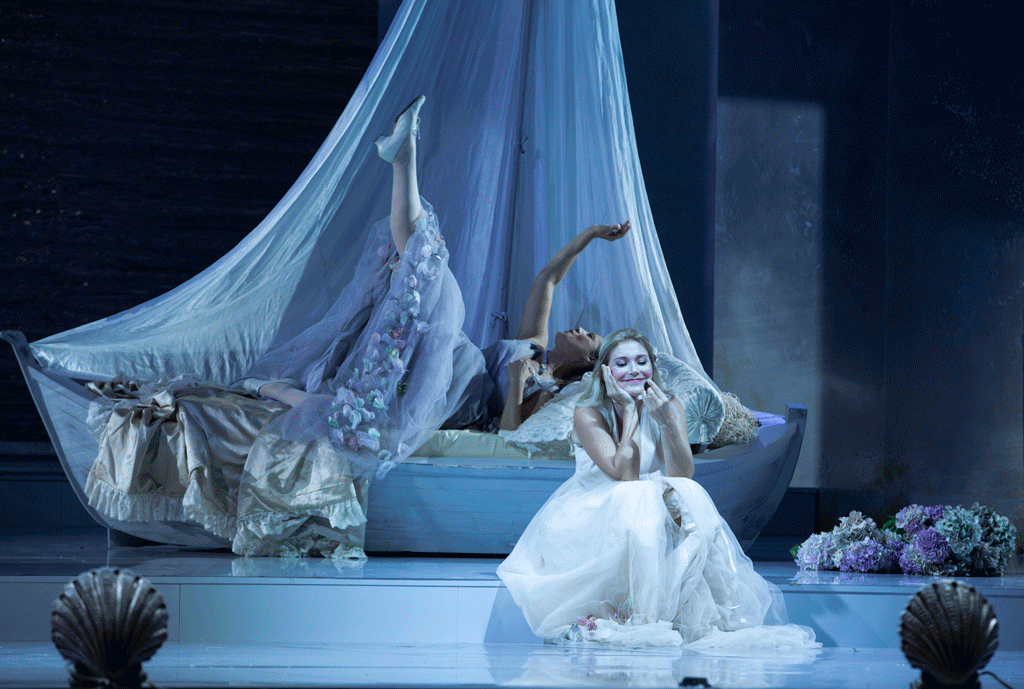
Depuis 1984, Riccardo Muti n’était pas monté au pupitre du San Carlo de Naples, le théâtre de sa ville natale. Il avait alors dirigé un Macbeth qui pendant la préparation, avait vu naître des conflits entre les exigences du célèbre chef et le comportement d’une partie de l’orchestre, des conflits qui depuis ont éloigné Muti de cette scène. Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et Muti a accepté de revenir à Naples, pour y diriger une nouvelle production de Così fan tutte, en coproduction avec la Wiener Staatsoper qui la proposera en 2020. Pour la mise en scène on a appelé sa fille, Chiara Muti, qui a déjà un peu d’expérience au théâtre lyrique. La distribution est plutôt jeune, et sans chanteurs très connus, et donc prête aux méticuleuses répétitions imposées par le maestro. Et comme le chef d’œuvre de Mozart tient sa respiration de la dialectique entre audace de la jeunesse et sagacité de la vieillesse, la rencontre entre le cast et l’immense expérience du chef d’orchestre a été idéale.
Comme c’était prévisible, la qualité du travail de Muti a été impressionnante. Non seulement dans le fonctionnement parfait de la mécanique, mais surtout par la patine toute particulière, entre le désenchantement et la mélancolie, d’une lecture qui a fait de cette édition une réussite mémorable. Sans négliger les moments bouffes, en effet, la subtilité du parcours poursuivi par Muti a fait émerger de manière impalpable le fond aigre et la tristesse qui se cachent dans l’édifice dramaturgique de Così fan tutte conformément au regard que porte le spectateur d’aujourd’hui. Et grâce au mariage du talent de l’artiste et du bagage existentiel de l’homme qui a beaucoup navigué, le chef génial a trouvé un miraculeux et émouvant équilibre entre rendu musical et détachement souriant. À côté du parfum érotique et joyeux, cette concentration a dessiné le profil sibyllin d’un opéra qui apparaît sortir sous bien des aspects du monde des Lumières, et reste malgré tout mystérieux dans sa manière de faire entrevoir le manque de fiabilité désespérant de la condition humaine. Citons pour mémoire entre autres exemples l’attaque ténue et la ligne nostalgique de Soave sia il vento, page symbole de l’opéra. On doit souligner que l’orchestre et le chœur du San Carlo (préparé par Gea Garatti Ansini) ont contribué de manière décisive à la réussite de ce projet complexe, sans oublier Luisella Germano au pianoforte qui a accompagné de manière très sûre les récitatifs.

La mise en scène de Chiara Muti est dans l’ensemble satisfaisante et légère, si l’on excepte quelque excès comme une montgolfière et des « chorégraphies » derrière un voile. Les mouvements des interprètes ont été préparés avec soin et justesse, en un dessein qui par exemple, résout avec élégance l’ensemble final sans laisser les chanteurs en rang d’oignon sur scène. Le décor de Leila Fteita est relativement simple et fonctionnel, où domine la couleur bleue marine sur un pavement transparent à plusieurs niveaux, deux loges de côté où apparaissent les figurants et quelques meubles de temps en temps, comme les lits sur lesquels les filles se couchent ou un jardin à l’italienne avec ses cachettes. On notera aussi l’élégance des couleurs claires ou pastel, y compris des costumes d’Alessandro Lai ; l’ensemble en ressort très lumineux grâce aux lumières de Vincent Longuemare.
La distribution est meilleure qu’attendu. La prestation du soprano Maria Bengtsson est très appréciable : elle montre dans Fiordiligi un timbre brillant et une belle assise. Elle très soucieuse de ses mezzevoci et de ses notes filées exemplaires de suavité dans Per pietà, ben mio, perdona. Quelques problèmes dans le grave cependant l’obligent à pousser un peu dans Come scoglio. Impeccable en revanche le mezzo Paola Gardina, qui incarne une Dorabella très intéressante pour la flexibilité des accents, la rondeur charnue du timbre, dans tous les registres, mais douée aussi d’un jeu de qualité, gracieux et spirituel qui se reflètet dans une diction sans reproche. De fait les applaudissements explosent dans Smanie implacabili ou dans le côté animé d’Amor è un ladroncello. Grande désinvolture vocale et scénique chez le baryton Alessio Arduini, un Guglielmo aux élans changeants mais toujours ciblés, aguicheur dans Non siate ritrosi, et amer dans Donne mie, la fate a tanti. Le ténor Pavel Kolgatin en revanche n’est pas un Ferrando de même niveau. Certes le phrasé de Un’aura amorosa ou de Tradito, schernito est assez fin, mais la vocalité d’ensemble, marquée un vibrato excessif, paraît souvent bêlante.
La Despina d’Emmanuelle de Negri est vive et allègre, tandis que le baryton Filippo Romano doué de bonnes qualités vocales propose un Don Alfonso indulgent et débonnaire qui tranche avec le philosophe cynique qu’on demande quelquefois aujourd’hui au personnage.

