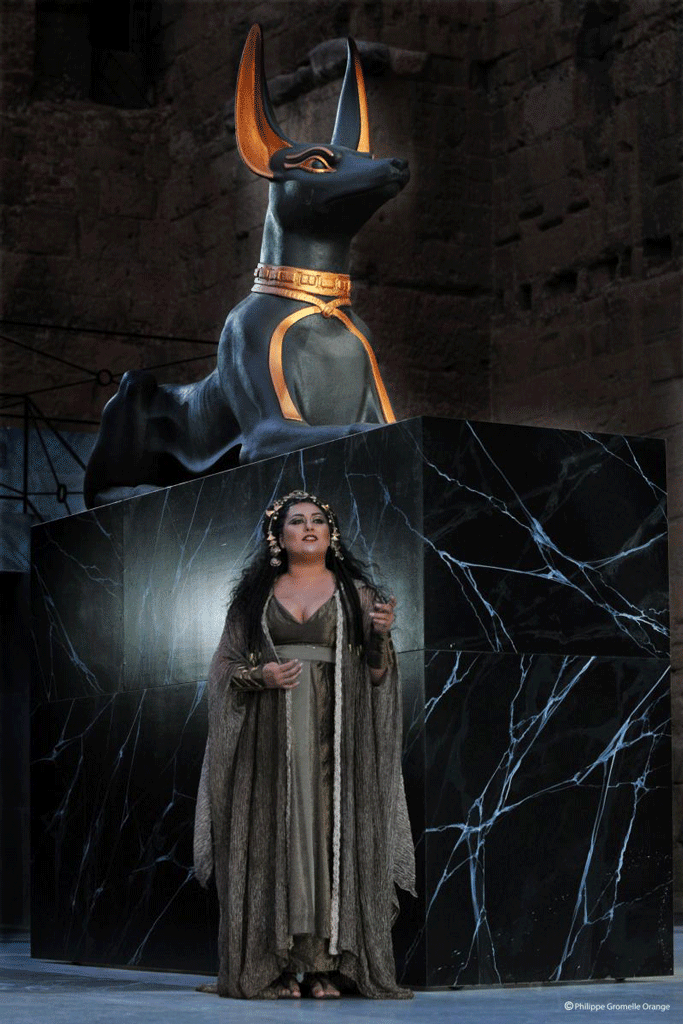 Les Chorégies d'Orange s'honorent d'être le plus ancien festival français, accueillant chaque année des spectacles dont la dimension et l'esthétique remplit une jauge de plus de 8000 spectateurs dans le cadre majestueux du théâtre antique. Un certain nombre de difficultés financières contraignent l'Etat à lancer un audit dès septembre, ce qui pourrait compromettre à terme les projets du nouveau directeur Jean-Louis Grinda, pris entre le marteau de la billetterie et l'enclume d'un public habitué à un répertoire traditionnel et aux grandes productions. Programmé en 2018 aux côtés d'un rassurant Barbier de Séville, le plus rare Mefistofele de Boito s'annonce déjà comme un pari risqué auprès du public.
Les Chorégies d'Orange s'honorent d'être le plus ancien festival français, accueillant chaque année des spectacles dont la dimension et l'esthétique remplit une jauge de plus de 8000 spectateurs dans le cadre majestueux du théâtre antique. Un certain nombre de difficultés financières contraignent l'Etat à lancer un audit dès septembre, ce qui pourrait compromettre à terme les projets du nouveau directeur Jean-Louis Grinda, pris entre le marteau de la billetterie et l'enclume d'un public habitué à un répertoire traditionnel et aux grandes productions. Programmé en 2018 aux côtés d'un rassurant Barbier de Séville, le plus rare Mefistofele de Boito s'annonce déjà comme un pari risqué auprès du public.
Peu de risques en revanche pour cette Aida qui trouve d'ordinaire à Orange un cadre approprié à sa dimension. On s'étonne pourtant de la modestie des décors qui se résument à deux gradins latéraux pour les chœurs, un Anubis géant à jardin et des reproductions en miniatures de monuments de l'Egypte ancienne montés sur d'étranges piédestaux mobiles. Présent dans l'encadrement de la porte au fond de la scène, le couple statuaire Rahotep-Nofret rappelle à qui ne l'aurait pas deviné le destin qui attend Radamès et Aida, réunis dans la mort. Pour relever la couleur paresseusement péplum de la mise en scène de Paul-Emile Fourny, on a cru bon pimenter la scénographie d'une dose d'égyptomanie anachronique. Le résultat est pour le moins mitigé, surtout quand défilent les chœurs (et les fameuses trompettes) en costumes vaguement Consulat et ces inénarrables ballets dont la crème viennoise se mêle aux artefacts égyptiens. L'érection de l'obélisque de Louxor pendant la marche triomphale sert de trait d'union temporel qui rappelle l'inauguration du monument à Paris en 1836.
On l'aura compris, ces éléments sont trop disséminés pour prétendre former une ligne cohérente et offrir un spectacle qui rende compte d'un ouvrage aux encombrants contours grandioses et imposants. Il faut aller chercher la grandiloquence dans le plateau vocal et, plus précisément dans une Amneris somptueuse et magistrale signée Anita Rachvelishvili. La mezzo géorgienne n'a pas à forcer son talent pour livrer une interprétation sous-tendue par un timbre ample et sombre. La projection se joue des caprices du mistral et passe aisément dans les scènes de groupes. La défection de Sondra Radvanovsky ayant contraint les Chorégies à trouver dans l'urgence une remplaçante, c'est la jeune Elena O'Connor qui doit affronter cette rivale redoutable. Pour son baptême du feu dans le théâtre antique, la soprano américaine n'a pas la technique ni les moyens pour faire face aux difficultés que pose une représentation en plein air dans des circonstances aussi difficiles. La tension du vibrato et une palette incolore sont les signes audibles d'un fléchissement général, particulièrement sensible dans les duos. Même dans une forme assez moyenne, le Radamès de Marcelo Alvarez ne fait qu'une bouchée de la frêle éthiopienne, notamment dans le final. Le ténor ne s'embarrasse pas de subtilités pour un Celeste Aida chanté à coups de menton dans l'aigu.  Le solide Amonasro de Quinn Kelsey fait rapidement oublier un roi d'Egypte en plein naufrage (José Antonio Garcia). On gardera nos palmes pour le Ramfis de Nicolas Courjal sans oublier le messager de Rémy Mathieu et la prêtresse de Ludivine Gombert. Les forces réunies des chœurs d'Angers-Nantes, de l'Opéra de Monte-Carlo, du Grand Opéra Avignon et de l'Opéra de Toulon, font belle figure malgré l'éloignement peu commode que leur imposent les deux gradins latéraux.
Le solide Amonasro de Quinn Kelsey fait rapidement oublier un roi d'Egypte en plein naufrage (José Antonio Garcia). On gardera nos palmes pour le Ramfis de Nicolas Courjal sans oublier le messager de Rémy Mathieu et la prêtresse de Ludivine Gombert. Les forces réunies des chœurs d'Angers-Nantes, de l'Opéra de Monte-Carlo, du Grand Opéra Avignon et de l'Opéra de Toulon, font belle figure malgré l'éloignement peu commode que leur imposent les deux gradins latéraux.
À la tête d'un Orchestre National de France des grands soirs, le vétéran Paolo Arrivabeni ne cherche pas à dissimuler son Aida dans des effets de manches, d'autant plus que le vent s'abat sur la fosse en violentes bourrasques durant toute la soirée. Le geste est sûr et régulier, focalisant l'intérêt sur l'équilibre des ensembles et la justesse des scènes dialoguées, sans que cela suffise à combler nos attentes.

