En-dehors d’un Mozart dont l’autorité surpasse celle de tous ses contemporains, Schubert et Tchaikovsky peuvent à bon droit être considérés comme les deux compositeurs, hors opéra, auxquels le maestro napolitain a laissé la trace la plus marquante, au disque et au concert. Muti a enregistré une seule fois leurs intégrales symphoniques, mais cela a suffi pour qu’il compte, au minimum, parmi les références de chaque discographie. Le cas est plus évident dans Schubert, un répertoire qu’il a arpenté avec une constance et une intensité sans commune mesure à ce niveau, et sur cette durée. Au cœur de ce parcours, il y eut le cycle, ô combien marquant malgré une concurrence sérieuse, gravé avec les Wiener Philharmoniker à la fin des années 80 pour EMI. Elle demeure une solide référence dans une esthétique de grand style, dépourvue de l’épaisseur dont on lui a parfois fait grief, plus injustement que pour ses Beethoven ou Schumann. Du reste, Schubert a toujours été au cœur de la riche relation nouée avec les Viennois, depuis sa première tournée avec l’orchestre en 1975, quand il recevait pour ainsi dire des mains de Böhm l’esprit de Schubert, prenant, avec la 5e Symphonie le relais des 8e et 9e du sage au cours du même séjour japonais.
Combien plus complexe fut sa relation avec Berlin, pourtant commencée la même saison, en 1972 ! On sait qu’elle connut notamment une extravagante éclipse de dix-sept saisons (1992–2008) interrompue par l’invitation à diriger l’Europakonzert de Naples, lequel était conclu par la Grande, symphonie des grands soirs par excellence que Muti avait déjà choisie pour sa première venue à la Scala avec les Wiener. La Tragique, qu’il n’a cessé de remettre sur le métier depuis trente ans, – et qu’il dirige encore ces jours-ci en tournée avec son jeune orchestre Cherubini – était en revanche sauf erreur une première berlinoise pour lui (alors qu’il existe au moins cinq bandes viennoises de concert étalées sur autant de saisons de 1987 à 2014). Après une nouvelle invitation berlinoise en 2015 où il dirigeait notamment l’Ouverture dans le style italien, celle-ci (son quatrième programme berlinois seulement en un quart de siècle, donc) avait des accents de consécration tardive, avec non pas trois comme pour les séries en abonnement de l’orchestre, mais quatre soirées consécutives, toutes conclues par la 4e de Tchaikovsky, les trois premières commencées par celle de Schubert – la dernière intégrant à sa place le jubilé d’Anne-Sophie Mutter. C’est au troisième concert qu’on a assisté, choix normalement judicieux et de toute manière contraint par le triplé schubertien de Barenboim la veille.
 On ne pouvait imaginer, et souhaiter de propositions plus dissemblables dans la Tragische que celles de Barenboim et de Muti. Un tel écart, à ce niveau de réalisation et de hauteur de conceptions, ne fait pas courir de grands risques de défiguration à l’œuvre. Il est cependant objectif de dire que sur un plan, celui de la cohérence formelle, Muti, en observant les deux reprises des mouvements extrêmes, offre davantage à entendre la vérité de cette symphonie, en restituant sa temporalité proprement schubertienne, et ses dimensions largement beethovéniennes (les deux aspects étant par ailleurs distincts). En outre, le temps du drame, le temps pour le dire, est ici donné avec la générosité permise par un programme confortable. Muti a considérablement élargi le mouvement du I depuis son enregistrement trentenaire, renonçant certes au vivace de l’allegro initial (ainsi, encore plus que Barenboim, à celui du menuet, exagérément retenu). Mais il est difficile de tenir cette licence pour répréhensible : rares sont les mouvements extrêmes de grandes œuvres de Schubert à ne pas supporter, et même à ne pas bénéficier de tempi plus retenus que l’indication. Et on pourrait ajouter qu’aucun travail, aucun fini instrumental n’est jamais assez classieux ni assez sophistiqué pour Schubert. On a indiscutablement ici le nec plus ultra en la matière, et ce n’est pas un propos rhétorique. Je ne vois aucune des autres phalanges de prestige comparable dans le monde qui soit capable de se hisser à ce niveau de qualité d’écoute, de précision dynamique et d’étagement harmonique, de plasticité individuelle et globale du son. D’autres sont capables de jouer aussi fort, aussi virtuose, mais pas aussi raffiné en préservant la tension.
On ne pouvait imaginer, et souhaiter de propositions plus dissemblables dans la Tragische que celles de Barenboim et de Muti. Un tel écart, à ce niveau de réalisation et de hauteur de conceptions, ne fait pas courir de grands risques de défiguration à l’œuvre. Il est cependant objectif de dire que sur un plan, celui de la cohérence formelle, Muti, en observant les deux reprises des mouvements extrêmes, offre davantage à entendre la vérité de cette symphonie, en restituant sa temporalité proprement schubertienne, et ses dimensions largement beethovéniennes (les deux aspects étant par ailleurs distincts). En outre, le temps du drame, le temps pour le dire, est ici donné avec la générosité permise par un programme confortable. Muti a considérablement élargi le mouvement du I depuis son enregistrement trentenaire, renonçant certes au vivace de l’allegro initial (ainsi, encore plus que Barenboim, à celui du menuet, exagérément retenu). Mais il est difficile de tenir cette licence pour répréhensible : rares sont les mouvements extrêmes de grandes œuvres de Schubert à ne pas supporter, et même à ne pas bénéficier de tempi plus retenus que l’indication. Et on pourrait ajouter qu’aucun travail, aucun fini instrumental n’est jamais assez classieux ni assez sophistiqué pour Schubert. On a indiscutablement ici le nec plus ultra en la matière, et ce n’est pas un propos rhétorique. Je ne vois aucune des autres phalanges de prestige comparable dans le monde qui soit capable de se hisser à ce niveau de qualité d’écoute, de précision dynamique et d’étagement harmonique, de plasticité individuelle et globale du son. D’autres sont capables de jouer aussi fort, aussi virtuose, mais pas aussi raffiné en préservant la tension.
Le son, dans le I, qui a aussi partie liée avec le tempo modéré, diffère de celui des viennois (mais aussi de la Staatskapelle entendue la veille, il est vrai dans des conditions acoustiques très différentes) : il se tient dans un clair-obscur d’une singulière beauté, aux contours rendus d’autant plus étonnants que les dynamiques sont maintenues dans une limite rigoureuse, et inhabituelle. Il est presque toujours intéressant de faire jouer très doucement les rares orchestres dotés d’une grande réserve de puissance, et de créer un espace de liberté et de raffinement polyphonique supplémentaire à partir de cette contrainte. Il ne faut certes pas que cela verse dans une complaisance esthétisante (d’autres y ont cédé avec ces moyens orchestraux hors-normes), et on en est bien loin avec Muti. Avec une fois et demi l’effectif de Barenboim pour le quintette (12–10‑8–6‑5), les Philharmoniker réussissent l’exploit pour eux ordinaire de jouer rond, dense, et presque toujours comme par-dessous l’harmonie, quoi qu’en menant les phrasés à terme. Le premier groupe en pâtit néanmoins un peu en directivité. A ce tempo, l’évolution de Muti pourrait faire songer à celle de Giulini, mais l’esprit reste fort différent, le legato n’étant pas forcé au thème de tête, et l’emphase étant davantage mise ici sur l’harmonie que sur la mélodie. Ce sont les trois conduites du second groupe qui fascinent par la tension créée à partir de ce qui fondamentalement, et continument, est de l’ordre de l’understatement. Le passage aux basses de la seconde moitié du thème se dépare presque entièrement de l’électricité qui est son lieu commun, et de même des réponses modulantes des violons, chirurgicales et enchaînées avec une très chic modération. Après les cinq blanches ramenant la tonique, la logique est conduite à son terme, les cordes servant de sous-bassement à la marche harmonique des bois : au reste, la battue modérée a ici un effet d'ennoblissement du motif à six croches, lui procure de la dignité dans l'accumulation. Il est bien sûr de permis de trouver ce travail de haute-couture trop en-dedans, trop sage, ou gommant à l’excès l’élément rythmique qui fait l’unité du matériau. Mais éclairer cette musique de cette lumière de bonté et de sagesse met en relief ce qui, dans sa qualité, excède son premier degré – la tumultueuse symphonie de tonalité dramatique d’un compositeur de vingt ans.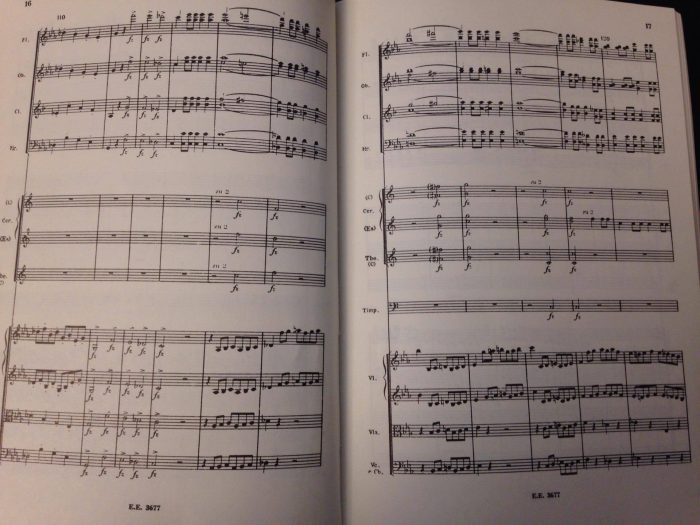
Le moment anthologique de ce concert est certainement l’andante. Muti le maintient, contrairement aux trois autres mouvements, dans le tempo conventionnel, mais c’est bien le seul aspect ordinaire de cette exécution d’une perfection instrumentale époustouflante, mise au service d’une vision comme il en est rarement exposé ici. Les très grands interprètes transforment notre vision des œuvres, notre façon de les vivre. On ressort à coup sûr moins bête de cette audition qui, en dépit de toutes celles qui ont précédé, fait prendre conscience du génie de cette page, et singulièrement des deux vastes transitions amenant de l’épisode en fa mineur au thème dans le relatif majeur. Il est rare que la direction, et la qualité technique rendent autant justice à cette écriture où se déploie déjà tout le génie de maturité de Schubert, et où la sensibilité d’orchestration la plus fine se conjugue avec un sens extraordinaire du temps dramatique, de la dilatation du mouvement, de la fausse piste, de l’arrêt différé. C’est tout cela que, dans ces minutes bouleversantes, Muti et les Berliner illuminent, avec une précision horlogère dans l’instauration du climat et le contrôle des plans, mais surtout, un chant et une animation intérieurs d’une indicible profondeur, à faire pleurer les pierres.
La suite, on y a fait allusion, a davantage gêné par sa lenteur et son manque de rebond, en dépit d'une ampleur lyrique certaine et d'un trio réussi. Le finale, sans forcément surprendre ni émouvoir autant, renoue avec le fond d’air automnal et pudique des deux premiers mouvements, avec (comme d’ailleurs la Staatskapelle la veille, et aussi bien) une très grande attention accordée aux voix intermédiaires, à la précision absolue des trémolos et des croches d’accompagnement. Le même refus d’une intensité extérieure aux cordes se remarque dans la marche harmonique conduisant à chaque conclusion. Les bois du Philharmonique se couvrent autant de gloire que ceux de la Staatskapelle dans la montée chromatique vers la réexposition en ut majeur. Avec son sens du théâtre, Muti garde pour l’ultime crescendo le seul véritable fortissimo de la symphonie. La flûte de Pahud, donnant un avant goût de son show de deuxième partie, s’élève au-dessus de la mêlée dans la coda avec une aisance déconcertante. A noter que comme Barenboim, et suivant une norme qui ne s’est imposée que progressivement (il ne l’observait pas sur son enregistrement), Muti fait jouer la version originale non réorchestrée par Brahms, donc sans les doublures du thème des bassons aux violoncelles. Contrairement à Barenboim, étonnamment lapidaire la veille, il joue toujours le point d’orgue non écrit sur la dernière des trois rondes. Les deux options peuvent convaincre autant.
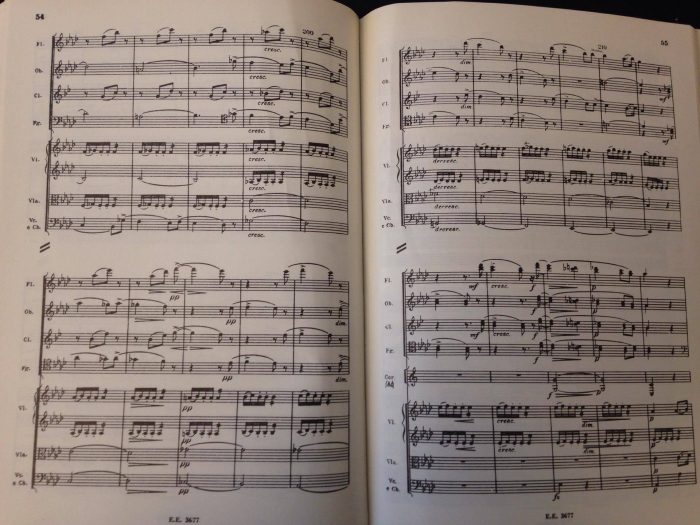 Le Tchaikovsky de Muti doit sa réputation à son accent personnel, illustré aussi bien avec les formations européennes qu’américaines, et qu’il est facile de qualifier d’italien. Facile car correspondant à une flamboyance et une sorte de moyen-terme entre les idiomes slaves et germaniques, d’ailleurs bienvenu dans une musique qui doit autant à ces deux environnements (et, en outre, à l’Italie : cette symphonie fut d’ailleurs presque entièrement composée à Venise et achevée à San Remo). Pour autant, on peine à trouver, parmi les chefs transalpins fameux dans l’histoire, un autre qui satisfasse autant à ce caractère fédérateur. Cependant, celui que Muti a donné à entendre à Berlin avait, dans son aspect crépusculaire, quelque chose d’à la fois plus creusé et moins immédiatement reconnaissable. La faute en revient, semble-t-il, à Berlin justement, qui dans Tchaikovsky fait du Berlin. C’est d’ailleurs quelque chose d’assez mystérieux. Depuis l’ère Karajan, il semble que l’orchestre se refuse dans cette musique à la souplesse et l’adaptabilité qu’il a maintes fois démontrées sous les baguettes les plus diverses dans les autres répertoires courants. Rien ne fait dérailler cette machine de guerre toujours aussi incroyable de puissance (ce qui reste sous la pédale paraît toujours illimité, la marge avant saturation infinie), de contrôle de sa noirceur sonore, d’infaillibilité rythmique. Mais cela n’empêche pas les signatures de Muti de s’affirmer, moins dans la sonorité et les détails de caractérisation que dans l’emprise globale, le dessein lyrique de long terme.
Le Tchaikovsky de Muti doit sa réputation à son accent personnel, illustré aussi bien avec les formations européennes qu’américaines, et qu’il est facile de qualifier d’italien. Facile car correspondant à une flamboyance et une sorte de moyen-terme entre les idiomes slaves et germaniques, d’ailleurs bienvenu dans une musique qui doit autant à ces deux environnements (et, en outre, à l’Italie : cette symphonie fut d’ailleurs presque entièrement composée à Venise et achevée à San Remo). Pour autant, on peine à trouver, parmi les chefs transalpins fameux dans l’histoire, un autre qui satisfasse autant à ce caractère fédérateur. Cependant, celui que Muti a donné à entendre à Berlin avait, dans son aspect crépusculaire, quelque chose d’à la fois plus creusé et moins immédiatement reconnaissable. La faute en revient, semble-t-il, à Berlin justement, qui dans Tchaikovsky fait du Berlin. C’est d’ailleurs quelque chose d’assez mystérieux. Depuis l’ère Karajan, il semble que l’orchestre se refuse dans cette musique à la souplesse et l’adaptabilité qu’il a maintes fois démontrées sous les baguettes les plus diverses dans les autres répertoires courants. Rien ne fait dérailler cette machine de guerre toujours aussi incroyable de puissance (ce qui reste sous la pédale paraît toujours illimité, la marge avant saturation infinie), de contrôle de sa noirceur sonore, d’infaillibilité rythmique. Mais cela n’empêche pas les signatures de Muti de s’affirmer, moins dans la sonorité et les détails de caractérisation que dans l’emprise globale, le dessein lyrique de long terme.
Les mouvements extrêmes sont certainement les plus aboutis par l’échange harmonieux de vues entre le rubato mesuré mais éloquent du chef et la mécanique dévastatrice des Philharmoniker. Au total, ce Tchaikovsky est on ne peut plus occidental, massif et assez peu rectiligne, musculeux et avec une débauche de confort moderne passablement insensée. Mais il évite tous les écueils de vulgarité ou de platitude y afférents, et Muti y est pour beaucoup. La ductilité de sa conduite du thème principal préserve, malgré l’ampleur sonore et le legato, le caractère de valse jetée dans un espace trop vaste. Plus que du rubato sentimental on entend de l’instabilité et des affres dans l’expression, de la fêlure intérieure à cette avancée inexorable. La sortie du second thème et le retour à l’andante con anima est, ce n’est pas vraiment une surprise, du genre que les symphomanes de tous les pays nommeront orgasme orchestral, et le climax du développement, plus loin, jusqu’au retour de l’idée initiale, garantit que ceux venus vivre l’expérience philharmonique berlinoise dans toute sa mythologie en auront pour leur argent, contrebasses faisant vibrer le sol comprises. On ne saurait minimiser la valeur de ces aspects pourtant si convenues. Sur le second thème proprement dit, et à d’autres endroits, la clarinette d’Ottensamer frustre quelque peu par son exceptionnelle rondeur combinée à un certain manque d’engagement. C’est subtil, mais trop.
C’est cependant entre ces deux épisodes, dans le développement proprement dit, où tant d’exécutions s’enlisent, que Muti démontre sa maîtrise absolue de la continuité et de la respiration. L’orchestre a le mérite de répondre à toutes les inflexions demandées, ce qui est assurément plus difficile que de réussir les climax précités. Le konzertmeister américain Noah Bendix-Balgley se montre ici (mais comme partout) impressionnant d’autorité. Outre le développement, l’énigmatique épisode quasi choral qui précède la coda (à V) fascine aussi simplement parce qu’il sait où il va, ce qui n’est pas commun : les rappels motiviques aux cordes par-dessous sont d’une classe qui sert la cohérence du propos. Sauf erreur, c’était la première fois que je le voyais en action, et l’impression faite a été plus forte qu’avec les trois autres que j’avais déjà vu emmener les Berliner. Muti peut aussi s’appuyer particulièrement dans ce cœur du mouvement sur la flûte stellaire de Pahud, qui ne vibre jamais, ne laisse passer aucun souffle audible, ne ferraille jamais, transperce n’importe quel mur sonore à volonté, il suffit de demander, et c’est servi, avec chaleur et presque avec le sourire. Et quel sens de l’immédiateté de phrasé !
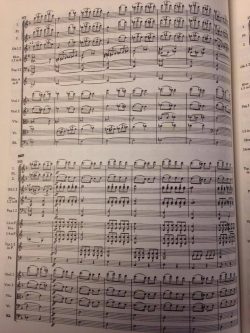 Pahud aurait pu être une pièce essentielle d’un très grand Andantino, si celui-ci n’était grevé de deux réserves de natures différentes. L’une, une exposition propre mais sans personnalité ni grâce instrumentale particulière du hautbois. L’autre, un basculement exagéré dans une esthétique de fondu sonore et de lyrisme onctueux au cours de la grande progression centrale, qui supporte mal l’absence d’articulation franche et le relâchement rythmique. Ici la motricité survit parce que de ce magma de cordes le mouvement parvient toujours à réémerger, que la beauté plastique est époustouflante, et enfin que Pahud emporte tout sur son passage. La force et les équilibres sont là, mais le ton, mi-brahmsien mi-verdien, ne convainc pas (surtout dans la mesure où il nous a déjà été loisible d’entendre un quintette d’une puissance presque comparable dans ce passage, avec une flûte presque aussi surnaturelle, et une conduite cette fois implacable, avec Termikanov et ses Petersbourgeois). Le ton du scherzo, en revanche, est d’une grande noblesse et d’une intelligibilité rare. Seul le jovial et claironnant (en principe) la d’attaque du trio aux hautbois manque à l’appel, tombant franchement à plat. Le finale est une démonstration de force conventionnelle sans défauts, sans fautes de goût, et non dépourvue d’humanité dans sa partie récapitulative. Ici comme dans tout le concert, il nous est loisible d’admirer l’art du timbalier vétéran Rainer Seegers, trente-trois ans de maison, et une fraîcheur de jeu qui en remontre à la totalité de ses confrères : ce sens systématique, qu’on admire à chacune de ses sorties, de l’anticipation infime du temps, combinée à une dynamique toujours raisonnable, crée en permanence une clarification de texture, et une urgence par l'effet de lancement rythmique, qui ne dépare jamais du cadre chirurgical auquel il prend toute sa part.
Pahud aurait pu être une pièce essentielle d’un très grand Andantino, si celui-ci n’était grevé de deux réserves de natures différentes. L’une, une exposition propre mais sans personnalité ni grâce instrumentale particulière du hautbois. L’autre, un basculement exagéré dans une esthétique de fondu sonore et de lyrisme onctueux au cours de la grande progression centrale, qui supporte mal l’absence d’articulation franche et le relâchement rythmique. Ici la motricité survit parce que de ce magma de cordes le mouvement parvient toujours à réémerger, que la beauté plastique est époustouflante, et enfin que Pahud emporte tout sur son passage. La force et les équilibres sont là, mais le ton, mi-brahmsien mi-verdien, ne convainc pas (surtout dans la mesure où il nous a déjà été loisible d’entendre un quintette d’une puissance presque comparable dans ce passage, avec une flûte presque aussi surnaturelle, et une conduite cette fois implacable, avec Termikanov et ses Petersbourgeois). Le ton du scherzo, en revanche, est d’une grande noblesse et d’une intelligibilité rare. Seul le jovial et claironnant (en principe) la d’attaque du trio aux hautbois manque à l’appel, tombant franchement à plat. Le finale est une démonstration de force conventionnelle sans défauts, sans fautes de goût, et non dépourvue d’humanité dans sa partie récapitulative. Ici comme dans tout le concert, il nous est loisible d’admirer l’art du timbalier vétéran Rainer Seegers, trente-trois ans de maison, et une fraîcheur de jeu qui en remontre à la totalité de ses confrères : ce sens systématique, qu’on admire à chacune de ses sorties, de l’anticipation infime du temps, combinée à une dynamique toujours raisonnable, crée en permanence une clarification de texture, et une urgence par l'effet de lancement rythmique, qui ne dépare jamais du cadre chirurgical auquel il prend toute sa part.
Un grand concert au fond : par sa réalité comme par ses symboles et son contexte, où la trace musicale de Muti aura surtout irradié un Schubert à nul autre pareil. Le Tchaikovsky faisait surtout droit à la parade d’un orchestre finalement à l’image de son invité, incomparable moins par son infaillibilité que par son aura, sa manière unique de prendre la parole, de l’imposer à son lieu, à quatre-vingts comme on monte seul en chaire pour un sermon.

