Daß der Ostwind Düfte
Hauchet in die Lüfte,
Dadurch thut er kund,
Daß du hier gewesen.
(Rückert / Schubert D. 775)
La première partie de ce programme, aux armures vierges, présentait l’intérêt d’avoir été proposée à l’identique par Leonskaja en 2014, lors d’un récital assez vertigineux à Pleyel, qui comprenait aussi les sonates de Berg et en fa dièse de Schumann. On n’est pas surpris de trouver chez Uchida des visions plus creusées, plus risquées, que des détracteurs trouveront trop compliquées. Le soupçon du maniérisme a toujours rôdé autour des lectures de cette pianiste, et il est intéressant d’en dire un mot. Il est objectivement exact qu’ici ou là, Uchida fait ce qu’il est convenu d’appeler un sort à tel thème lyrique, telle transition rubatisée, etc. Dans les D.958 et 959 qu’elle avait données au TCE en 2012, ce trait était d’ailleurs beaucoup plus prononcé qu’au cours de cette soirée, ce qui peut s’expliquer par la nature architecturale plus contrainte des textes, qui pousse au contraste sentimental. Mais ce qui m’a toujours frappé chez Uchida, jusque et surtout dans ses ratés, est l’absence évidente de préméditation, de visée d’effet. Ses lectures sont déroutantes, dans Schubert notamment, pour une raison principale qui est un paradoxe : elle cultive où c’est possible un ton grandiose, mais sa forme de conduite est toujours profondément instinctive, et laisse une large part à l’intuition de l’instant. Elle tend à la majesté, sans le magistral. Et c’est une bonne chose, même si le déchet est une part intégrante de presque chacune de ses lectures. Presque, car si la triade finale du TCE valait d’abord par une D.960 aussi personnelle qu’aboutie, il y a bien moins à redire ici.

Nos principales réserves portent sur une D.537 généreuse mais brouillonne, surtout dans le premier mouvement, trop précipité. Ce mouvement admirable, le premier grand des sonates achevées de Schubert, supporte mal la bousculade, la reconstruction de la forme a posteriori à partir d’un tumulte chaotique. Sa composante structurelle centrale est le rythme, qui unifie un matériau dont le caractère divers et même épars est remarquablement rare chez Schubert. Une pulsation claire et inexorable signe les rares grandes réussites ici, et elle manque dès les cascades initiales de doubles croches, puis dans la marche harmonique conduisant au second groupe. Lequel est meilleur, avec une belle valorisation de la voix intermédiaire, et une carrure mieux assise. L’extraordinaire développement reçoit aussi un traitement sérieux et maîtrisé, mais qui manque de nécessité absolue, comme l’irruption du grand chant en mi, qui touche, mais ne regarde pas vers l’infini. Tout cela n’est certes pas mauvais, mais est trop nerveux, et trop nimbé d’en pédale, quand cette musique est si terrienne. La suite est meilleure, indéniablement. L’allegretto ne se laisse pas confiner au décoratif, et le poids toujours déconcertant de la première variation en ut majeur est au rendez-vous, même si la langueur effusive du chant n’est pas très marquée. La grande variation en si mineur prend son temps et se montre d’un sérieux remarquable. Le dernier retour du thème est entaché d'une saute de concentration qui ne pardonne pas dans cette merveille d’écriture. Le finale , à l’image de l’incipit de la sonate, n’est pas entièrement maîtrisé dans les plans sonores, et on le sait piégeux à plus d’un titre, mais il est solidement présenté sur le plan discursif. Sur le second thème, Uchida met avec une oreille et un goût des plus sûrs ce qui est la signature la plus distinctive de l’originalité et de l’imagination schubertienne, déjà mûrie ici : l’art de l’installation latente dans un petit espace motivico-harmonique où les éléments sont réagencés comme par jeu ou badinage, qui produit l’accumulation de tension par dessous les figurations, eussent-elles l'air de salon. Un procédé qui annonce largement l'écriture des chefs d'oeuvres ultérieurs (notamment ceux de ce programme), et l'extrême modernité des jeux d'interpolation de petits éléments à caractère réminiscent : une esthétique du fragment qui figure celle de la mémoire fuyante, ainsi que le suggère une de ses versions les plus radicales, le lied Daß que hier gewesen((Sur le caractère exemplaire de la technique d'écriture des deux grands lieder sur des poèmes de Rückert, en lien notamment avec celui de la D.960.((voir la magistrale analyse de C. Rosen dans Aux Confins du sens, pp. 125–143, et sa conclusion : Nombre de ses mélodies les plus caractéristiques n'ont plus d'impulsion intérieure, c'est l'espace qu'elles ont elles-mêmes défini qui les modèle.)). Enfin, Uchida n’ignore ni n’atténue rien du trait soudainement angoissé, et cruel de la coda.

 Uchida est un pèlerin de la Reliquie, elle qui en a livré, peut-être, l’enregistrement (1996) le plus abouti au-delà de l’intouchable (et inimitable, et en cela, hors comparaison) Richter. Elle est en tout cas la seule, sans doute, à l’avoir prise non seulement avec autant de sérieux, mais à l’avoir affrontée sans jamais chercher à contourner, décorer ou rendre ambivalent ce sérieux (au contraire de Brendel ou Schiff). Enfin, elle n’a pas non plus cherché à couler cette saine austérité dans un geste lapidaire de nature à faire passer plus vite une lave trop incandescente (comme Serkin hier, et dans une moindre mesure, Leonskaja aujourd’hui). Le confort du studio donne une consistance spécifique à l’exercice de la cathédrale sonore et discursive, mais qu’en est-il sur scène ? Le défi est beau : captiver une salle P. Boulez quasi pleine, plus de 2000 personnes, avec deux fois quinze minutes de dénuement amer, une matière pianistique plus aride et économe que dans n’importe quelle autre pièce de n’importe quelle période de Schubert (voire, de toute la musique pour piano sérieuse du XIXe siècle). Il faut imposer le silence et le temps de la lenteur, sans la majesté chorale des incipits des D. 894 ou 960, mais avec ce thème non harmonisé, aussi anodin, presque a‑thématique, qu’il est la Frage romantique (de Kerner, ou de Marguerite) incarnée, le questionnement par excellence, ou mieux, l’introduction de tout questionnement : mi-sol-mi-sol-la-sol. Le silence est autant un enjeu de qualité d’écoute que de caractérisation du matériau dans cette oeuvre. Nulle part sinon, et cela n’a rien d’un hasard, dans la symphonie du même inachèvement, Schubert ne donne-t-il une valeur rhétorique aussi importante aux pauses. Lesquelles ont aussi une force d’illusion : ils créent l’impression que les idées sont éparses, elles donnent à l’idée génératrice de tout le mouvement l’accent du fragment, alors que, à l’instar de ceux de D. 575, 625 ou 850, le moderato de la Reliquie est en réalité parfaitement monothématique. Ici, Schubert a poussé la logique intégratrice jusqu’à créer l’illusion d’une structure à deux groupes, renforcée par la modulation de la récapitulation placée à la fin du premier. Mais le plan d'architecture ample masque l'arrière-plan obsessionnel. L'autre grand défi consiste à faire sentir cette superposition, et il est relevé ici.
Uchida est un pèlerin de la Reliquie, elle qui en a livré, peut-être, l’enregistrement (1996) le plus abouti au-delà de l’intouchable (et inimitable, et en cela, hors comparaison) Richter. Elle est en tout cas la seule, sans doute, à l’avoir prise non seulement avec autant de sérieux, mais à l’avoir affrontée sans jamais chercher à contourner, décorer ou rendre ambivalent ce sérieux (au contraire de Brendel ou Schiff). Enfin, elle n’a pas non plus cherché à couler cette saine austérité dans un geste lapidaire de nature à faire passer plus vite une lave trop incandescente (comme Serkin hier, et dans une moindre mesure, Leonskaja aujourd’hui). Le confort du studio donne une consistance spécifique à l’exercice de la cathédrale sonore et discursive, mais qu’en est-il sur scène ? Le défi est beau : captiver une salle P. Boulez quasi pleine, plus de 2000 personnes, avec deux fois quinze minutes de dénuement amer, une matière pianistique plus aride et économe que dans n’importe quelle autre pièce de n’importe quelle période de Schubert (voire, de toute la musique pour piano sérieuse du XIXe siècle). Il faut imposer le silence et le temps de la lenteur, sans la majesté chorale des incipits des D. 894 ou 960, mais avec ce thème non harmonisé, aussi anodin, presque a‑thématique, qu’il est la Frage romantique (de Kerner, ou de Marguerite) incarnée, le questionnement par excellence, ou mieux, l’introduction de tout questionnement : mi-sol-mi-sol-la-sol. Le silence est autant un enjeu de qualité d’écoute que de caractérisation du matériau dans cette oeuvre. Nulle part sinon, et cela n’a rien d’un hasard, dans la symphonie du même inachèvement, Schubert ne donne-t-il une valeur rhétorique aussi importante aux pauses. Lesquelles ont aussi une force d’illusion : ils créent l’impression que les idées sont éparses, elles donnent à l’idée génératrice de tout le mouvement l’accent du fragment, alors que, à l’instar de ceux de D. 575, 625 ou 850, le moderato de la Reliquie est en réalité parfaitement monothématique. Ici, Schubert a poussé la logique intégratrice jusqu’à créer l’illusion d’une structure à deux groupes, renforcée par la modulation de la récapitulation placée à la fin du premier. Mais le plan d'architecture ample masque l'arrière-plan obsessionnel. L'autre grand défi consiste à faire sentir cette superposition, et il est relevé ici.
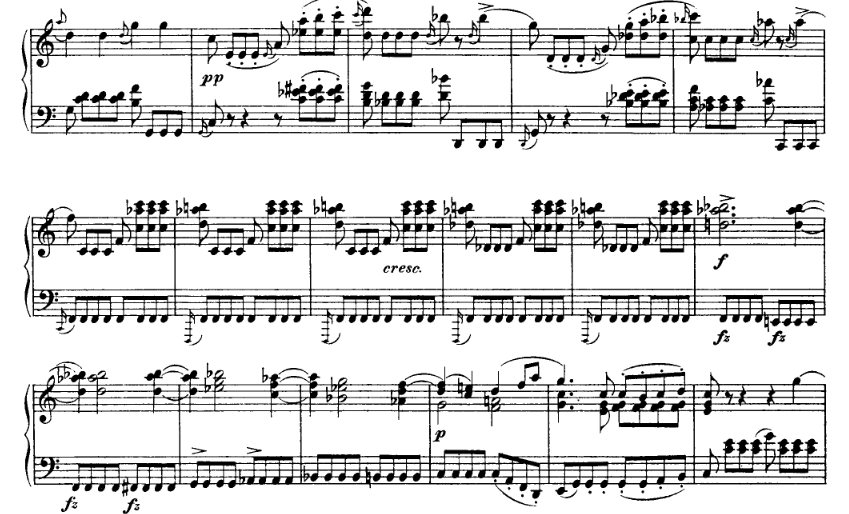 Cette variation perpétuelle sur l’aspect du même, disposée entre des interruptions qui sont autant de jeux d’ombres avec une texture déjà famélique, est le sujet essentiel de la Reliquie (de son second mouvement aussi, même s’il est construit sur une dialectique plus conventionnelle), et c’est celui qu’Uchida traite et met glorieusement en valeur. Ses tempos tout à fait retenus, et tenus (bien sûr un peu moins que Richter dans le I, mais peut-être davantage dans le II) sont employés de sorte à créer la nécessaire concentration sur le minimal, sur la dureté de la phrase. L’aération de la texture est constamment habitée d’éloquence, et parvient à ménager l’autre grand art illusoire ici dispensé : car peu d’autres mouvements de Schubert produisent tant d’apparence orchestrale, quand aucun n’use de si peu de notes. Mais cette exécution ne se contente pas d’être ascétique, et ne l’est même pas du tout : moins, en tout cas, que celle plus minérale de Leonskaja. Appliquée à cette surface lisse, la clarté de son est un atout pour mettre en relief les aspérités de discours. Les transitions sont toutes remarquables, en particulier celle suivant le climax du développement, avec sa petite marche harmonique où l’extrême désolation se confond, dans un geste typique, avec sa consolation. Plus remarquable encore est la conduite du faux second thème, notamment dans la récapitulation où Uchida rend superbement justice aux subtiles touches d’ornementation. La sophistication parfois controuvée que l’on peut lui reprocher occasionnellement se tient ici dans une stricte discipline, qui fait sentir ce qu’il y a de lancinant, de prière étouffée dans ce discours, sans donner l’impression de l’arbitraire ou de l’incertain dans l’interprétation. L’andante est une merveille de finesse d’écoute, et de souplesse de battue. La relation entre le groupe initial de trois idées et la merveille d’ariette qui le suit est loin d’être évidente, et se trouve, c’est très clair ainsi jouée, dans le fait que l’un conduit par degrés au silence quand l’autre y est liée par le caractère aus der Ferne de son émergence. De sorte que, quand l’ariette s’éteint, elle le fait en accompagnant le retour du premier thème, dans un jeu sensuellement abstrait, d’une asentimentalité troublante, impeccablement traduite par Uchida. Les deux épisodes de protestation évitent tout emportement mal placé, toute éruptivité artificielle, et au contraire semblent presque ralentir pour mieux valoriser les silences, et lier ceux-ci à l’alternance avec la mélodie infinie de l’ariette. Uchida est une pèlerine, et une pèlerine, ça chante.
Cette variation perpétuelle sur l’aspect du même, disposée entre des interruptions qui sont autant de jeux d’ombres avec une texture déjà famélique, est le sujet essentiel de la Reliquie (de son second mouvement aussi, même s’il est construit sur une dialectique plus conventionnelle), et c’est celui qu’Uchida traite et met glorieusement en valeur. Ses tempos tout à fait retenus, et tenus (bien sûr un peu moins que Richter dans le I, mais peut-être davantage dans le II) sont employés de sorte à créer la nécessaire concentration sur le minimal, sur la dureté de la phrase. L’aération de la texture est constamment habitée d’éloquence, et parvient à ménager l’autre grand art illusoire ici dispensé : car peu d’autres mouvements de Schubert produisent tant d’apparence orchestrale, quand aucun n’use de si peu de notes. Mais cette exécution ne se contente pas d’être ascétique, et ne l’est même pas du tout : moins, en tout cas, que celle plus minérale de Leonskaja. Appliquée à cette surface lisse, la clarté de son est un atout pour mettre en relief les aspérités de discours. Les transitions sont toutes remarquables, en particulier celle suivant le climax du développement, avec sa petite marche harmonique où l’extrême désolation se confond, dans un geste typique, avec sa consolation. Plus remarquable encore est la conduite du faux second thème, notamment dans la récapitulation où Uchida rend superbement justice aux subtiles touches d’ornementation. La sophistication parfois controuvée que l’on peut lui reprocher occasionnellement se tient ici dans une stricte discipline, qui fait sentir ce qu’il y a de lancinant, de prière étouffée dans ce discours, sans donner l’impression de l’arbitraire ou de l’incertain dans l’interprétation. L’andante est une merveille de finesse d’écoute, et de souplesse de battue. La relation entre le groupe initial de trois idées et la merveille d’ariette qui le suit est loin d’être évidente, et se trouve, c’est très clair ainsi jouée, dans le fait que l’un conduit par degrés au silence quand l’autre y est liée par le caractère aus der Ferne de son émergence. De sorte que, quand l’ariette s’éteint, elle le fait en accompagnant le retour du premier thème, dans un jeu sensuellement abstrait, d’une asentimentalité troublante, impeccablement traduite par Uchida. Les deux épisodes de protestation évitent tout emportement mal placé, toute éruptivité artificielle, et au contraire semblent presque ralentir pour mieux valoriser les silences, et lier ceux-ci à l’alternance avec la mélodie infinie de l’ariette. Uchida est une pèlerine, et une pèlerine, ça chante.

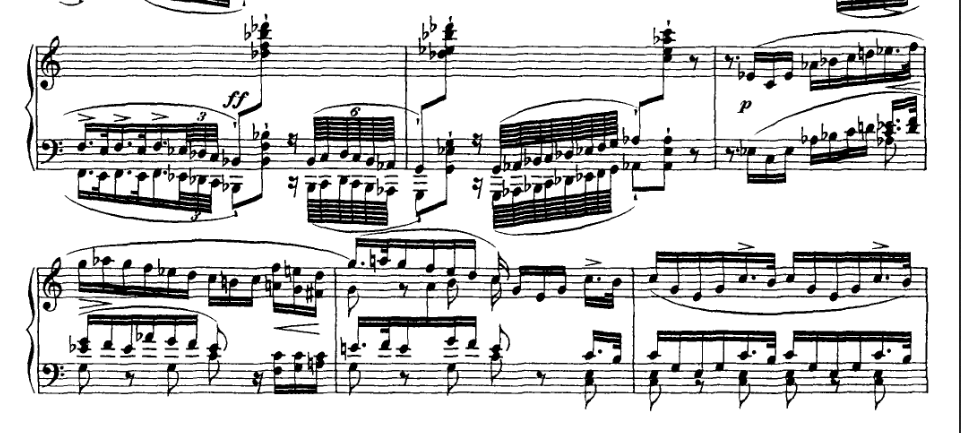 La D.960 reste une valeur sûre du répertoire d’Uchida, parce que son approche a depuis longtemps une cohérence propre, qui tient à un petit nombre de paramètres pianistiques et discursifs. Et aussi parce qu’elle est une des rares lectures à s’équilibrer autour d’un deuxième mouvement qui en est, en général, le point fort, et qui présente une confusion de l’âpreté et du recueillement tout à fait singulière. Avant celui-ci, son molto moderato brille comme à l’accoutumée par la grande subtilité de la gestion des voix, qui se distingue de l’ordinaire, une fois passé l’incipit en accords, du lyrisme épandu d’une main droite surconductrice. Le point fort d’Uchida n’étant pas la netteté de pulsation, ni l’élasticité d’articulation, c’est un choix intelligent. Ce piano n’a pas la solidité de Ranki, mais il n’est pas si éloigné des sortilèges du meilleur Lupu : même s’il n’en a pas le moelleux, il en a le raffinement polyphonique, la capacité à faire affleurer la mélodie comme strate du tissu, par-dessous l’accompagnement, puis de la faire comme voguer sur une mer instable, typiquement sur les sections les plus mobiles harmoniquement, au coeur des exposés. L’attention au silence et à la qualité de ce qui l’amène ou le rompt demeure admirable (la beauté des arpèges aigus). Le développement est de stupeurs et de tremblements, avec un bref déraillement, modérément contrariant, dans le climax. Le scherzo et le finale sont notoires par leur retenue perpétuelle, leur mise en scène discrète de l’épuisement. Uchida renonce à un grandiose qui ne lui est pas accessible dans le cantus firmus des grandes marches harmoniques du IV, mais fait toujours entendre ses miroitements concentrés, la gorge nouée. Une continuation intelligente en est le bis, un op. 19/2 de Schoenberg (décidément, trois semaines après que Leonskaja avait donné sans prévenir le cycle complet) que, comme à son habitude, Uchida joue beaucoup plus lentement que la moyenne, dans une perspective d’éclatement webernienne, qui est aussi un écho parfait à la Reliquie, comme deux visions d’un même monde hölderlinien.
La D.960 reste une valeur sûre du répertoire d’Uchida, parce que son approche a depuis longtemps une cohérence propre, qui tient à un petit nombre de paramètres pianistiques et discursifs. Et aussi parce qu’elle est une des rares lectures à s’équilibrer autour d’un deuxième mouvement qui en est, en général, le point fort, et qui présente une confusion de l’âpreté et du recueillement tout à fait singulière. Avant celui-ci, son molto moderato brille comme à l’accoutumée par la grande subtilité de la gestion des voix, qui se distingue de l’ordinaire, une fois passé l’incipit en accords, du lyrisme épandu d’une main droite surconductrice. Le point fort d’Uchida n’étant pas la netteté de pulsation, ni l’élasticité d’articulation, c’est un choix intelligent. Ce piano n’a pas la solidité de Ranki, mais il n’est pas si éloigné des sortilèges du meilleur Lupu : même s’il n’en a pas le moelleux, il en a le raffinement polyphonique, la capacité à faire affleurer la mélodie comme strate du tissu, par-dessous l’accompagnement, puis de la faire comme voguer sur une mer instable, typiquement sur les sections les plus mobiles harmoniquement, au coeur des exposés. L’attention au silence et à la qualité de ce qui l’amène ou le rompt demeure admirable (la beauté des arpèges aigus). Le développement est de stupeurs et de tremblements, avec un bref déraillement, modérément contrariant, dans le climax. Le scherzo et le finale sont notoires par leur retenue perpétuelle, leur mise en scène discrète de l’épuisement. Uchida renonce à un grandiose qui ne lui est pas accessible dans le cantus firmus des grandes marches harmoniques du IV, mais fait toujours entendre ses miroitements concentrés, la gorge nouée. Une continuation intelligente en est le bis, un op. 19/2 de Schoenberg (décidément, trois semaines après que Leonskaja avait donné sans prévenir le cycle complet) que, comme à son habitude, Uchida joue beaucoup plus lentement que la moyenne, dans une perspective d’éclatement webernienne, qui est aussi un écho parfait à la Reliquie, comme deux visions d’un même monde hölderlinien.
