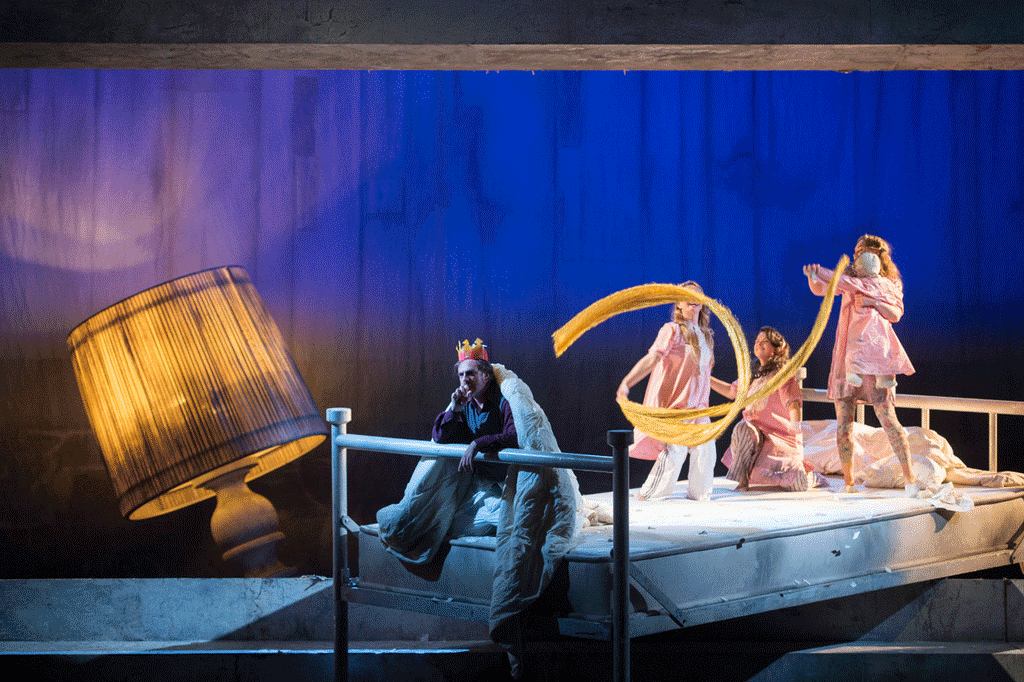
Commençons par la partie musicale, complètement nouvelle par rapport à la production initiale, dix ans auparavant. C’est Kent Nagano qui était au pupitre cette année, lui qui est depuis deux ans GMD (Generalmusikdirektor) du Théâtre. Je dirais, après l’avoir entendu dans différents opéras en Italie en version concertante ou à Hambourg, que son approche est désormais prévisible, parce qu’aspirant toujours à la plus grande clarté, à l’atténuation des contrastes, à la traduction de la complexité en la plus grande simplicité possible, à la négation de la subjectivité de l’interprète (qui cependant émerge d’une manière ou d’une autre). Mais ce qui est prévisible dans l’approche produit toujours des résultats toujours différents à l’audition.
Il était plutôt surprenant – considérant que Nagano semble bien loin d’être un fanatique du mysticisme de Bayreuth – qu’au début il ait voulu recréer les conditions de « l’abîme mystique » voulu par Wagner : l’orchestre commence le prélude dans le noir total (les lampes des pupitres sont éteintes et les musiciens jouent par cœur) et la musique se répand dans la salle et l’entoure sans qu’on puisse en deviner la provenance. C’est un son naturel primal, au départ presque imperceptible, comme demandé par Wagner lui-même. Nagano en fait un son très léger, impalpable, transparent, presque debussyste : ce n’est plus la célébration du mythe germanique primordial d’un Rhin patriarche, mais l’impression donnée par ce son pur et mystérieux demeure très marquante.
Quelque chose de semblable arrive deux heures et demi après, à la fin, lorsque les dieux montent au Walhalla. Nagano retient le plus possible les décibels, mais ce moment n’en est pas moins suggestif, mais il est différent, et, pourrait-on dire, plus purement esthétique, et pas pollué par la mystique de la puissance allemande, à laquelle certains triomphes sonores couronnés des sonneries des cuivres étaient outrageusement liés quand se déchainait le nationalisme allemand.
Entre ce début et cette fin, l’interprétation de Nagano tend au « comique », entendu comme catégorie esthétique opposée au tragique sublime. Ondines, nains, dieux et géants sont privés de leur aura mythique et réduits à des bourgeois, en corrélation avec la mise en scène de Guth, qui fut critiquée il y a dix ans pour ce motif, non pas pour avoir démantelé par une critique radicale l’appareil idéologique wagnérien, comme c’était attendu ces années-là d’une mise en scène « engagée », mais pour avoir tout noyé dans un milieu bourgeois, tranquille et apaisant.

Les filles du Rhin sont trois petites filles qui font des batailles de polochons au lit. Wotan et Fricka sont deux membres de la haute bourgeoisie industrielle et les prodiges qui se passent sont des illusions créées par les bouffées de vapeur qui sortent des machines.
Tout ou presque est réalisé avec du métier et avec un sens efficace du théâtre, mais l’impression qui se dégage est celle d’une mise en scène qui se contente d’illustrer l’action, avec la juste dose de scepticisme et d’ironie, transposée à l’époque moderne, comme l’exigent les conventions théâtrales du jour. De sorte que le spectateur ne s’ennuie pas, et il s’amuse même parfois, mais le résultat final est un peu réducteur : un seul exemple, le choix de Wotan entre amour et pouvoir n’est plus un moment fondamental (pour lui et pour l’humanité), mais devient un moment transitoire sans importance.
Les chanteurs forment une équipe de bon niveau, d’où aucun n’émerge en particulier même si méritent au moins d’être cités le Wotan de James Rutherford, la Fricka de Katja Pieweck, et le Fasolt de Tigran Martirossian . Pour l’essentiel ils appartiennent aux nouvelles générations qui tendent à offrir de Wagner une interprétation objective, quasiment distanciée. Plus intense Doris Soffel, chanteuse d’une autre génération qui malgré l’atteinte des ans sur la voix, a été une Erda splendide, qui faisait vraiment vibrer la corde mythique ce cette musique.

