
Ces dernières saisons ont vu se multiplier un peu partout, dans les théâtres d’opéra de la planète, les nouvelles productions de la « Trilogie des reines », et même des directeurs de salles qui auraient jadis considéré Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux comme des œuvres indignes de leur attention s’empressent désormais de les mettre à l’affiche. Faut-il y voir le signe d’une véritable réévaluation de Gaetano Donizetti, voire d’une Renaissance. Évidemment, la France tarde à se joindre au cortège, et sans vouloir succomber au pessimisme, on peut se demander si la production de Roberto Devereux qui aurait dû être à l’affiche du Théâtre des Champs-Elysées lorsqu’a démarré le premier confinement y reviendra un jour. En France, l’œuvre du compositeur semble toujours se résumer au trio Lucia – Don Pasquale – Elisir, complété de loin en loin par La Fille du régiment et La Favorite ; ne s’y ajoutent guère, à l’occasion, que Viva la mamma ! ou, plus exceptionnellement encore, Lucrezia Borgia. Presque deux siècles après la création parisienne d’Anna Bolena, alors que ce titre doit revenir pour un concert en avril prochain au TCE, la situation de Donizetti pourrait-elle évoluer ? Comme le rappelle et le montre en détail l’ouvrage de Stella Rollet récemment publié par les Classiques Garnier, les relations du Bergamasque avec la France n’ont jamais été sans nuages.
Docteure en histoire, professeur dans le secondaire et chargée de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Stella Rollet a soutenu en 2012 une thèse en Histoire contemporaine intitulée Donizetti et la France, histoire d’une relation ambiguë (1831–1897). Près de dix ans après, son travail a perdu son sous-titre dans sa version destinée au grand public, mais n’a rien perdu de la rigueur avec laquelle la chercheuse a mené son enquête en se fondant sur le dépouillement méthodique de la presse française de l’époque. Du travail présenté dans le cadre de l’obtention du doctorat, on retrouve la sacro-sainte division en trois parties. La première suit chronologiquement la période envisagée, dont les bornes sont claires : 1831 est l’année où est pour la première fois représentée une œuvre de Donizetti en France, Anna Bolena au Théâtre-Italien, tandis que 1897 voit la commémoration (ou plutôt la non-commémoration, faudrait-il plutôt dire) du centenaire de la naissance du compositeur, presque un demi-siècle après sa mort en 1848. La deuxième retrace le processus par lequel un opéra pouvait voir le jour à Paris au XIXe siècle, depuis les premières négociations jusqu’à sa création scénique. La troisième étudie, chiffres statistiques à l’appui, l’ampleur et la durée du succès de Donizetti en France, en fonction du nombre de représentations et des recettes récoltées par les théâtres, ainsi que la carrière posthume du compositeur.
La première partie se présente donc comme un rappel utile pour ceux qui ne sont pas familiers de la dernière décennie créatrice de Donizetti, décennie bien remplie mais au terme de laquelle le compositeur est rattrapé par une syphilis cérébro-spinale qui, après avoir peut-être causé la mort de son épouse et de ses enfants, le frappe sous la forme d’une attaque cérébrale en août 1845. En 1840, Donizetti semble pourtant omniprésent sur les scènes parisiennes, ce qui lui vaut notamment l’hostilité de Berlioz, organisateur d’une cabale dénonçant cette invasion, sans oublier le procès intenté par Victor Hugo, qui voit d’un très mauvais œil l’opéra portant le même titre que sa Lucrèce Borgia (Verdi s’attirera lui aussi les foudres hugoliennes à cause d’Ernani et de Rigoletto). En quelques années, le Bergamasque a réussi à s’imposer là où d’autres rêveraient d’être admis, grâce à trois types d’œuvres, comme l’explique la Revue et gazette des théâtres en octobre 1843 : les « nouveautés neuves », compositions encore jamais entendues ailleurs, commandes de l’Académie royale de musique ou de l’Opéra-Comique, les « nouveautés moins neuves » bien que récemment créées dans d’autres pays, et les « nouveautés vieilles », connues de longue date dans le reste de l’Europe. Donizetti devient pour les théâtres l’un des « en-cas » aptes à fournir des œuvres en très peu de temps chaque fois que le dieu vivant Meyerbeer tarde à remettre ses partitions. Quand la maladie se déclare, la famille du compositeur entreprend une lutte contre ses « amis » parisiens, d’abord pour obtenir de le ramener dans son pays natal, ensuite autour d’une partition très convoitée, celle de l’opéra Le Duc d’Albe, commandé par l’Opéra de Paris mais qui, sans cesse repoussé, ne vit finalement jamais le jour sur cette scène (cette œuvre inachevée car pillée par Donizetti lui-même, ne fut créée qu’en 1882, en version italienne, à Rome). Survenue le 8 avril 1848 à Bergame, la mort du compositeur ne suscitera pas grand émoi à Paris, où un récent changement de régime occupe davantage les esprits.
La deuxième partie du volume nous plonge dans les tractations généralement inconnues du public : contrats, rémunération, clauses de dédit, accords négociés avec les directeurs de théâtre et avec les éditeurs de partitions, relations avec les librettistes et avec les traducteurs de livrets, profession très importante à une époque où les théâtres français ne montent que des œuvres en français (Lucia di Lammermoor n’est donnée qu’au Théâtre-Italien, partout ailleurs, on entend Lucie de Lammermoor, sur un texte de messieurs Vaëz et Royer). On découvre les exigences de Scribe, qui dicte sa loi en termes de progression dramatique, mais se soumet volontiers à celles de Donizetti quant au nombre de vers que doit compter tel ou tel air, sans oublier les changements exigés par le directeur de l’Académie royale de musique, Léon Pillet, qui ne fait que transmettre les exigences de sa maîtresse et diva en titre, Rosine Stoltz, pour qui Donizetti doit notamment adapter à une voix de contralto le rôle principal de L’Ange de Nisida quand cette commande du Théâtre de la Renaissance est « récupérée » par l’Opéra de Paris sous le titre de La Favorite. On apprend que les retards dans la création d’œuvres pouvaient alors tenir aux décorateurs, incapables de fournir leurs toiles peintes dans les délais prévus.
La dernière partie du livre est sans doute la plus originale et la plus instructive. Grâce à ses recherches, Stella Rollet y est en effet en mesure d’analyser au plus près la réception de Donizetti, de nuancer la légende des fiascos et des triomphes. On apprend ainsi que le succès du compositeur a connu différentes phases, variables d’un théâtre à l’autre. Au Théâtre-Italien, l’astre d’abord éblouissant de Rossini connaît un déclin régulier tout au long du XIXe siècle, Bellini fait presque figure de feu de paille, tandis que Donizetti se maintient malgré l’ascension de Verdi. Don Pasquale n’est pas le triomphe incontesté que l’on croit parfois (le compositeur avait tenu à ce que l’œuvre soit donnée en costumes contemporains, ce qui a pu nuire à son succès). A l’Opéra de Paris, où Lucie de Lammermoor et La Favorite, œuvres jugées trop courtes, sont toujours données en lever de rideau, généralement complétées par un ballet (le couplage Favorite- Coppélia est le plus fréquent à partir de 1870), La Favorite reste longtemps un des piliers du répertoire, en troisième position après Les Huguenots et Faust. Après 1863, Donizetti ne connaît plus le même engouement, et devient franchement démodé après 1875. Quant à l’Opéra-Comique, La Fille du régiment, dont la presse s’était d’abord demandé s’il s’agissait bien d’un authentique opéra-comique français, finit par y être adoptée, se transformant en œuvre patriotique très appréciée au lendemain de la guerre de 1870 et pendant la Première Guerre mondiale.
Ce que montre aussi Stella Rollet, c’est que la critique musicale aime à s’appuyer sur des « œuvres-étalons », à l’aune desquelles est jugée chaque nouvelle production du compositeur. Brièvement considéré comme un chef‑d’œuvre, Anna Bolena a très vite été supplanté dans ce rôle par Lucia. Autour de Don Pasquale s’est construit le mythe de la facilité de Donizetti, simple « improvisateur » ayant le « génie de l’imitation » ce qui l’aurait conduit à « bâcler » bon nombre de partitions. La multiplication des caricatures confirme la popularité, certes éphémère, dont le compositeur jouit dans les années 1840, lorsqu’il est représenté juché sur une locomotive, « fabriquant à la vapeur une multitude de partitions dans tout l’Univers et mille autres lieux ». Si Verdi peut avoir été hanté par le modèle de La Favorite lorsqu’il dut répondre aux commandes de la Grande Boutique, Gounod se verra taxé de lamentable donizettisme lorsqu’il y proposera son ultime opéra, Le Tribut de Zamora, en 1881. Aux côtés des compositeurs influencés par Donizetti, Stella Rollet mentionne aussi les apparitions de ses ouvrages dans la littérature (Madame Bovary bien sûr, mais aussi, de façon beaucoup plus épisodique, Béatrix de Balzac ou Une page d’amour de Zola) ainsi que les parodies de ses opéras ; dans la mesure où le volume est préface par Jean-Claude Yon, co-directeur de la thèse, on s’étonne que ne soit pas évoqué l’hommage irrévérencieux d’Offenbach à La Favorite dans La Périchole, la citation de Lucia dans Le Pont des soupirs, ou même le trio « italien » de Monsieur Choufleuri. Signalons au passage quelques coquilles (« Layla Gencer »), notamment dans la transcription de titres italiens (« Elisabetha al castello di Kenilworth »), et l’omission du mot « hélas » qui ampute de deux pieds l’un des alexandrins du poème écrit en 1853 par Hippolyte Lucas.
A la lecture de cette riche étude, on se prend à espérer que le bon quart de siècle qui doit encore s’écouler avant 2048 laissera à la France le temps de se préparer dignement aux commémorations du bicentenaire de la mort de Donizetti, si elles ne sont pas occultées par celles de la Révolution survenue la même année.
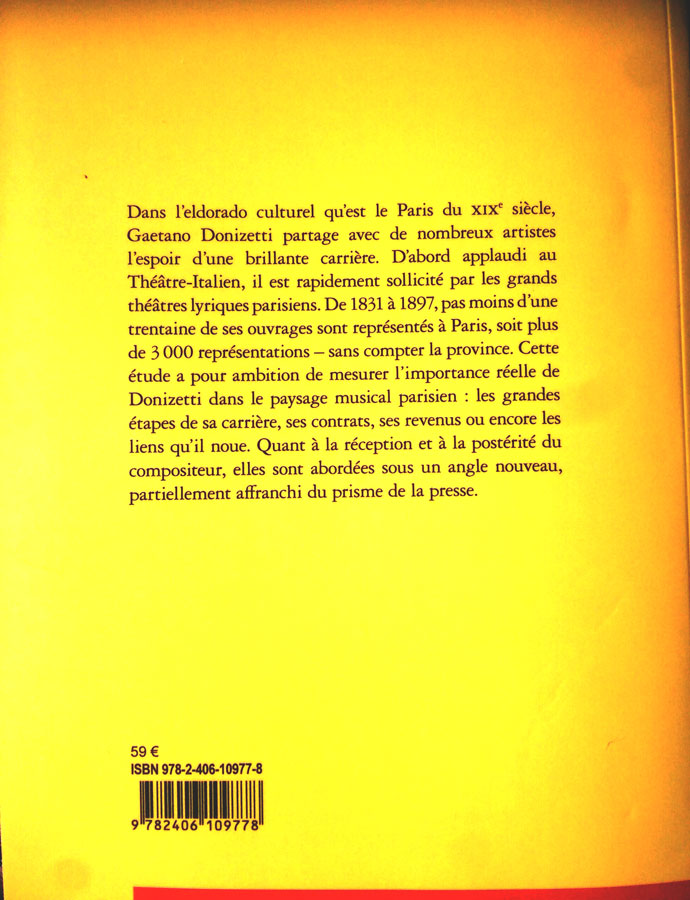
Stella Rollet.
Donizetti et la France (1831–1897). Carrière, créations, réception.
Classiques Garnier. 536 pages.
ISBN 978–2‑406–20977-
8. Avril 2021, 59 euros.
Comme Rossini, comme Verdi, Donizetti composa plusieurs œuvres pour Paris, où il vécut même plusieurs années. Ayant soutenu sa thèse dix ans après celle que Chantal Cazaux avait consacrée à la « trilogie anglaise » du compositeur, Stella Rollet s’appuie sur d’impressionnantes recherches dans la presse du XIXe siècle pour reconstituer le parcours français du père de Lucia di Lammermoor.
Autres articles
