Amuse-gueule astucieux, l’orchestration par Colin Matthews du duo de jeunesse de Debussy a trouvé en Mikko Franck un défenseur appliqué, puisqu’avant de le programmer en concert il en a effectué le premier enregistrement il y a peu, en complément de L’Enfant et les sortilèges et de L’Enfant prodigue. La partition, présentée avec clarté et dynamisme, s’intègre sans peine dans la logique d’ensemble du concert, flattant la vague nationaliste symphoniste début de siècle. C’est que, à l’instar d’autres pièces du jeune Debussy, le duo en si mineur exprime sa fascination-répulsion pour la tradition germanique d’une façon singulière : en exposant son pathos slavophile. Celui-ci se présente non sans un côté carte postale et un brin cliché, encore que le matériau soit charmant et homogène. L’ennui est cependant que l’orchestration de Matthews appuie inutilement le trait naïf de celui-ci, à grands renforts de doublures et d’interventions de cuivres droit sorties d’une symphonie de Glazounov. Il n’est pas évident que Debussy aurait orchestré son oeuvre de la sorte s’il l’avait fait, encore que, par définition, le savoir retirerait tout intérêt à l’exercice lui-même. Quoi qu’il en soit, cette petite symphonie de Glazounov fut défendue avec tout le caractère et l’enthousiasme possibles, et même un brin d’aristocratie.

Le style Rachmaninov de Buniatishvili n’a jamais été très aristocrate, du moins selon le modèle historique. Son jeu dans cette musique est en un sens à l’image de son slavisme russophobe : d’émigration très extérieure, du moins en général – dans ses diverses moutures torrentielles et quelque peu migrainogènes du Rach3. Cependant, les choses sont plus subtiles ici à tous égards. Si son interprétation du concerto en ut mineur s’éloigne à coup sûr de la tradition soviétique et post‑, telle qu’elle s’incarne aujourd’hui dans le canon luganskyen, elle n’épouse pas pour autant de quelconques clichés technicolor et surtout, ne manque pas de surprendre en évitant soigneusement toute surenchère – et même enchère – tonitruante. C’est au fond une approche assez rare, sorte de compromis entre le recours à une certain picturalité de l’interprétation et un allègement de trait suffisant pour éviter une succession de clichés. Le premier mouvement, en ce qui concerne la soliste, est intégralement joué en demi-teintes et en modestie dynamique. La conséquence inévitable est qu’il ne vaut que pour ses sections solistes, les traits d’accompagnement de tutti ou la progression vers le climax central étant à ce jeu complètement étouffés par un orchestre au volume pourtant bien tenu par Mikko Franck. Il est physiquement impossible de jouer un concerto dans cette acoustique sans jouer au minimum forte, et le plus souvent au-dessus, voilà qui est une fois pour toute entendu, si l’on ose dire. Au moins devine-t-on çà et là que le jeu de la prodige géorgienne, auto-maltraité par ses multiples concessions au spectacle depuis quelques années, n’a rien perdu de ses qualités intrinsèques – le legato non fabriqué, la franchise et la vitesse d’attaque sans raideur, l’oreille qui conduit les deux mains.
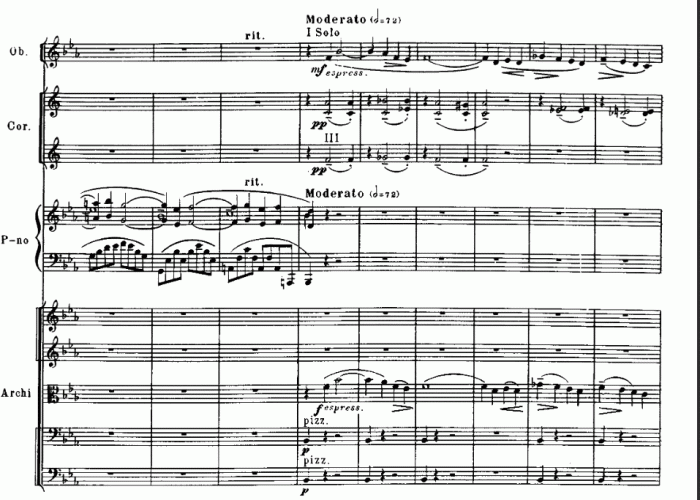
Le mouvement lent donne un relief plus satisfaisant aux qualités déjà entrevues. Sans beaucoup de concessions à l'afféterie, Buniatishvili convainc sans peine et surtout dans l’accompagnement des solistes, parmi lesquels s’illustre spécialement la clarinette de Baldeyrou, comme souvent d’une rare intensité maîtrisée. Emmenés par Virginie Buscail (le Philhar se cherche toujours des supersolistes stabilisés), les premiers violons réussissent remarquablement le trait le plus délicat du concerto – la première phrase de la récapitulation, où il est bien difficile d’obtenir un phrasé franc et une sonorité nette et non huileuse. Dans une moindre mesure, la remarque s’applique au second thème du finale, et c’est avec les mêmes vertus d’immédiateté et de netteté que ce dernier est traité. On peut certes noter la dissymétrie d’esprit et de phrasé entre orchestre et soliste, mais celle-ci, qui est assez courante, n’affecte pas la continuité d’ensemble. En fait, le cas fait partie des thèmes concertants dont le traitement diffère naturellement selon qu’il soit exposé ou repris, le caractère d’exposition ou de répétition se transmettant aux instrumentistes concernés. On reçoit volontiers un genre de noble recueillement de la part de l’orchestre ici, et quelque chose de beaucoup plus libre et rhapsodique, sinon d’allégé, de la part du piano : et c’est ce qui est fort bien présenté ici. L’entrée de la majestueuse mélopée en fa mineur frappe d’autant mieux que les aspects plus matériels y concourent tous. Voici typiquement une musique qui sonne à Radio-France, car l’acoustique valorise l’opposition entre pizz et tenues, la rapidité d’impact et la spatialisation, et magnifie les alliages simples, comme ici celui entre altos et hautbois solo. Celui d’Hélène Devilleneuve resplendit comme à son habitude, ou presque : on remarque au timbre un changement d’instrument que confirme l’intéressée : un petit événement que ce changement, le premier depuis 20 ans que la hautboïste donne au Philhar une grande partie de son identité sonore. Le nouveau Buffet-Crampon amène à l’évidence un surcroît de puissance, que sa propriétaire devra peut-être canaliser. Sa couleur chaude et très dense, assez “masculine”, tire vers le cor anglais dans le registre médium et grave. On gage avec envie que le son d’orchestre et le plaisir des auditeurs y gagnera.
Le finale ayant par ailleurs posé les mêmes insolubles difficultés d’équilibre que le premier mouvement, on ne s’étendra pas davantage sur la prestation de Buniatishvili, qu’on aura surtout vue se dérouler sans indélicatesse d’aucune sorte, et sans le moindre effort apparent. En direct à la radio, le choix de ne pas même mener le combat dynamique peut se défendre, et l’on peut penser qu’il s’est fait au profit d’un public plus nombreux, celui branché sur le poste. Un auditeur présent aux deux concerts indiquait que le lendemain, au concert donné au profit de l’UNICEF, Buniatishvili avait sérieusement monté dans les décibels. Son bis, le Clair de lune de la Bergamasque, est à l’image d’une carrière insaisissable, commençant dans un miroitement de sensualité sonore bien mis à profit pour faire affleurer le chant, avant que l’avancée ne s’interrompt dans une écoute de plus en plus artificielle et de moins en moins intuitive, tombant dans les travers de la stance extatique et éthérée : en somme, le même déroulement affriolant puis navrant des Reflets sur l’eau de Trifonov.
Le retour de Mikko Franck à Sibelius était sans doute plus attendu que d’ordinaire par les fidèles inconditionnels parisiens du compositeur, dont l’appétit sibélien est mieux satisfait sans doute qu’il y a vingt ou trente ans, mais demeure largement frustré. Sauf erreur, la 3e n’avait été donnée à Paris que deux fois au cours des dix (et probablement des quinze) saisons dernières : lors de l’intégrale de Salonen/Los Angeles à Pleyel en 2007 (une splendeur), et par Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris il y a deux ans à la Philharmonie (une franche réussite et sans doute un des moments marquants de cette collaboration). Franck apporte sa pierre à cet édifice trop modeste, sans surprendre ni provoquer de choc comparable à ses plus grands concerts, mais en imposant ses qualité les plus personnelles : patience dans la construction, clarté du mètre et de l’articulation, recherche du phrasé et de la respiration naturels. Bien entendu, ces vertus sont cardinales partout et surtout là où l’accent et l’esprit de la musique tendent le plus vers le classicisme – au sens de la forme musicale mais aussi de l’idéal culturel. Et l’enjeu du classicisme est souvent incompris dans le cas de la plus mal-aimée des symphonies de Sibelius. Loin de réduire celle-ci à un simple aspiration à la modestie ou à l’épure, il est le théâtre d’une manoeuvre décisive pour la contribution du compositeur à la modernité. En renonçant aux surenchères chromatiques et descriptives du post-romantisme, Sibelius se donne les moyens de construire le cycle symphonique d’une vie : il le fait en allant à des préoccupations formelles simples, et en inventant un rapport personnel à la tonalité, formulant une de ses réinventions linguistiques les plus convaincantes de l’époque. Dans la quête d’une forme symphonique de nouveau transparente à elle-même, et sans recours aux adjuvants du poème symphonique, Sibelius fait un pas vers un langage apte à reconquérir son autonomie à l’égard des images et des mots, et comme Schoenberg il y parvient en imposant un style générateur de sa propre syntaxe : on est encore bien là dans l’idéal classique, et non néo-classique dans lequel l’un basculera au moment exact où l’autre se murera dans le silence. C’est dans la 3e que sont tous en germe le “cubisme” thématique de la 4e, les techniques de fondus enchaînés des 6e et 7e.

Le finale est certainement une des plus originales, grandioses et ingénieuses inventions sorties de l’esprit de Sibelius, au même titre que le premier mouvement de la 5e et l’unique de la 7e. C’est aussi, pour les mêmes raisons, une des ses pages les plus difficiles à réussir. La partition regorge de traits périlleux pour les musiciens, et surtout, la clarté de vision et la technique de direction du chef y sont testées à un rare degré d’exigence. C’est dans ce mouvement que Franck se montre sous son meilleur jour, faisant paraître le texte presque facile, du moins ses articulations évidentes. Ses facultés de détendre les musiciens et de toujours faire sentir le rythme avec naturel sont ici précieuses. Ses tempos sonnent justes et leurs changements sans brutalité, et sans trop d’indécision. Cette fluidité de transitions est presque excessive dans le finale en ce qu’elle le tire franchement vers le vertige de la 7e. En ce sens, Franck diverge nettement de Järvi dans cette page, où l’Estonien passait, comme il en a l’habitude, en brio et quelque peu en force, valorisant l’excitation du crescendo hymnique final. Le Finlandais se sent peut-être plus tranquille chez lui et prend le temps de détailler les articulations, de laisser les épisodes introductifs musarder ; et son accélération dans la dernière ligne droite reste modérée, et soucieuse de préserver le caractère cumulatif de l’architecture, oscillant, après avoir tournoyé, autour de la tonalité. Il ne manque pour une pleine réussite qu’un degré de familiarité des musiciens avec elle, notamment pour caractériser autant qu’il se doit les traits d’harmonie. Les solistes du Philhar s’en tirent avec les honneurs, mais un accident d’entrée de flûte au début de la réexposition du II trahit l’incertitude du terrain. Si le sérieux est indéniable dans ce joyau pastoral, l’émotion y trop limitée – et qu’elle peut être grande ici. Le premier mouvement, qui pose moins de difficultés dès lors que la baguette est experte, n’est lui que force et joie pures. Le chef y démontre son sens de la retenue libératrice d’énergie, qui fait merveille dans la longue préparation de la récapitulation, laquelle brise la glace comme une éruption souterraine. Cette force primale de la nature domestiquée dans une forme aussi stricte que sophistiquée est la singularité de cette musique à nulle autre pareille : comme Paavo Järvi avec des moyens différents, Franck démontre qu’il est peu de symphonies de cette époque où la réexposition de l’allegro contient une telle charge de théâtralisation formelle, un tel classicisme épique, analogue à celui du passage correspondant dans l’Eroica ou la 1ère de Brahms - deux symphonies où Franck avait convaincu. Cette 3e restera comme une étape importante de son parcours sibélien avec le Philhar, par le prix de la rareté mais aussi parce que s’y maintenait le niveau d’exigence de ses En Saga, Tapiola, et de ses symphonies n°2, 7 et presque de sa magistrale 5e.

