
Étrange Don Juan de Molière, sans intrigue, sorte de course d’une rencontre à l’autre où se dessine un portrait au total contrasté de méchant et de gentil homme qui ne cesse (encore plus chez Bluwal) d’observer en silence les autres se déliter par la simple force ou faiblesse de leur parole.
Bluwal utilise les compétences de cavalier de Michel Piccoli et le fait chevaucher pendant bonne partie de l’œuvre, à la poursuite de quelque femme (ou de quelque chimère). Cela accentue cet effet de course un peu désespérée qui va devenir course à l’abîme en ce dernier jour de la vie d’un condamné. À ce titre Claus Guth mettant en scène le Don Giovanni de Mozart avait imaginé Don Giovanni blessé mortellement dans le duel contre le Commandeur et vivant dans la jouissance les quelques heures encore permises…
C’est cette hâte que Bluwal perçoit et met en scène, dès le début, d’où une présence permanente du cheval, l’animal noble, l’animal aristocratique, chevauché par des cavaliers qui peuvent être cavaliers de l’Apocalypse. Le mythe du cavalier en mouvement, très cinématographique, convient bien à ce Don Juan à la bougeotte. Ce film est d’abord une course éperdue.
Alors entre chimère et course à cheval vient immédiatement à l’esprit l’autre héros espagnol, l’autre Don, Don Quichotte, moins méchant et moins dangereux peut-être, mais lancé lui aussi dans une course au néant. Il y a entre Don Juan/Sganarelle et Don Quichotte /Sancho Panza quelque chose comme une parenté. Deux couples de comédie dramatique où chacun se bat contre ses moulins. On y pense irrémédiablement lorsqu’on voit dans le film le couple Don Juan/Sganarelle aller lentement à cheval dans les routes forestières, comme sans but et devisant « philosophie »…
A chaque scène son espace, et Bluwal respecte les didascalies du texte, qui ne respectent pas du tout l’unité de lieu : c’est d’abord l’espace privé de Don Juan, (en l’occurrence le Trianon Palace de Versailles), puis des écuries (les écuries de Chantilly), puis la forêt, puis la plage (le texte indique pour la rencontre des paysannes : le théâtre représente une campagne, au bord de la mer, non loin de la ville) car la pièce n’est faite que de rencontres, ou plutôt de situations qui montrent au spectateur à chaque fois un pan du caractère et du statut de Don Juan, un Don Juan aristocratique représentant sa classe et les valeurs de domination qu’elle porte (avec les paysannes, avec le pauvre, avec Monsieur Dimanche, avec Don Carlos) : dans ces situations il reste dans l’ensemble imperturbable, distant, peu disert (il est défini par les autres plus qu’il ne se définit) et quelquefois actif (lorsqu’il défend Don Carlos). Cette dramaturgie du passage est le caractère d’une pièce sans intrigue, sinon cette exposition permanente d’un Don Juan qui passe ou qui galope comme pour une course à l’abîme, une sorte de démonstration ou chaque personnage qu’il rencontre est vaincu par une pirouette ou une attitude, ses plus longues tirades, il les réserve à Sganarelle, qui n’est pas son double, mais presque un chœur antique maladroit qui commenterait chacun de ses actes ou des situations : ainsi de Done Elvire au début, venue demander des explications et qui assomme le spectateur (et Don Juan et Sganarelle par la même occasion) d’une logorrhée verbale qui ne la quittera jamais ce qui d’une part laisse le temps à Don Juan de préparer sa réponse, et d’autre part fait d’une certaine manière que le personnage s’autodétruit, parfaite scène de comédie où après une longue tirade protestations où elle a donné toutes les réponses à toutes les questions, elle demande enfin « Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez-vous justifier ».
De fait, Don Juan parle peu : ce sont les autres qui parlent, et qui en parlant, la plupart du temps se détruisent, en premier lieu évidemment Sganarelle, modèle du genre, mais aussi évidemment Monsieur Dimanche, éconduit par Don Juan et par Sganarelle, sans parler de Don Carlos que Don Juan regarde mi amusé mi agacé en venir presque au duel avec Don Alonse à son propos, ne se privant pas tout de même d’apprécier la nature chevaleresque du personnage.
Et Bluwal se concentre essentiellement sur le visage impassible de Don Juan et sur son regard à la fois pénétrant et distancié, tandis que Sganarelle reprend sans cesse une parole impossible à prendre au sérieux (voir le discours qu’il lui tient sur l’homme et la nature, à cheval d’où il tombe, dans la forêt) tout en abordant des problèmes métaphysiques qu’il ne maîtrise pas, comme si Platon était défendu par Trump. C’est d’ailleurs Sganarelle – le clown- qui porte tout le discours sur le Ciel, c’est à dire dans ce couple étrange qu’il forme avec Don Juan c’est le personnage qui débite des absurdités ou des lieux communs à qui Molière donne cruellement la défense du Ciel (et personne ne saurait se vanter de m’avoir jamais rien appris …avec mon petit sens, mon petit jugement…). J’évoquais plus haut le chœur antique parce que Sganarelle représente en somme ce que Offenbach appellera l’Opinion publique, une sorte de bon sens fait de clichés et de vérités (mal) révélées. Sganarelle (formidable Claude Brasseur, alors âgé de 28 ans) est d’une certaine manière celui qui représente à lui seul tous les autres, sur lequel Don Juan essaie son discours et son pouvoir. Sganarelle est ainsi obligatoire pour un Don Juan qui défie la morale publique et religieuse : il lui renvoie exactement ce qu’il attend. D’où ce perpétuel dialogue aussi amusant qu’inutile, comme celui sur les médecins où l’habit fait le moine…Car la question très baroque de l’être et l’apparence est avec la question du Ciel l’autre question de l’œuvre, résolue à l’acte V par la conversation à l’hypocrisie.
On pourrait citer de nombreux exemples où les interlocuteurs de Don Juan s’enferrent, et où il s’en tire par un jeu, une attitude, un discours minimaliste. Et chaque situation crée une difficulté qui l’accuse ou risque de le démasquer. À chaque fois, l’autre est vaincu : avec Charlotte et Mathurine, il est en difficulté, mais il s’en tire quand même avec la pirouette habituelle. Il est par ailleurs évident que Charlotte n’aime pas (la vérité, l’être) Pierrot, qu’elle lui est promise par coutume (l’apparence) , et qu’elle est prête à se laisser séduire par le premier parleur venu : y‑a‑il si grand pêché à être l’outil révélateur de la vérité ?

C’est d’ailleurs l’une des plus belles scènes du film, sur une plage dans les dunes, au bord de l’océan. Dans un lieu naturel qui devient d’ailleurs le plus grand des artifices : les personnages paraissent infiniment petits (voir l’arrivée au loin à cheval de La Ramée qui avertit Don Juan) Ces changements de focale où le paysage devient protagoniste pour que les êtres reprennent une taille minuscule, ou au contraire où ils sont en premier plan est un jeu qui rappelle les regards pascaliens sur le monde et sur l’homme, infiniment petit ou infiniment grand. Fascinant.
Bluwal, dans ses choix de décor, essaie de coller au texte en en montrant la logique. La première scène du Commandeur, dans ce monument funéraire (en réalité la saline d’Arc et Senans) aux dimensions surhumaines (l’hybris…) fait en même temps du Commandeur, une de ses victimes, un autre des interlocuteurs vaincus par la glaciale vérité donjuanesque « Qu’on ne peut voir aller plus loin l’ambition d’un homme mort ; et ce que je trouve admirable, c’est qu’un homme qui s’est passé durant sa vie d’une assez simple demeure, en veuille avoir une si magnifique quand il n’en a plus que faire » et « Parbleu, le voilà bon avec son habit d’empereur romain ». Molière est impitoyable, non avec Don Juan, mais avec les autres, et même avec les morts. Vanitas vanitatum…
À partir de l’acte IV, les choses se précipitent. La rencontre avec la statue du Commandeur de l’acte III est annonciatrice de l’action finale, mais Don Juan qui croit que deux et deux font quatre continue ses rencontres successives où les interlocuteurs sont dans l’incapacité de le vaincre dans ces rencontres qui sont des duels dialectiques où la parole règne en dominatrice en ce siècle de rhétorique triomphante. Bluwal d’ailleurs construit son travail en une suite de ruptures de construction, on passe sans solution de continuité de la plage à la forêt ou à son hôtel particulier, sans liaison : tout se juxtapose sans logique apparente que cette course de Don Juan vers son destin .
L’apparition du Commandeur et de cette statue qui bouge et parle ne laisse d’ailleurs qu’un court moment le héros interdit, le visage de Piccoli jusque-là impassible trahit un (léger) étonnement mais bien vite il revient à des explications rationnelles, car en parfait personnage moliéresque, Don Juan reste jusqu’au bout fidèle à son système et à son credo (2 et 2 font 4), dût-il aller jusqu’au bout….
L’acte IV se déroule entièrement en un seul lieu, le palais de Don Juan, pour la scène comique de Monsieur Dimanche (doublement victime de Don Juan et Sganarelle) : une scène habituelle pour qui d’ailleurs connaît la vie de la noblesse qui se maintient par la dette, un lieu commun de la vie sociale de la monarchie depuis le Moyen âge. Dans le ton, quand Don Juan demande à Monsieur Dimanche de s’asseoir, il l’exige avec un « non ! » péremptoire et autoritaire qui tranche avec ses questions mielleuses sur la bonne santé du créancier (il n’a donc pas besoin d’être remboursé…) et la famille Dimanche que Don Juan connaît parfaitement, comme le seigneur qui connaît bien ses sujets, pour mieux les exploiter…la scène est très simplement réglée, avec un canapé, un Don Juan en chemise et très sûr de lui et un Dimanche raide, et dans l’impossibilité de placer sa requête : il est plus péremptoire avec Sganarelle (signe de sa propre lâcheté) mais sans grand effet non plus, et Dimanche sort gros Jean comme devant. Sur ce, on passe brutalement du créancier berné (qui rappelle furieusement la scène de La Bohème avec Benoît et le loyer que les librettistes Giacosa et Illica ont probablement calquée) au père outragé : Piccoli ici encore réussit à traduire un léger agacement (ou émotion) à la vue de Don Louis (excellent Lucien Nat un peu oublié aujourd’hui) qui lui donne une leçon de vertu aristocratique (des vertus qui ne sont pas tout à fait oubliées par Don Juan, voir la défense de Don Carlos) mais qui n’est là que pour préparer la seconde scène, qui détruira totalement le personnage du père. Elle est traitée par Bluwal encore avec cette discrète ironie longs plan sur Lucien Nat (quelle merveilleuse diction !) et sur le visage impassible mais tendu de Don Juan qui comprend la menace de se voir déshérité et qui commence à méditer un changement, non de vie mais d’attitude sociale.

Le sommet de l’acte reste l’apparition de Done Elvire, en habit religieux. Cette scène merveilleuse qui fait l’objet de l’Elvire de Jouvet, la leçon de théâtre tant de fois mise en scène. Une fois de plus, Elvire est prise de logorrhée verbale pour expliquer pourquoi et surtout pour qui elle reprend le voile : comme une autre grande amoureuse, Phèdre, elle blasphème sans le vouloir puisqu’elle prend le voile pour l’amour non du Ciel, mais de Don Juan qu’elle voudrait sauver. Preuve suprême d’amour que le don de soi et de son destin au service d’une cause (en l’occurrence perdue). « J’offrais tout à ce Dieu que je n’osais nommer » dira Phèdre. Nous en sommes à l’offrande amoureuse.
Même technique qu’avec Don Louis, des plans rapprochés sur les visages, la tension (magnifique Anouk Ferjac qui réussit à faire ressentir tout le discours amoureux derrière la résolution de prendre le voile). Et du côté de Piccoli, un silence et un visage qui peu à peu se détend et devient souriant. On comprend alors que l’invitation à demeurer est évidemment à double entente. Ce jeu sur les visages et notamment sur celui de Piccoli, fait d’infinitésimaux changements d’expression, de petits mouvements de bouche ou d’expressions du regard est l’un des éléments les plus étonnants de ce film. En fait et jusqu’au cinquième acte, Don Juan a des répliques mais peu de tirades (celle initiale où il expose à Sganarelle son système), il regarde le spectacle des autres.
D’ailleurs, cette tirade d’amour d’Elvire a l’effet voulu : Don Juan est effleuré par un « reste de chaleur tout prêt à s’exhaler ». Preuve que le discours d’Elvire était aussi une dernière tentative pour le récupérer y compris en Dieu, une sorte d’exposition de l’art de convaincre à la mode de la rhétorique du temps. Elle a un autre effet, car elle contribue à faire changer le personnage de tactique.
La dernière scène, où le commandeur se rend à l’invitation de Don Juan, est courte et fonctionnelle, comme les deux dernières scènes de l’acte III : elle sonne quelque chose de prémonitoire, et Don Juan malgré tout essaie de se prémunir.
Mais Bluwal, loin d’en faire une scène théâtrale et baroque, la rend un peu ridicule, de manière qu’on n’y puisse croire, laissant Don Juan dans un sursaut bravache et Sganarelle dans sa peur structurelle. Ainsi ce surnaturel-naturel est si peu crédible, avec des effets minimaux, qu’il n’effraie pas plus Don Juan que le spectateur, faisant ressortir ainsi le côté fonctionnel de ce Commandeur dont on ne sait pas grand-chose sinon que Don Juan le tua.
Alors, l’acte V est basculement. Don Juan avait d’ailleurs averti Sganarelle (IV,7 : Sganarelle, « il faut songer à s’amender pourtant… ») en effleurant l’argument, juste avant l’arrivée de la statue. Basculement que Bluwal traite par un changement de lieu, et la reprise des pérégrinations : vue d’un clocher, de cloches qui sonnent (alors que le texte de Molière indique : le théâtre représente une campagne, non loin de la ville), et la deuxième scène avec Don Louis est à l’église, où Don Juan se comporte comme en confession avec son père (chuchotements, rapprochement des deux visages et non plus duel de deux visages opposés comme dans la première scène avec son père dans l’acte IV. Ménageant théâtralement ses effets, Molière met dans la bouche de son personnage tout ce que le père et le monde attendent de lui. C’est d’ailleurs dans cet acte que Don Juan parle, à son père d’abord, en lui demandant un guide spirituel, puis à Sganarelle qui a évidemment cru à son changement (toujours croire aux apparences). Deux tirades, dont celle très fameuse sur l’hypocrisie (on songe évidemment à Tartuffe, mais un peu aussi au Misanthrope. Lucien Nat en Don Louis est magnifique d’émotion rentrée et de pudeur, mais il lâche une expression presque fatale qui justifie toute l’attitude de Don Juan « Tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre ». Il suffit de paroles pour effacer les offenses et les blasphèmes. Encore un personnage qui se détruit lui-même en prononçant simplement les mots attendus d’un monde régi par la parole et l’apparence.
Dans sa recherche chimérique, Don Juan avoue sa faiblesse, qui est de ne rien cacher – une qualité d’une certaine manière –, mais aussi une liberté que lui donnait sa classe ; au bord de la rupture (menaces du père) il va donc vivre dans l’apparence, et continuer sa vie dissolue dans la réalité. Le monde est fait pour ceux qui masquent leurs bassesses.
Le dernier plan de l’entrevue, au moment où les deux s’embrassent est la chaire d’une église, l’endroit de la parole, de la rhétorique, du discours qui semble être ce que le monde accepte comme preuve tangible d’une attitude envers le monde (on pense évidemment à Bossuet). En gérant le ministère de la parole, Don Juan pense être libéré de l’ennui que lui ont valu les différentes rencontres du jour, dont le Ciel, qui n’est qu’un personnage de plus.
Puis Bluwal montre que le personnage de Don Juan à l’évidence a changé, plus tendu, plus nerveux, plus angoissé même en affichant ce changement dans la continuité. Le monologue sur l’hypocrisie résume ce que Molière dénonce dans Tartuffe (et un peu dans Le Misanthrope)
Le scandale du monde, est ce qui fait l'offense ;
Et ce n'est pas pécher, que pécher en silence. (Tartuffe IV,5)
Mais les gens comme nous, brûlent d'un feu discret,
Avec qui pour toujours on est sûr du secret.
Le soin que nous prenons de notre renommée,
Répond de toute chose à la personne aimée ;
Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur,
De l'amour sans scandale, et du plaisir sans peur (Tartuffe, III,3)
Le discours de Don Juan est clair, il s’agit d’adopter une stratégie qui lui évite des ennuis, et mette de l’ordre dans ses affaires : tout se déroule dans un escalier rempli de tableaux d’église, annonciateurs du futur statut de Don Juan, dont le ton agressif, dont la voix irrégulière et mal dominée indique en même temps la gêne et le trouble. Don Juan cachant être Don Juan n’est pas Don Juan.
Alors, la course à l’abîme reprend, comme si ces chevauchées à travers la forêt étaient résolutives, mais on sait qu’elles ont cette fois un but, répondre à l’invitation du commandeur et aller vers sa statue. En cela Don Juan est un authentique personnage moliéresque, il balaie les doutes réels et va plutôt jusqu’au bout de ses certitudes et donc de lui-même. Et la rencontre avec Don Carlos est un dernier obstacle à cette course-là, Carlos est un gêneur. En même temps c’est la seule figure qui jusqu’ici ait trouvé grâce aux yeux de Don Juan et il y a sans contexte entre les deux un lien qui va au-delà de celui qui a vu Don Juan sauver Carlos des brigands.
Rencontre qui stoppe la chevauchée, et deuxième application de la théorie de l’hypocrisie face à un Carlos « honnête homme » qui cherche une solution honorable.
Toutes les arguties y passent, le Ciel qui ne veut pas qu’Elvire revienne avec Don Juan, Don Juan qui en reçoit du Ciel en même temps le message, comme si le destin d’Elvire et le sien avaient été scellés par le Ciel, avec la légère allusion qu’il va s’enfermer lui aussi (« petite rue écartée qui mène au grand couvent ») et le ton monte : Don Juan n’est ni Tartuffe, ni l’Onuphre de La Bruyère, c’est un mauvais hypocrite. Le ton de Piccoli, le volume changent de la voix, le regard est agacé et vaguement désespéré : grand moment de jeu. Et Carlos, honnête homme sachant distinguer le vrai du faux et surtout l’être de l’apparence (au contraire de Don Louis aveuglé par l‘amour paternel) en dénonce la manœuvre et on en arrivera au duel. Don Juan est un mauvais hypocrite, et son stratagème ne marchera pas, il n’a pas trompé Carlos, il ne trompera pas le Ciel…
Reprise de la chevauchée vers le Commandeur, avec cette fois-ci l’affichage du maniaque de « 2 et 2 font 4 » qui refuse l’irrationnel.
Bluwal est très économe des moyens (au théâtre, on voit des fumées, voire des flammes de l’enfer) ici, tout ce final baroque à souhait reste particulièrement hiératique. Un spectre à voix de commandeur, qui se transforme en tête de mort, Sganarelle qui conjure, mais plus les choses semblent étranges et plus Don Juan est décidé.

Il avance comme non plus une course à l’abîme, mais une marche au supplice Il se présente au commandeur sans armes, et monte à la statue un peu comme à l’échafaud.
Tout est si simple…il touche la main de la statue, hurle et tombe dans le tourbillon de l’Enfer, avec la musique du Requiem de Mozart (qui a été essentiellement la musique d’accompagnement de la pièce, avec trois autres pièces dont la musique funèbre maçonnique) .
La course s’achève sur le chagrin de Sganarelle et le fameux « mes gages, mes gages » lancé ici non comme un cri mais comme une plainte. La dernière réplique de Sganarelle donnant tout son sens à la disparition inutile du héros « Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles déshonorées, parents outragées, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est content… » comme si les crimes disparaissaient avec le criminel, comme si la vengeance du Ciel allégeait les peines et les outrages. La mort de Don Juan ne change rien, la vengeance du Ciel est vide de sens puisque le monde reste ce qu’il est.
Il faut souligner ici la performance extraordinaire de Claude Brasseur en Sganarelle, un Sganarelle tout autre que clownesque – à un ou deux moments près. Un Sganarelle à la fois raisonneur et incapable de proférer un discours cohérent à chaque fois qu’il essaie (et notamment après la tirade sur l’hypocrisie) puisqu’il est le seul à commenter son maître à fond. Il parle, parle sans cesse, et même le singe (scène de Monsieur Dimanche), il est le seul avec qui Don Juan parle parce que c’est sans conséquence…comme s’il « parlait à son bonnet », Don Juan sans faire-valoir n’est pas Don Juan, Don Juan solitaire n’est pas Don Juan
Ce Don Juan de Molière vu par Bluwal est évidemment un chef d’œuvre.
Pour plusieurs raisons et d’abord, parce que 55 ans après, il n’a rien perdu de sa beauté, avec ce noir & blanc fabuleux, ces paysages, ces architectures presque rêvées (Chantilly, Arc et Senans), mais aussi parce qu’il donne au texte une présence qu’il n’a pas vraiment sur le théâtre, notamment grâce à une équipe d’acteurs remarquables et à une manière de dire et d’articuler qu’on semble quelquefois avoir aujourd’hui oublié ; un texte d’une puissance d’ailleurs intacte – cette fois-ci 355 ans après, d’autant plus subversif en cette période de retour à l’obscurantisme que nous connaissons. Car c’est bien avec le Ciel que le subversif Molière essaie de régler ses comptes, laissant dans sa pièce la défense du Ciel à ceux qui sont incapables de tenir devant la puissance Don Juanesque, et en premier lieu à Sganarelle, mais aussi Elvire et les autres. Et Bluwal a parfaitement rendu les enjeux idéologiques et sociaux de la pièce. Sans doute d’ailleurs ce Don Juan, d’une certaine manière est-il plus subversif encore aujourd’hui qu’hier.
Il fait de Don Juan un cavalier qui court vers son destin, vers le Commandeur qu’il rencontre trois fois, et qui ne cesse de passer son chemin au gré des rencontres et des situations qui en arrêtent la course. Un Don Juan obsédé par la rationalité, et donc refusant jusqu’à l’absurde la superstition et l’irrationnel, refusant la repentance parce que se repentir serait croire au Ciel, dans un monde où l’hypocrisie et la parole – l’apparence- règnent. Personnage sans destin ni chemin, qui ne réagit qu’à l’immédiat de l’instinct, le Don Juan de Bluwal est certes classique, conforme à la tradition, mais la pièce est traduite avec une telle justesse qu’aucune mise en scène de théâtre ne pourra rendre la profondeur qu’il a pu rendre ici par le film.
Nous le disions au départ : Bluwal nous amène à constater l’impossibilité du théâtre à traduire le personnage avec son ambiguïté et sa complexité. On pourrait voir en Don Juan un personnage tout d’une pièce, pur produit de ce que l’aristocratie peut offrir de plus extrême, mais Piccoli en fait autre chose, il en fait un observateur des autres, son regard est en permanence à la fois glacial et implacable, ses lèvres toujours légèrement ouvertes, restent muettes, ou parlent assez peu. Quand elles parlent c’est à la fin, quand c’est trop tard et que Don Juan parle de l’hypocrisie, s’énerve, hausse le ton, s’agite, comme s’il y avait des discours impossibles à tenir pour lui. Il se jette dans l’hypocrisie avec l’énergie du désespoir ou avec le désespoir de son énergie.

Enfin il y a outre les chevauchées au son de Mozart, qui m’avaient tant marqué lorsque je vis ce Don Juan lors de son passage TV en 1965, et qui sont aussi une clef d’image du personnage et de la vision de Bluwal, la merveilleuse manière dont Bluwal traite la scène du Pauvre. Certes, Don Juan veut voir jurer le pauvre, mais plus encore, il voudrait le voir réduit à être un animal désirant son os. Un Louis d’or (somme considérable à l’époque) au bout de la main de Don Juan avec la caméra en plongée sur le visage du Pauvre, qui devient un chien affamé, un animal qui essaie de l’attraper. Réduit à l’être-animal, Don Juan joue avec et la caméra joue plongée et contre plongée, en caméra subjective, comme si elle se substituait aux yeux du pauvre. Mais le pauvre refuse de jurer et donc refuse le Louis d’or, l’animal ne l’est donc pas tant que ça, et Don Juan qui croyait que le Louis allait pousser à jurer, en est pour ses frais : autre échec du personnage immédiatement après la scène des paysannes. Il jette donc le Louis « pour l’amour de l’humanité » (évidemment pas pour l’amour du Ciel) reconnaissant du même coup sa défaite. Il a perdu au jeu. C’est une des scènes du film les plus puissantes, les plus haletantes et les plus réussies qui soient, parce qu’elle montre à la fois la considération de l’aristocrate pour le pauvre (on pense à la Princesse de Luxembourg rencontrant le narrateur et sa grand-mère à Balbec et les considérant comme « deux bêtes sympathiques » dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs.) et en même temps le refus du pauvre, qui lui rend son humanité, même avec sa superstition.
Bluwal a réussi sans artifice à donner à l’ensemble de la pièce une linéarité qu’elle n’a pas (sans doute les chevauchées y sont-elles pour quelque chose), il a donné au texte un relief incroyable au point qu’à certains moments on en redécouvre la puissance, et il a enfin donné à Piccoli une figure pour l’éternité, parce que l’acteur avait cette part de mystère et d’ambiguïté qui sied au personnage, ce mélange de glace et de braise et en même temps cette irrésistible part de noblesse, cette irrésistible élégance y compris dans l’art de se précipiter vers l’abîme : à jamais la silhouette de Don Juan collera à celle de Piccoli.
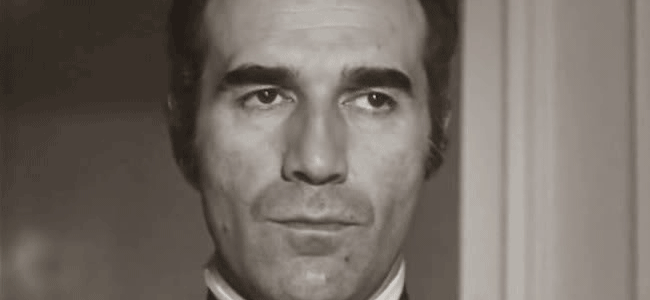

Article passionnant qui donne une folle envie de voir ce téléfilm à une époque où la télévision était tout un art !