Infos sur https://www.museemaillol.com/
Le Musée Maillol, l’une des premières institutions parisiennes à avoir rouvert ses portes après le confinement, présente depuis le 10 juin une exposition qui aurait dû être visitable du 2 avril au 26 juillet, mais qui sera heureusement prolongée jusqu’en novembre. « Esprit, es-tu là ? » a d’abord été proposé à Villeneuve d’Ascq, au LaM (Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut), auquel appartient la grande majorité des œuvres rassemblées. Il faut croire que le public parisien a besoin de titres plus racoleurs pour se laisser persuader de visiter une exposition (ce n’est pas la première fois qu’on le constate), car dans les Hauts-de-France, la manifestation présentée du 4 octobre 2019 au 5 janvier 2020 s’intitulait un peu plus sobrement « Lesage, Simon, Crépin, peintres spirites et guérisseurs ».
En mettant en avant le spiritisme, le Musée Maillol ne peut néanmoins pas être accusé de publicité mensongère, car les trois artistes réunis ont tous trois déclaré avoir pratiqué la peinture sous l’effet d’une inspiration venue de l’au-delà. Fleury-Joseph Crépin (1875–1948), Augustin Lesage (1876–1954) et Victor Simon (1903–1976) ont en commun d’être natifs du Nord-Pas-de-Calais et, pour deux d’entre eux, d’avoir été mineurs de fond pendant une période plus ou moins longue de leur vie. Se pose alors la question qui a longtemps fait débat autour des « arts premiers » : faut-il porter sur ces œuvres un regard purement esthétique, ou convient-il au contraire d’inclure une prise en compte de leur dimension spirituelle ? Après les premières salles qui évoquent le contexte historique, la naissance officielle du spiritisme vers le milieu du XIXe siècle (le mot est inventé par Allan Kardec en 1857) et l’essor du mouvement au cours du siècle suivant, le visiteur est heureusement laissé libre d’aborder les œuvres comme bon lui semble, même si les cartels rappellent à intervalles réguliers les « explications » données par les trois peintres quant à leurs sources d’inspiration. Comme Jeanne d’Arc, chacun des trois artistes a entendu des voix qui lui ont dit non d’aller délivrer Orléans mais de se mettre à peindre (encore que le message à caractère historique ne soit pas totalement absent dans le cas de l’un d’eux, on le verra). Les voix leur indiquaient quel support utiliser, quelles peintures acheter, et sans doute aussi quel sujet peindre. Ce qui n’empêche évidemment pas de rapprocher leurs œuvres de tel ou tel artiste antérieur, contemporain ou postérieur…
Le premier que présente l’exposition est aussi l’aîné des trois, bien qu’il soit devenu peintre sur le tard, et donc après les deux autres. Fleury-Joseph Crépin n’a jamais été mineur, mais fut successivement serrurier, plomber puis quincailler, tout en étant aussi sourcier, guérisseur et musicien. En 1938, âgé de 63 ans, alors qu’il recopie une partition, sa main se met malgré lui à dessiner tout autre chose que des notes. En mars 1939, ses voix lui disent « Quand tu auras peint 300 tableaux, ce jour-là, la guerre finira. Après la guerre, tu feras 45 tableaux merveilleux et le monde sera pacifié ». Impossible de résister à une telle mission, et Crépin se met à l’ouvrage, travaillant jour et nuit. Comme dans un conte de fées, il termine son 300e tableau le 7 mai 1945 ; il enverra alors un échantillon de sa production aux vainqueurs (Staline, de Gaulle, Eisenhower…). Trois ans plus tard, la mort ne lui permettra pas de mettre la touche finale à ses « tableaux merveilleux » : seulement deux seront laissés inachevés, car les inscriptions apposées par l’artiste sur ses toiles indiquent clairement qu’il commençait par en tracer le dessin avant de les peindre (plusieurs ont été tracés dès 1939 mais achevés seulement en 1946).

Crépin utilise des formats assez réduits, tantôt carrés, tantôt rectangulaires et, comme ses deux confrères, c’est un adepte de la symétrie, ce qui donne parfois à ses œuvres un faux air d’exercice décoratif, de frise pour cahier d’écolier de la Troisième République. Ses créations plus ambitieuses prennent la forme de bâtiments surréels, comme Le Temple des fantômes, 77e de ses 300 tableaux de guerre, peint en 1940, l’un des rares qu’il gratifia d’un titre. L’emploi de couleurs vives et la techniques des gouttelettes qui pointillent ses toiles leur donne une apparence délicieusement comestible, comme certains pains d’épice, les édifices qu’il représente ayant eux-mêmes souvent l’aspect du palais de dame tartine, ou de maison de la sorcière d’Hänsel et Gretel. Rien n’est moins « fou » que ces œuvres régies par un ordre implacable, qui rappellent de loin le Kandinski des années 1930, Max Ernst ou Victor Brauner.
D’un an plus jeune que Crépin, Augustin Lesage se met à la peinture dès avant la Première Guerre mondiale. En 1912, alors qu’il travaille au fond de la mine, une voix lui dit « N’aie crainte, nous sommes près de toi, un jour tu seras peintre et tes œuvres seront soumises à la science ». Croyant devenir fou, il n’ose en parler qu’à un ami mineur qui est adepte du spiritisme. Lors d’une première séance, il est désigné comme médium et, muni d’un crayon, il se met à dessiner, mais signe ces premières images « Marie », du nom de sa petite sœur morte en bas âge. Il se met ensuite à produire des œuvres sur papier, mais ses voix lui disent qu’il doit peindre sur toile. C’est alors qu’il commande par erreur une toile de 3 mètres sur 3 : quand il la reçoit, sa première réaction est de vouloir la découper, mais ses voix l’en dissuadent (l’œuvre, non présentée à l’exposition, fait désormais partie de la Collection de l’art brut, à Lausanne). Dès lors, le style de Lesage est fixé : sur des toiles d’assez grand format, il peint, en commençant par le haut, des bâtiments (temples, mausolées, etc.) au graphisme linéaire très serré et imperturbablement horizontal, dont le fourmillement décoratif aux motifs inlassablement répétés produit une fascination comparable à celle de la musique répétitive des compositeurs minimalistes américains. Au premier abord, la palette de Lesage paraît sourde, presque terne, mais dès que l’on s’approche des toiles, l’œil perçoit des couleurs innombrables, juxtaposées avec un goût moins tapageur que chez Crépin. On pense aussi aux formes décorant certains tissus, châles en cachemire ou napperons de dentelle ajourée.
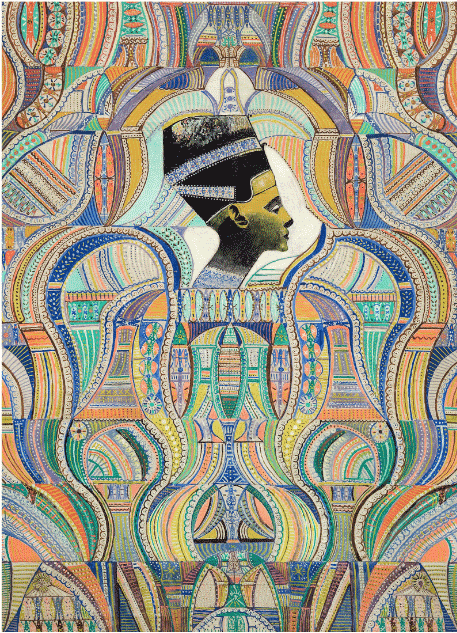
Bientôt des nez, des yeux et des bouches se glissent parmi ces architectures fantasmagoriques, puis de véritables visages, où éclate l’influence des fouilles archéologiques récentes : le tombeau de Toutankhamon, bien sûr, mais aussi les découvertes réalisées en Irak quelques années plus tard. A partir des années 1930, les couleurs deviennent un rien moins subtiles, mais la magie des formes symétriques persiste. Jusqu’à ce qu’un glaucome finisse par l’empêcher de peintre, Lesage poursuivra dans la voie égyptienne, son ultime toile étant sans doute la Nefertiti de 1952, inspirée par le célèbre buste conservé à Berlin.
Le plus jeune des trois est Victor Simon, mystique depuis son plus jeune âge, très tôt hanté par des visions, à l’instar de William Blake, ce grand ancêtre de tous les peintres obéissant à des voix surnaturelles. Après avoir quitté la mine pour un travail de bureau, Simon devient cafetier et c’est en 1933 que des voix lui ordonnent de peindre. Il adopte d’emblée le très grand format, avec de vastes rectangles de plusieurs mètres de large évoquant une iconostase d’église orthodoxe (voir La Toile bleue, 1943–44).

Lui aussi peint des architectures complexes, mélange de fragments réalistes, avec des colonnades en forme de nef d’église se terminant parfois sur une apparition du visage de Jésus, sorte de temple initiatique qui pourrait servir de décor pour une production à l’ancienne de Parsifal ou de La Flûte enchantée, et de surfaces purement décoratives, recouvertes avec une minutie de maître ornemaniste et une verve de moine enlumineur, guidées par une incontestable horror vacui. Les visages d’inspirateurs (christiques ou vénusiens) dont ses toiles sont parsemées et le choix de couleurs vives et irréalistes font penser à certains tissus imprimés africains, surtout lorsque s’y glissent des gueules de panthère comme sur La Toile judéo-chrétienne (1937). Les visages adoptent une frontalité obstinée, toujours vus de face, les yeux généralement grands ouverts ; la physionomie féminine semble un peu plus difficile à peindre pour Simon, dont les visages de femme rappellent certaines tentatives malheureuses du Douanier Rousseau. Auteur de plusieurs livres, Simon est sans doute le plus intellectuel des trois, et il fonde en 1947 un journal, Les Forces Spirituelles, qu’il dirigera jusqu’à sa mort.
Si Lesage bénéficie d’une mise en avant dès les années 1920, grâce au soutien de La Revue spirite, et expose à Paris à plusieurs reprises, y compris dans les salons les plus académiques, c’est après la guerre que les trois artistes sont véritablement révélés, lorsqu’ils suscitent l’engouement des surréalistes. En 1946, Jean Dubuffet s’éprend de l’art de Crépin, qu’il signale à André Breton, lequel consacrera au peintre un article commandé pour l’Almanach de l’art brut (mais finalement publié des années plus tard dans Combat). Au même moment, le peintre Nicolas Schöffer, adepte des techniques de « création automatique », s’enthousiasme également pour Crépin, dont il deviendra l’ami. Pourquoi une telle convergence d’intérêts un an après la guerre ? Simplement, sans doute, parce qu’en septembre 1946, la galerie Lefranc présente une exposition organisée par l’Union spirite française, où figurent notamment une quinzaine de toiles de Crépin, deux peintures de Lesage et une de Simon. Les trois artistes se connaissaient, Lesage voyant même en Simon son continuateur. Leur rencontre est évoquée dans la deuxième partie du circuit de visite, au rez-de-chaussée, où les grands formats de Lesage et Simon partagent les cimaises avec quatre œuvres de Crépin dont le géométrisme préfigure Vasarély.
Les dernières salles opèrent un retour dans le passé, avec des œuvres de personnalités fascinées par le spiritisme, comme Théophile Bra ou Victorien Sardou (qui aurait cru que l’auteur dramatique cher à Sarah Bernhardt pour qui il écrivit notamment La Tosca dessinait lui aussi des architectures fantastiques dignes du Facteur Cheval ?). Le parcours est complété par l’évocation de quelques d’artistes femmes : la médium suisse Elise Müller, dite Helen Smith, ou l’énigmatique infirmière anglaise Madge Gill. Une ouverture sur l’art contemporain est également suggérée, de manière plus ou moins convaincante : Augustin Lesage compte notamment pour émules son propre petit-fils et l’Autrichien Elmar Trenkwalder.
Les plus belles de ces œuvres sont en général visibles au LAM, qui en est propriétaire ou qui a reçu les dépôts de musées de la région (Arras, Béthune) ayant acquis des créations de ces enfants du pays. On suppose que les murs du LAM doivent être quelque peu dénudés par le séjour parisien de toutes ces toiles jusqu’à l’automne, mais on ne saurait trop recommander le voyage jusqu’à Villeneuve d’Ascq, pour découvrir le reste de la collection de L’Aracine (art brut), ainsi que l’étonnante donation Masurel où sont superbement représentés les plus grands maîtres de la première moitié du XXe siècle, et une collection d’art contemporain, le tout au milieu d’un cadre champêtre qui est aussi un parc de sculptures.
Catalogue :
Peinture spirite– Editions Fonds Mercator / Musée Maillol – Ouvrage relié – 192 pages – Textes en Français – Publié en 2020, 30 Euros

