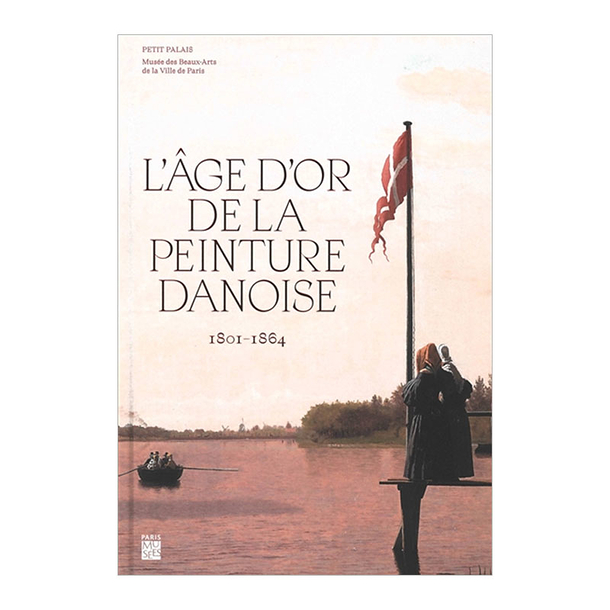Il a fallu attendre les années 1980 pour que le Musée du Louvre s’aperçoive qu’il existait dans certains pays européens, pourtant pas si éloignés de la France, des œuvres dignes d’être collectionnées et d’entrer dans nos prestigieuses collections nationales. Ont ainsi été acquises quelques toiles qui permettent de parler, au sein du Département des peintures, d’une sous-section consacrée aux « Ecoles scandinaves et russes ». En 2016, le Louvre aurait dû accueillir une rétrospective consacrée à Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783–1853), mais avait finalement laissé passer l’occasion, et c’est à la fondation Custodia que cette manifestation partie de Copenhague avait fait étape après une escale à Hambourg.

C’est avec ce même Eckersberg que s’ouvre l’exposition que le Petit Palais consacre à la peinture danoise de la première moitié du XIXe siècle, après sa présentation à Stockholm et à Copenhague en 2019. Exposition fort riche, où l’on regrettera seulement l’absence de certaines catégories d’œuvres, notamment les plus grands formats relevant des « grands genres » historiques, mythologiques et religieux. Ces toiles-là quittent rarement le Danemark, ce qui contribue à renforcer l’impression d’une peinture un peu louis-philipparde, ce qu’on appelle Biedermeier en Allemagne et en Autriche.
Biedermeier, indéniablement, ces intérieurs bourgeois d’un goût exquis, où les sobres meubles d’acajou se détachent sur des murs vert amande, où les passementeries des brise-bise se reflètent dans les miroirs, avec tapis moelleux, rideaux élégamment drapés et géraniums en pot.
Assez Louis-Philippe, ce monde paisible et harmonieux où chacun occupe sa place sans broncher, même si quelques solitaires ombrageux se mêlent à la foule heureuse. Si protestante, aussi, cette société où l’on sait tellement que l’oisiveté est mère de tous les vices qu’il faut toujours s’y activer utilement : dans La Famille Raffenberg (1830), Wilhelm Bendz nous montre la fiancée, coincée entre sa belle-mère et son futur époux, tenant à la main son tricot prometteur de « chaussettes chaudes », précise le cartel, mais on tricote tout aussi assidument à des échelons moins élevés de la société, comme le confirment le Berger du Jutland (1855) de Frederik Vermehren qui tricote debout en gardant son troupeau, et l’une des paysannes de la Scène champêtre (1848) de Jørgen Sonne qui réussit à tricoter tout en marchant et en portant sur la tête un seau de lait…
Les paysages aussi sont sereins : pas de tempêtes, pas de naufrages, pas d’orages désirés alors que nous sommes bien à l’époque où le romantisme s’affirme partout ailleurs. Pas de brumes en écho aux âmes troublées, mais des lacs étales, où la lumière projette des ombres nettes et découpe précisément les formes. Et même quand les peintres danois vont en Italie (ce qu’ils ne manquent pas de faire, surtout s’ils ont remporté l’équivalent du Prix de Rome, avec la bourse qui leur permet de se rendre à l’étranger), ils montrent une Europe méditerranéenne aussi placide que la septentrionale, certes pittoresque mais sans danger, une Calabre sans bandits, des ruines romaines presque aussi bien entretenues que la place de la Bourse de Copenhague.
On pourrait donc penser que cet « âge d’or » de la peinture danoise fut une ère, sinon de médiocrité dorée, du moins exclusivement régie par les goûts des commanditaires, soucieux d’être montrés jouissant d’une aisance méritée par leur travail ou d’admirer dans leurs salons des toiles confirmant que rien n’était pourri au royaume de Danemark. Sans ambition, alors, les Danois ?
Pourtant, si l’on revient à ce Christoffer Wilhelm Eckersberg dont il était question plus haut, on voit bien qu’un des événements de sa biographie fut le voyage à Paris qu’il entreprit pour étudier auprès de… Louis-Léopold Boilly, excellent peintre de la vie quotidienne et grand producteur de scènes de genre ? Pas du tout. Eckersberg fut de 1810 à 1813 l’élève de David, qui lui apprit les règles de l’art néoclassique le plus austère. Les quelques scènes mythologiques présentées (Œdipe et Antigone, Alcyone faisant ses adieux à Céyx) ne donnent pas vraiment l’impression que la leçon ait pris, mais c’est là que la sélection envoyée par Copenhague ne rend peut-être pas tout à fait justice à l’artiste. Voyons‑y une invitation à nous rendre au Danemark pour découvrir davantage le peintre. Et à défaut de toujours briller ici par ses propres œuvres, Eckersberg peut éblouir grâce à ses élèves à l’Académie royale des beaux-arts :

on signalera par exemple le magnifique nu sculpturalement peint en 1839 par Ludvig August Smith, sans aucun doute durant la même séance de pose qui inspira à Eckersberg sa toile Le Modèle achetée par le Louvre en 1987 et où l’on reconnaît la même Trine Nielsen dans la même position mais sous un angle différent.
Si un drame se cache pourtant dans cet âge d’or danois, c’est celui de la génération des disciples d’Eckersberg, dont les plus talentueux moururent prématurément, plusieurs années avant leur vieux maître : Wilhelm Bendz meurt à 28 ans en 1832, et l’année 1848 voit disparaître Martinus Rørbye, Christen Købke et Johann Thomas Lundbye. Comme il est vain de spéculer sur ce qu’ils auraient pu créer si leur vie eût été moins brève, on se contentera d’admirer ce qu’ils ont eu le temps de produire. De Bendz, on salue l’extraordinaire Jeune artiste regardant son esquisse dans un miroir (1826), superbe nature morte et double portrait de son collègue Ditlev Blunck, mise en abyme de leur art doublée d’une vanité au crâne.
Mais c’est surtout Købke dont la créativité multi-facettes semble dominer son temps. Depuis que le Louvre a acquis en 1995 un portrait de sa jeune sœur Adolphine, on sait quel portraitiste était Christen Købke : deux extraordinaires effigies peintes en 1832, un Vieux Marin et une Vieille Paysanne, sont d’une précision photographique et d’une intensité stupéfiante, qu’on voudrait comparer aux « monomanes » de Géricault, et ses dessins ne sont pas moins bluffants.

Mais Købke est aussi un paysagiste prodigieux, capable de splendides vues architecturales, de visions idylliques d’une nature en partie seulement conquise par l’homme, mais il se distingue aussi par les angles choisis : la tour du château de Frederiksborg saute aux yeux du spectateur, la Vue du haut d’un grenier à blé dans la citadelle de Copenhague séduit autant par l’originalité de son cadrage que par la robe rose de la sœur du peintre tranchant sur la verdure environnante, et la Vue depuis une fenêtre de Toldbodvej sur la citadelle (1833), où il montre la banalité du paysage urbain aperçu depuis son logement, préfigure tout ce qu’oseront Menzel ou les impressionnistes en matière de banalité revendiquée.
On retiendra aussi Constantin Hansen et la vérité de ses portraits d’enfants, Peter Christian Skovgaard et ses dessins toujours incisifs, d’arbres ou d’être humains. On remarquera aussi la présence d’une femme, Elisabeth Baumann, d’origine polonaise, épouse du sculpteur Jens Adolf Jerichau. Pour elle, pour eux, pour bien d’autres encore, on retournera au Petit Palais contempler ces reflets dans un œil d’or.
Catalogue :
Français
344 pages / 310 illustrations
Éditions Paris Musées
44,90 €
Dimensions : 22,8 x 33,2 x 3,3 cm
Musée : Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
EAN : 9782759604807
Référence : MX640168