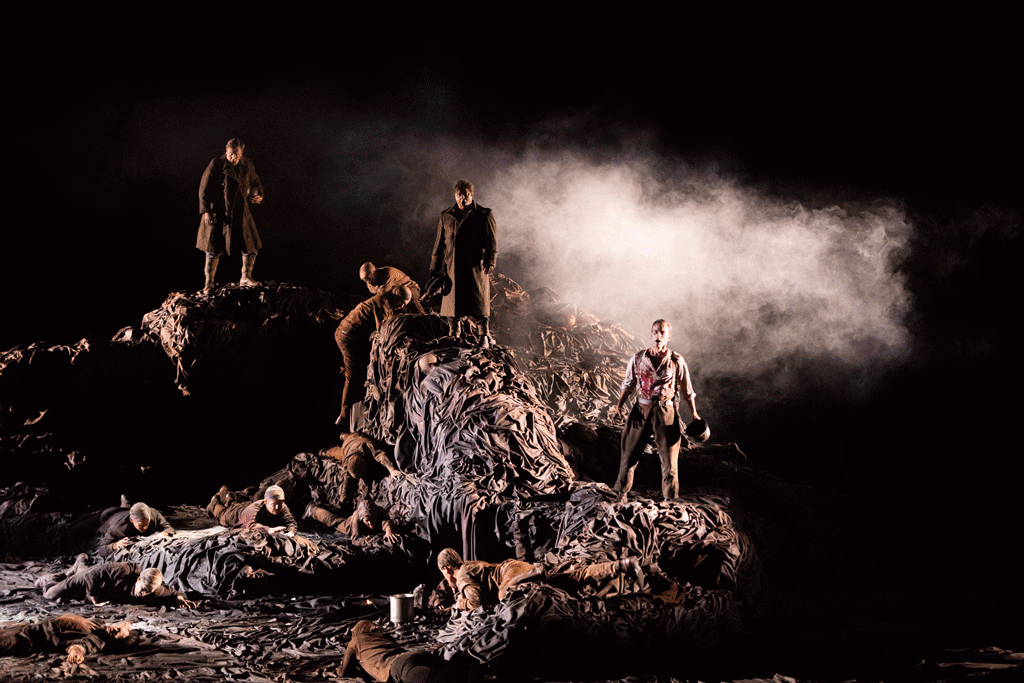
Jouons d’abord avec les mots. En allemand, Ger de prononce « guer » et ce GerMania sonne « Guer »MANIA, manie de la guerre, une sorte de retour maniaque sur le même motif, que le plateau tournant du décor unique de Magda Willi souligne comme si on revenait sans cesse sur la même obsession, un décor qui représente un amoncellement d’habits dont émergent des corps ou des morceaux de corps, qui apparaissent comme générés par le tas même que nous avons sous les yeux, qui rappellent certaines photos d’amoncellements des camps de la morts, habits, corps, objets, comme un cimetière du monde à ciel ouvert. Structurant l’histoire, l’opposition entre Hitler et Staline, piétinant le même tas, à chacun son camp , à chacun ses morts.
Entre le moment où la distribution a été donnée sur le site de l’opéra et celui où a été imprimé le programme, quelque chose a changé : les voix (soprano, alto ténor etc…) sont devenues personnages.
Si l’on excepte Staline, Hitler, et à la limite Goebbels, cela ne change pas grand-chose parce la pièce est conçue comme une série de tableaux dont certains sont presque interchangeables, structurés en deux actes de cinq scènes chacun, le premier acte est plutôt une évocation de la grande histoire, Staline, Hitler, le mur de Berlin, Stalingrad…le second se consacre aux effets immédiats et lointains, les souvenirs, les camps russes, ou l’enterrement de Brecht vu comme « le poète » avec ses contradictions, et Gagarine parce qu’il dit « sombre camarades est l’espace, très sombre. L’œuvre s’achève sur un Auschwitz-requiem, fait du Kadish et de liturgie orthodoxe, dans la vision d’un univers condamné à l’obscurité.

Ainsi donc ce sont des destins laminés par les pouvoirs et la guerre, par la monstruosité des temps (rien ne nous est épargné) qui frappe tout le monde, du communiste enfermé dans les camps nazis qui se retrouve dans les camps staliniens à peine la guerre finie, des veuves dont les maris sont morts en criant « Heil Hitler ! » qui cherchent dans les ruines de quoi se tuer et finissent par se faire tuer à la hache par un SS croate en fuite qui n’a que ce moyen-là pour officier. Un Staline qui tonne de sa voix grave et un Hitler à voix suraiguë qui se retrouve aux abois dans le Bunker, hurlant de sa voix de ténor comme un porc égorgé avec à la fois Goebbels qui lui apporte ses enfants morts et les secrétaires en larmes, et une Eva Braun en nuisette et robe de mariée dérisoire.

La mise en scène de John Fulljames est surtout frappante par de très belles images et des éclairages magnifiques de Carsten Sander, les changement de point de vue par les vidéos (Will Duke) qui reprennent le plateau de dessus, en donnant une image de charnier, digne des Bienveillantes de Jonathan Littell, mais aussi les personnages qui apparaissent et qui semblent des morts vivants, comme un défilé de fantômes : tout cela frappe et fascine en même temps. La répétition des motifs donne à l’ensemble cette allure lancinante de stations d’une Passion que le Requiem final conclut avec une implacable logique, d’autant que l’espace sidéral souvent signe d’avenir est ici signe de clôture, partout l’obscurité et donc la mort. Gagarine comme conquérant de l’inutile (on le voit encore mieux aujourd’hui).

Bien sûr il y a aussi des moments satiriques : Hitler a quelque chose de Chaplin même au seuil de la mort et son dialogue avec Staline semble proche de Kubrick, l’utilisation de l’Internationale ou de l’hymne soviétique qui se délitent ensuite dans la musique a quelque chose de terrible qui montre que Raskatov a épousé le pessimisme foncier de Heiner Müller.
Se fondant sur le livre Germania, très pessimiste sur l’histoire de l’Allemagne (écrit de 1955 à 1971) et Germania 3 – Fantôme du mort-homme, il en soutient les analyses, puisque Heiner Müller fait de la réunification allemande un signe qui ne résout rien, laissant l’Allemagne à ses vieux démons, ce que bien des intellectuels de l’ex-RDA pensaient alors.
La musique de Raskatov, fondée sur les cuivres, les bois et surtout les percussions se sert aussi des voix comme des instruments qui vont jusqu’au bout de leurs possibilités. Elle utilise aussi des morceaux classiques (Schubert, Wagner), des chants populaires ou des hymnes, comme un amoncellement musical qui évoque les substrats culturels mais aussi ce qui accompagne tout cette histoire. Il en résulte des moments terribles, d’autres grinçants, d’autres où le son se désagrège à l’image de l’histoire qui est évoquée. Et Alejo Pérez a su tirer le meilleur d’un l’Orchestre de l’Opéra de Lyon en état de grâce, sons précis, netteté, avec un travail rare sur l’expression (le tuba wagnérien…). C’est une musique en perpétuelle balance entre la caricature et la tension, entre le bruit et le son, qui volontairement va contre ce qui pourrait faire « musique » au sens traditionnel du terme, à un monde déconstruit pour toujours, une musique déconstruite, pour une Allemagne dont la musique est un des grands vecteurs d’identité. Ainsi la musique de Raskatov sonne-t-elle comme une sorte de glas permanent d’une harmonie toute humaine, une musique de la désagrégation comme cette humanité en jachère que décor et histoire nous montrent. En ce sens, l’équipe théâtrale a su parfaitement être à l’image de cette musique et de l’accompagner. Il en résulte une tension sonore et visuelle qui finit par hypnotiser le spectateur et le Requiem final d’une grande beauté plastique et sonore, n’est qu’un appel au silence infini des espaces où le monde se noie.

Au service de ce projet une distribution vraiment impeccable qui sert magnifiquement l’œuvre, les voix sont portées aux extrêmes, en aigu comme en grave, les écarts sont abyssaux, et brutaux, les rythmes syncopés, mais aussi des moments de cris, de hurlements de rugissements, de rires et en même temps de texte à dire avec une rare expressivité…et tous sont à féliciter, dont le chœur magnifiquement préparé par Karine Locatelli à la fois chœur d’humains et instrument. Les rares instants de lyrisme se frottent à de longues notes tenues ou des fragments de Sprechgesang. Une véritable épreuve. Ainsi de James Kryshak en Hitler aux écarts redoutables et aux aigus ravageurs, ou la basse Gennadi Bezzubenkov, à la fois personnage magnifiquement incarné avec une forte voix de basse qui est– ironie ?- et Staline et Gagarine puisque chaque chanteur chante plusieurs rôles.
Magnifique aussi le contre-ténor Andrew Watts ( Soldat allemand, Cremer, voix du garçon) et l’excellent géant rose pervers de Karl Laquit, tout comme le Goebbels de Ville Rusanen et le SS croate de Piotr Micinski.
Mais ce sont les trois voix féminines qui sont sans doute les plus incarnées et les plus impressionnantes dans la terrible scène des veuves : Sophie Desmars extraordinaire colorature, qui impressionne par ce chant aux limites du cri, du cri de bête humaine, tout aussi excellente Mairam Sokolova en troisième Dame (petit clin d’œil à la flûte enchantée, ici complètement déchantée) et en Frau Kilian ex-de Brecht, enfin Elena Vassilieva, deuxième Dame et Helene Weigel la veuve de Brecht, particulièrement impressionnante.
Dans cet ensemble où tout se heurte et tout se délite, les langues se heurtent, le russe, l’allemand, mais aussi l’hébreu, non par un souci de réalisme dans un spectacle qui est une parabole, mais par volonté de montrer qu’au-delà des différences de culture de langue et d’histoire, le naufrage est partagé, universel, sans espoir.
Nous avions beaucoup aimé Cœur de chien, dans la superbe réalisation de Simon McBurney, et nous sommes sortis frappés par ce spectacle sombre, au pessimisme structurel que l’actualité la plus récente ne saurait démentir. Puisant dans l’histoire et dans les conséquences de la deuxième guerre mondiale, Heiner Müller ne voyait pas de futur à l’Allemagne qui ne soit terrible, et Raskatov refuse au monde ne serait qu’une once d’espoir.
C’est à l’art d’éclairer les hommes, et ici il a sa pleine fonction d'avertissement.
Il reste à savoir qui reprendra cette œuvre et où. Cœur de chien avait tourné dans plusieurs théâtres européens, mais n’a pas été repris après sa première tournée. Une création ne vaut que par sa pérennité, et hélas ce n’est pas toujours le cas, loin de là. Ce spectacle mériterait un futur.

