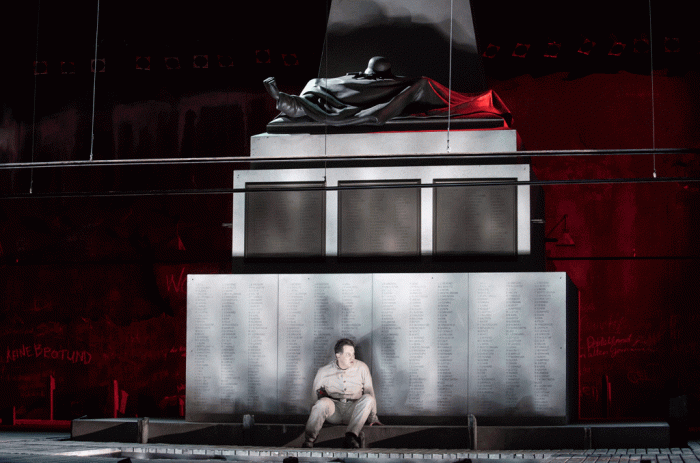 L'irruption du météore dodécaphonique dans le ciel tranquille de la musique lyrique à l'orée du XXe siècle donna naissance à une série de chefs d'œuvre, au premier rang desquels, ce Wozzeck d'Alban Berg avec qui elle fait ses premiers pas en atonalité. L'expérience que tente David McVicar consiste à combiner les codes véristes avec l'esthétique expressionniste – expérience qui n'est pas sans risques car elle inscrit la trajectoire du personnage dans une arrière-fond explicitement référencé par le contexte historique de la guerre de 1914–18. En choisissant comme fil rouge le récit tragique du brave soldat Wozzeck victime d'obusite ou stress post-traumatique, la mise en scène peine à explorer les souterrains d'une âme tourmentée par une des nombreuses variantes de l'esprit fin-de-siècle. Après tout, Alban Berg n'avait-il pas été lui-même victime des conditions dramatiques qui régnaient dans les tranchées et réaffecté à l'arrière, dans des services administratifs ? Ce parallèle biographique donne un sens et un éclairage rationnel à ce trouble incessant dont souffre le personnage. Impossible dès lors d'en faire abstraction pour dire avec Wozzeck : "Chacun de nous est un gouffre ; on a la tête qui tourne quand on regarde au fond". On substitue ici à la portée universelle du drame, un tragique fait divers dont les circonstances nous sont racontées en quinze tableaux.
L'irruption du météore dodécaphonique dans le ciel tranquille de la musique lyrique à l'orée du XXe siècle donna naissance à une série de chefs d'œuvre, au premier rang desquels, ce Wozzeck d'Alban Berg avec qui elle fait ses premiers pas en atonalité. L'expérience que tente David McVicar consiste à combiner les codes véristes avec l'esthétique expressionniste – expérience qui n'est pas sans risques car elle inscrit la trajectoire du personnage dans une arrière-fond explicitement référencé par le contexte historique de la guerre de 1914–18. En choisissant comme fil rouge le récit tragique du brave soldat Wozzeck victime d'obusite ou stress post-traumatique, la mise en scène peine à explorer les souterrains d'une âme tourmentée par une des nombreuses variantes de l'esprit fin-de-siècle. Après tout, Alban Berg n'avait-il pas été lui-même victime des conditions dramatiques qui régnaient dans les tranchées et réaffecté à l'arrière, dans des services administratifs ? Ce parallèle biographique donne un sens et un éclairage rationnel à ce trouble incessant dont souffre le personnage. Impossible dès lors d'en faire abstraction pour dire avec Wozzeck : "Chacun de nous est un gouffre ; on a la tête qui tourne quand on regarde au fond". On substitue ici à la portée universelle du drame, un tragique fait divers dont les circonstances nous sont racontées en quinze tableaux.
Si la modernité de Wozzeck provient en grande partie du fait que le livret ne juge pas le personnage et laisse en suspens toute tentative de lecture rationnelle ou clinique, le travail de McVicar transforme en crime passionnel un geste qui puise ses sources au-delà du personnage dans la perte de repère d'un monde sur le point de basculer dans le meurtre et la folie. Quand Karl Kraus voulait découvrir des abîmes sous des lieux communs, Georg Büchner avait déjà découvert un abîme sous un fait divers. En se bornant à ce fait divers, la mise en scène de David McVicar ne permet pas d'atteindre par capillarité au drame de l'humanité et par-delà à la finitude de l'existence et l'absurdité qui en résulte.
Le décor très simple est dominé par la présence imposante d'un monument aux morts planté au centre de la scène. Ce qui semble être le poing d'un soldat appelant conjointement à une résurrection mêlée d'insurrection, se dresse hors d'une vareuse sur laquelle on a déposé le casque du défunt. Ce poing rageur est le point de focalisation qui immuablement envoie et assène le même message d'un bout à l'autre de la soirée. Pas un bouton de guêtre ne manque aux uniformes et l'on imagine sans peine l'immense travail de documentation qu'il a fallu à McVicar et ses équipes pour parvenir à cette reconstitution méticuleuse. C'est quelque part entre Novencento de Bernardo Bertolucci et les Sentiers de la gloire de Staley Kubrick. Le découpage des tableaux est rythmé par un très long rideau blanc, maculé de moisissures, qui coulisse dans un bruit de déchirure métallique le long d'une longue tringle, déployé ou replié au pas de course par un machiniste invisible, au pas de course. Si le procédé cache mal sa redondance, il permet tout au moins d'éviter de pénibles changements à vue. Sur les côtés, de hauts murs décrépis sont recouverts de graffitis à la craie composés de cris de vengeance et de slogans dénonçant la faim et les injustices de la guerre. La foule des civils et des militaires vient se recueillir au pied du monument, éclate en sanglots à la lecture d'un nom – c'est une émotion naturaliste et édifiante, à la façon d'un tableau Jean-François Millet.
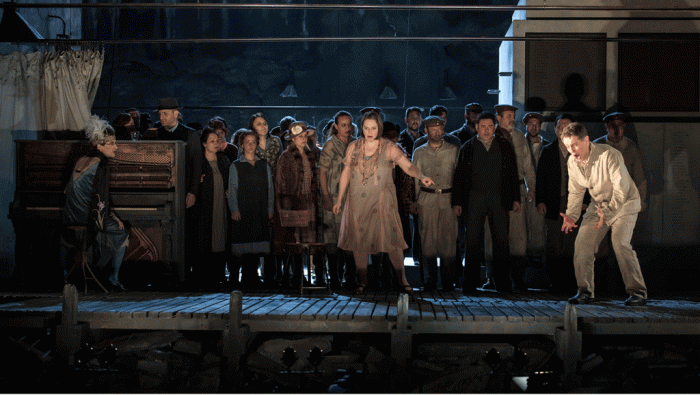 On notera l'idée plus intéressante, mais à peine esquissée, d'associer les trois personnages centraux que sont le capitaine, le médecin et Wozzeck à d'étranges machines montées sur des roues métalliques tout droit sorties d'un album de bande dessinée psychédélique signée Guido Crepax ou Georges Pichard. L'exubérance d'accessoires pour la plupart non-fonctionnels permet de distinguer approximativement l'usage que l'on peut en faire et témoigne d'une volonté d'amplifier le profil psychologique du personnage. C'est d'abord l'immaturité criminelle et la rigidité mentale du capitaine, tantôt occupé à jouer aux soldats de plomb dans une baignoire en zinc ou cette étrange voiture à roues avec haut-parleurs, toutes deux manipulées par des aides de camp zélés. On trouve ensuite la perversité et l'obsession hygiéniste du médecin avec cette table de chirurgie ou de dissection sur laquelle on attache Wozzeck et qu'on fait pivoter à volonté, ainsi que cette immense loupe lenticulaire à travers laquelle on le scrute tel un insecte. Enfin, la soumission et la réduction psychologique de Wozzeck à la dimension d'un cheval de trait ou d'un animal de compagnie poussant une sorte de voiture à bras montée sur roues. Par une idée assez pachydermique de portée, McVicar ira jusqu'à montrer le fils de Wozzeck remplacer dans la machine son père disparu pour des "Hop ! Hop !" d'ordinaire si émouvants et ici anecdotiques. Anecdotiques également les scènes du bal avec cette imitation de Gustav Mahler dirigeant sur scène l'orchestre de poche, ou ces visions du lumpenproletariat occupé à étendre le linge ou dormir dans des dortoirs militaires. Par un simple jeu de projecteurs écarlates, on nous donne à voir le corps de la malheureuse disparaître sous un ponton de bois.
On notera l'idée plus intéressante, mais à peine esquissée, d'associer les trois personnages centraux que sont le capitaine, le médecin et Wozzeck à d'étranges machines montées sur des roues métalliques tout droit sorties d'un album de bande dessinée psychédélique signée Guido Crepax ou Georges Pichard. L'exubérance d'accessoires pour la plupart non-fonctionnels permet de distinguer approximativement l'usage que l'on peut en faire et témoigne d'une volonté d'amplifier le profil psychologique du personnage. C'est d'abord l'immaturité criminelle et la rigidité mentale du capitaine, tantôt occupé à jouer aux soldats de plomb dans une baignoire en zinc ou cette étrange voiture à roues avec haut-parleurs, toutes deux manipulées par des aides de camp zélés. On trouve ensuite la perversité et l'obsession hygiéniste du médecin avec cette table de chirurgie ou de dissection sur laquelle on attache Wozzeck et qu'on fait pivoter à volonté, ainsi que cette immense loupe lenticulaire à travers laquelle on le scrute tel un insecte. Enfin, la soumission et la réduction psychologique de Wozzeck à la dimension d'un cheval de trait ou d'un animal de compagnie poussant une sorte de voiture à bras montée sur roues. Par une idée assez pachydermique de portée, McVicar ira jusqu'à montrer le fils de Wozzeck remplacer dans la machine son père disparu pour des "Hop ! Hop !" d'ordinaire si émouvants et ici anecdotiques. Anecdotiques également les scènes du bal avec cette imitation de Gustav Mahler dirigeant sur scène l'orchestre de poche, ou ces visions du lumpenproletariat occupé à étendre le linge ou dormir dans des dortoirs militaires. Par un simple jeu de projecteurs écarlates, on nous donne à voir le corps de la malheureuse disparaître sous un ponton de bois.
Par bonheur, la direction imposée par Stefan Blunier à la tête de l'Orchestre de la Suisse-Romande dégage des paysages sonores d'un étourdissant mélange d'âpreté et de contrastes. Les déflagrations des cuivres corrodent les détails à la manière d'une eau-forte, laissant à la petite harmonie le champ libre pour vitupérer avec des couleurs et des densités rarement entendues par le passé. La modestie de la fosse du Théâtre des Nations n'aura hélas pas permis de compléter des pupitres de cordes pour contrebalancer la puissance dynamique des vents.
Le plateau est très équilibré, avec le Wozzeck sonore et charnu de Mark Stone qui chante son rôle comme on exprimerait une idée fixe, avec une obsession quasi-monolithique. Face à lui, la vétérante Jennifer Larmore fait oublier quelques changements de registres assez périlleux par un engagement remarquable qui transforme le chant en un long abattage furieux. Très soigné de ligne et de timbre, le capitaine de Stephan Rügamer affronte les déraillements sulfureux de Tom Fox, Docteur Folamour en goguette. À mille lieues de cette présence venimeuse, l'impeccable et juvénile Andrès de Tansel Akzeybek fait merveille, tout comme la Margret de Dana Beth Miller qu'on aimerait entendre plus longuement, tandis que Charles Workman a le bon goût de ne pas surjouer la vilenie de son Tambourmajor pour le rendre fascinant.

