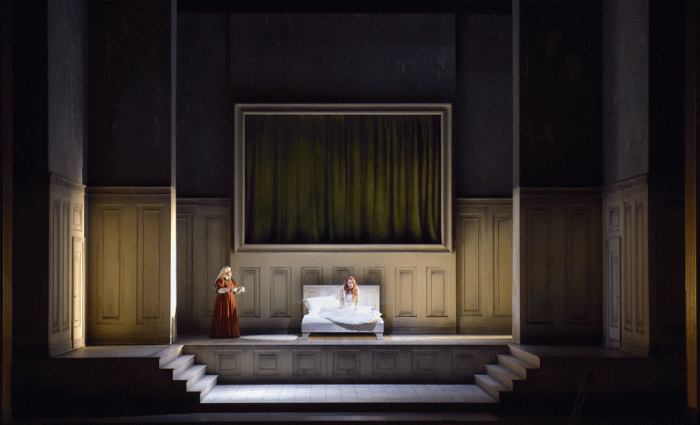Moins fondateur que L’Orfeo, moins immédiatement captivant que L’Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in patria n’en est pas moins un opéra bouleversant. Dans cette Venise républicaine où, en 1637, s’ouvre le premier théâtre lyrique public et payant, le genre « opéra » s’épanouit et les chefs‑d’œuvre éclosent, ceux de Monteverdi mais aussi, entre autres, de Francesco Cavalli. On peut encore rêver à ce qu’était alors le spectacle, à ses décors et ses machines. On ne rêvera pas devant celui qu’ont imaginé Mariame Clément, qui met en scène, et Julia Hansen, qui signe scénographie et costumes. Le décor de base est unique, une vaste pièce tour à tour chambre de Pénélope, salle du palais, et quelquefois, en contrebas, rivage marin. Des lambris blancs, le reste peint en gris. L’ensemble n’est pas inélégant mais simplement terne. Aux trois quarts du mur de face, un immense tableau encadré recouvert d’un voile. Lorsque celui-ci s’écarte, il dévoile… l’Olympe – un séjour des dieux réduit à un pub irlandais où Jupiter, Neptune et les autres s’alcoolisent et jouent aux fléchettes.
Moins fondateur que L’Orfeo, moins immédiatement captivant que L’Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in patria n’en est pas moins un opéra bouleversant. Dans cette Venise républicaine où, en 1637, s’ouvre le premier théâtre lyrique public et payant, le genre « opéra » s’épanouit et les chefs‑d’œuvre éclosent, ceux de Monteverdi mais aussi, entre autres, de Francesco Cavalli. On peut encore rêver à ce qu’était alors le spectacle, à ses décors et ses machines. On ne rêvera pas devant celui qu’ont imaginé Mariame Clément, qui met en scène, et Julia Hansen, qui signe scénographie et costumes. Le décor de base est unique, une vaste pièce tour à tour chambre de Pénélope, salle du palais, et quelquefois, en contrebas, rivage marin. Des lambris blancs, le reste peint en gris. L’ensemble n’est pas inélégant mais simplement terne. Aux trois quarts du mur de face, un immense tableau encadré recouvert d’un voile. Lorsque celui-ci s’écarte, il dévoile… l’Olympe – un séjour des dieux réduit à un pub irlandais où Jupiter, Neptune et les autres s’alcoolisent et jouent aux fléchettes.
Le problème auquel l’équipe s’est heurtée est récurrent : comment représenter visuellement ce drame ? Quel lieu, quelle époque choisir ? Problème non résolu ! On reste dans le vague, avec des costumes disparates, une nourrice en coiffe blanche et robe rouge qui semble sortie d’une peinture flamande, Pénélope sobrement vêtue de blanc ou de noir, Télémaque, le fils qu’elle a eu d’Ulysse, fringué comme un ado d’aujourd’hui, blouson et jean. Aucun doute : les clichés sont là où on les attend, comme ces courtisans et prétendants qui ne peuvent arborer que des smokings ! Mademoiselle Clément a voulu, dit-elle faire un Ritorno « pop ». Mais est-ce bien pop d’orner l’entrée du palais d’un distributeur de Coca-Cola et de poubelles, de faire descendre des cintres, lorsque Iro clame sa faim, le dessin d’un hamburger géant et de ponctuer le massacre des prétendants par des bulles de BD contenant des onomatopées ? Cela n’amuse pas grand monde et frise le ridicule, d’autant plus que le parti-pris est à peine esquissé. Plus dommageable : on cherche en vain le mélange des genres essentiel ici. L’ensemble se maintient dans un théâtralement correct qui n’effraierait pas le public le moins averti – celui du TCE est particulièrement poli, car on a souvent vu à Paris des metteurs en scène être hués pour moins que cela.
 Ce qui se révèle une absence totale de vision sur l’œuvre n’aide pas une distribution inégale. Le trio des prétendants est bancal, dominé par Lothar Odinius, ténor à l’émission franche qui incarne aussi Jupiter ; le timbre de contre-ténor de Maarten Engeltjes, Pisandro et La Fragilité humaine, n’est pas des plus flatteurs, et la ligne vocale de Callum Thorpe, Antinoo et Il Tempo, quelque peu abrupte. L’ample basse de Jean Teitgen en fait un Nettuno convaincant malgré la raideur de son élocution italienne. On entend peu Katherine Watson, belle Giunone. L’excellent Kresimir Spicer, habitué de ce répertoire, est un Eumete percutant. Remplaçant quasiment au pied levé Elodie Méchain souffrante, Mary-Ellen Nesi incarne dignement Ericlea, la nourrice d’Ulisse. Le couple Melanto/ Eurimaco ne pouvait espérer meilleurs interprètes qu’Isabelle Druet et Emiliano Gonzalez-Toro, musicalement impeccables et très drôles… et qui pourraient l’être encore plus dans une mise en scène moins sage. Que dire d’Anne-Catherine Gillet, Amore et Miverva cristalline et scintillante, si ce n’est qu’elle est irrésistible ? Mathias Vidal, à la silhouette d’adolescent, n’a aucune peine à camper un Telemaco épatant et fougueux, juvénile et fin musicien. Magdalena Kožená chante délicatement mais sa Penelope (une prise de rôle) semble bien distante ; on à peine à la croire femme de tête, qui règne sur Ithaque, et amoureuse d’un époux qu’elle n’a pas vu depuis vingt ans. Reste le cas Rolando Villazón. Ceux qui ne l’apprécient guère auront encore du grain à moudre. Car si la tessiture relativement centrale du rôle ne sollicite pas dangereusement l’aigu, on le sent peiner et la fatigue se fait vite sentir – est-il lui aussi victime des microbes qui ont décimé l’équipe ? Ses fans, quant à eux, retrouveront dans son médium des couleurs chaleureuses et seront sensible à la sympathie qu’il dégage et à son investissement dans son personnage, au point qu’il en oublie parfois son contrôle vocal et que son intonation en pâtit. Il agit en artiste, à prendre avec ses défauts désormais incorrigibles, ou à rejeter.
Ce qui se révèle une absence totale de vision sur l’œuvre n’aide pas une distribution inégale. Le trio des prétendants est bancal, dominé par Lothar Odinius, ténor à l’émission franche qui incarne aussi Jupiter ; le timbre de contre-ténor de Maarten Engeltjes, Pisandro et La Fragilité humaine, n’est pas des plus flatteurs, et la ligne vocale de Callum Thorpe, Antinoo et Il Tempo, quelque peu abrupte. L’ample basse de Jean Teitgen en fait un Nettuno convaincant malgré la raideur de son élocution italienne. On entend peu Katherine Watson, belle Giunone. L’excellent Kresimir Spicer, habitué de ce répertoire, est un Eumete percutant. Remplaçant quasiment au pied levé Elodie Méchain souffrante, Mary-Ellen Nesi incarne dignement Ericlea, la nourrice d’Ulisse. Le couple Melanto/ Eurimaco ne pouvait espérer meilleurs interprètes qu’Isabelle Druet et Emiliano Gonzalez-Toro, musicalement impeccables et très drôles… et qui pourraient l’être encore plus dans une mise en scène moins sage. Que dire d’Anne-Catherine Gillet, Amore et Miverva cristalline et scintillante, si ce n’est qu’elle est irrésistible ? Mathias Vidal, à la silhouette d’adolescent, n’a aucune peine à camper un Telemaco épatant et fougueux, juvénile et fin musicien. Magdalena Kožená chante délicatement mais sa Penelope (une prise de rôle) semble bien distante ; on à peine à la croire femme de tête, qui règne sur Ithaque, et amoureuse d’un époux qu’elle n’a pas vu depuis vingt ans. Reste le cas Rolando Villazón. Ceux qui ne l’apprécient guère auront encore du grain à moudre. Car si la tessiture relativement centrale du rôle ne sollicite pas dangereusement l’aigu, on le sent peiner et la fatigue se fait vite sentir – est-il lui aussi victime des microbes qui ont décimé l’équipe ? Ses fans, quant à eux, retrouveront dans son médium des couleurs chaleureuses et seront sensible à la sympathie qu’il dégage et à son investissement dans son personnage, au point qu’il en oublie parfois son contrôle vocal et que son intonation en pâtit. Il agit en artiste, à prendre avec ses défauts désormais incorrigibles, ou à rejeter.
Le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm sonne toujours aussi joliment, presque trop discret parfois, au point qu’on se demande s’il est un soutien efficace pour les chanteurs. La partition est ciselée avec élégance, mais davantage de dynamisme donnerait de l’élan à ce voyage initiatique qui malheureusement laisse l’auditeur en chemin.