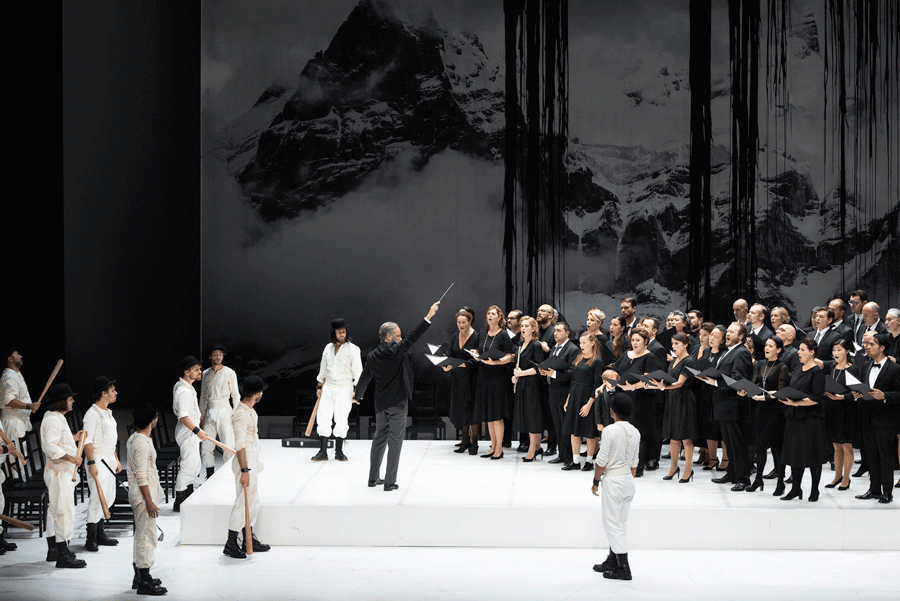
Guillaume Tell est passé à la postérité en tant que chef‑d'œuvre absolu autant qu'ultime, monumental à tous les niveaux, à commencer par une durée délirante de près de cinq heures et des airs qui exigent des interprètes des prouesses stratosphériques et véritablement surhumaines. Le seul rôle d'Arnold aura suffi à donner à l'ouvrage le surnom de "tombeau des ténors", agrémenté d'un multitude d'anecdotes plus ou moins inventées dont la fameuse collection de verres précieux que possédait Rossini et qu'il craignait voir réduite en miettes après le fameux "ut de poitrine" que poussa devant lui le ténor Gilbert-Louis Duprez peu de temps avant la première française.
Au-delà des anecdotes, Guillaume Tell est surtout le double tombeau de Rossini – Tombeau de sa carrière de musicien, puisqu'il cessa quasiment de composer après ce tour de force ("Un succès de plus n’ajoutera rien à ma renommée, une chute pourrait y porter atteinte ; je n’ai pas besoin de l’un et ne veux pas m’exposer à l’autre") et tombeau d'un style belcantiste désormais révolu. Finies les alternances serioso-buffa, les conclusions avec accelerando pyrotechnique, terminées les volutes et pirouettes enchaînant sauts d'octaves, contre-uts et autres facéties gymniques et vocales. Voici venir pour Rossini le temps de donner naissance à une œuvre qui deviendra le modèle d'un nouveau genre musical : le Grand-Opéra français. Nous ne sommes qu'en 1829 mais l'écriture musicale regarde loin devant, vers la révolution Verdi-Wagner qui se dessine déjà. Guillaume Tell porte en germe les grandes fresques verdiennes ou wagnériennes, de Nabucco à Rienzi, l'héroïsme de Trovatore et de Siegfried ; on entrevoit ici l'usage d'un nouveau style expressif comme l'emploi de lirico spinto ou le style de ténor héroïque.
Tobias Kratzer avait prévenu dans l'interview qu'il nous avait accordée : "je vois [Rossini] comme "parabolique", comme le créateur d’une parabole, un compositeur très clair, presque abstrait. C’est presque du théâtre épique à la Brecht." Et c'est précisément ce dénuement et cette abstraction qui surprend le plus ; dès le prélude, avec sur un podium d'un blanc éclatant, le violoncelle solo (on avait déjà cette idée chez David Pountney à Genève en 2015) et un couple de danseurs. À l'arrière, la vue fantastique du Cervin enneigé et dominant les nuages, le tout en noir et blanc. L'éclairage très cru donne à ces éléments un contraste très vif qui souligne la raideur et l'inconfort des poses : la difficulté du solo musical et du pas-de-deux. Surgissent des coulisses une équipée sauvage de figurants grimés à la manière d'Alex DeLarge et ses compagnons de débauche, personnages imaginés par Anthony Burgess dans A clockwork Orange (Orange mécanique), un roman que Stanley Kubrick immortalisa à l'écran en 1971. Rien ne manque au tableau : Justaucorps blanc, rangers noires, bretelles, coquille de protection, chapeau melon, batte de baseball et le contour de l'œil outrageusement maquillé. Dans un premier temps, cette irruption a pour but d'intimider et mettre mal à l'aise danseurs et soliste puis, l'ultraviolence éclate et les coups pleuvent au même moment où se déchaîne l'orage (hommage mêlé à la Pastorale et au Freischütz) ; l'instrument est détruit à coups de batte, musicienne et danseurs chassés de la scène alors que se fait entendre le paisible ranz des vaches au cor anglais. Le rideau (rouge) tombe durant toute la durée de la célébrissime cavalcade – suspension de l'action qui semble pour le coup interminable et qui laisse imaginer le pire en coulisse… surtout si l'on se souvient que ladite cavalcade sert de bande-son aux frasques sexuelles d'Alex dans une scène filmée en accéléré par Kubrick.
Quand le rideau s'ouvre, on découvre une assemblée des paysans suisses vêtus d'un noir austère et disposés en un rectangle régulier autour de la scène surélevée où Tell et sa petite famille sont occupés à déjeuner dans une ambiance très traditionnelle et patriarcale. C'est l'occasion d'admirer un réglage au cordeau de la direction d'acteurs qui réussit, comme à l'acte II de son Tannhäuser à Bayreuth, à faire exister individuellement le moindre détail, la moindre mimique, le moindre geste dans un ensemble pourtant très imposant. Tandis que Jemmy profite d'un moment d'inattention pour remettre la soupe dans la soupière et se cacher sous la table pour jouer du violon. Melcthal semble inquiet, il ne s'associe pas à la joie collective… un malheur se prépare.
L'inquiétude ne tarde pas à se manifester sous la forme de coulures noires sur l'image du Cervin. Les Autrichiens sont là, avec le terrifiant Gessler à leur tête. Cette opposition de noir et de blanc signale la fracture qui sépare les deux sociétés. L'une (en noir) incarnant la communauté des paysans réunie autour de la notion de l'art pour l'art, et tout particulièrement le chant et la musique ; l'autre (en blanc) désignant les Autrichiens, meute bestiale dont la référence à Kubrick surligne la perversion et la dangerosité. Comme chez Kubrick également, on découvre progressivement (et c'est là la grande force du travail de Tobias Kratzer) que les bons et les mauvais ne sont pas forcément ceux qu'on nous désigne par ce jeu un peu trop évident de blanc et de noir. Ainsi, l'ultraviolent Alex DeLarge servira de cobaye humain lors d'un programme de rééducation fascisant dans la seconde partie du film de Kubrick.
Pour l'heure, c'est Melcthal qui fait les frais de la violence des Autrichiens. Furieux de voir le berger Leuthold leur échapper, ils débarquent sur scène et font subir au sage vieillard une série de tortures qui n'ont rien à envier à une scène de Reservoir dogs de Tarentino : oreille coupée, yeux crevés… ces barbares ennemis de l'art s'en prennent décidément à des organes très signifiants ! Peu de temps avant son supplice, Melcthal avait sorti de son veston la baguette de chef d'orchestre, symbole ultime de l'union future des Trois-cantons, dont le lac sert de décor à la scène et que Kratzer va métaphorisee en allusion aux trois familles d'instruments qui composent l'ensemble harmonieux de l'orchestre : les pupitres des cordes, des bois et des cuivres. On retrouve cette métaphore dans l'idée d'une patrie-musique qu'il s'agit de sauver des griffes des envahisseurs. Le Serment du Grütli est mis en scène d'une façon à la fois très juste et très ironique : les Trois Cantons d’Uri, de Schwytz et d’Unterwald se réunissent à l'appel de Guillaume et joignent leurs forces en combinant leurs instruments, qu'ils brisent et assemblent entre eux pour former des armes composites à la forme immédiatement reconnaissable : le fût du basson et les éclisses du violon pour l'arbalète, le fond du violoncelle comme bouclier, la table du violon et la flûte telle une hache ou une francisque.

Ces préparatifs ironisent en filigrane sur le geste très iconoclaste consistant à briser des instruments pour défendre la musique et transformer les fragments en armes létales. On lit déjà en creux la critique consistant à montrer des "bons" pas si pacifiques et prêt à renoncer à l'objet même de leur identité (la musique) pour combattre des "mauvais", au fond pas si barbares puisqu'ils cherchent à réprimer une société qui vit de règles et de normes étroites.
Le couple Arnold-Mathilde sert de passerelle et de trait d'union entre les deux communautés. Il faut à Arnold la pénible épreuve du meurtre de son père pour le convaincre de ne pas rejoindre les rangs autrichiens par amour de Mathilde. Inversement, la sœur de l'Empereur troque l'uniforme des ultraviolents en justaucorps blanc et chapeau melon pour une robe en lamé au moment de chanter sa "sombre forêt" qui prélude aux retrouvailles avec son amoureux.

L'acte III est l'occasion pour Kratzer de jouer avec les codes historiques d'une mise en scène "historique", avec cette humiliation des paysans suisses, contraints par les Autrichiens de revêtir d'emblématiques et traditionnels costumes bigarrés, tout droit tirés d'une gravure de mode du XIXe siècle. Gessler et ses hommes confrontent la communauté à une représentation caricaturale d'elle-même. Au-delà du parallèle qu'on peut établir avec Kubrick et la scène du viol où Alex contraint Mrs Alexander à se déshabiller avant d'abuser d'elle, ce bref moment fonctionne à la manière d'une distanciation de la distanciation. La figure de Guillaume Tell trouve un relief particulier au centre de cet emboîtement, contraint comme les autres à enfiler un costume vert et un carquois qui le rend aussitôt reconnaissable. Cette humiliation semble pour lui aussi forte que celle de devoir mettre en danger la vie de son fils lors de la célèbre épreuve de la pomme. Derrière la finesse du détail psychologique perce un angle inédit qui est le point de vue de Jemmy, le fils de Tell et la victime consentante. Le rôle du garçonnet est joué par un enfant épatant, Martin Falque doublé par la soprano Jennifer Courcier. La soprano est présente sur scène, telle un esprit invisible aux yeux de tous et qui protège l'enfant au fil des péripéties. Quand Guillaume pointe son arbalète sur lui, elle se précipite et fait tomber la pomme d'un coup de main. Blotti dans ses bras, l'enfant frissonne d'une peur qui se change bientôt en mutisme. On lit attentivement l'évolution silencieuse du personnage dans le fait qu'il ne touche plus à son cher violon, cachant sa tête dans ses mains et mûrissant le projet de quitter bientôt le giron familial, avec sa soupe du soir et ses exercices de solfège ("sois immobile" lui intime son père au moment où il s'apprête à tirer sur lui). Ce retournement de situation à deux niveaux constitue le moment clé qui forme l'axe de symétrie de l'opéra. Les péripéties qui conduisent au meurtre de Gessler et à la victoire des suisses sont traitées sur un mode faussement anecdotique qui pourrait faire oublier la présence discrète de Jemmy refermé sur lui-même tandis que le chœur reprend sa position en rectangle et que tout semble revenir à la situation initiale… à l'exception du Cervin désormais entièrement recouvert de noir. Dernier pied de nez : à la dernière minute, l'enfant se lève et vient sur le devant de la scène enfiler un chapeau melon. Image terrible autant que prémonitoire, le fils se détourne du père et de la société de l'adoration perpétuelle de l'art et des règles – on assiste en direct à la naissance d'un futur Gessler.

Il fallait à ce spectacle, une distribution capable de faire honneur à ses ambitions et ses partis pris. Le rôle-titre est confié à l'excellent Nicola Alaimo, baryton rompu aux difficultés d'un rôle qu'il interprète sur toutes les scènes depuis plusieurs années. Bien plus à l'aise ici que dans la fournaise en plein air du Théâtre antique d'Orange cet été, il signe un personnage aux contours expressifs très contrastés, toujours attentif à donner un naturel et un caractère qui ne verse pas dans l'exagération. La prononciation manque parfois d'une fluidité et d'un allant qui pourrait donner à son "Sois immobile, et vers la terre incline un genou suppliant" une couleur vraiment dramatique.

Autre étoile marquante de la production, le ténor américain John Osborn sublime un rôle d'Arnold qu'il connaît parfaitement, au point d'en faire un glorieux cheval de bataille. Il faudra pourtant passer sur un second acte en demi-teinte, gâché par un abattage un brin mécanique dans le duo avec Mathilde. La suite, et surtout le célèbre "Asile héréditaire, ne sont que moments de grâce et d'émerveillement, avec une densité et une charge émotionnelle remarquables dans les changements de registres et le caractère irréprochable des aigus.
On sera davantage surpris de découvrir en Mathilde la voix de Jane Archibald – voix désormais plus pleine et plus riche que ses emplois de colorature, Zerbinetta, Constance ou Poupée des Contes d'Hoffmann en tête. La "Sombre forêt" luit de mille feux, tandis que le poignant "Pour notre amour, plus d'espérance" a le mordant et la fièvre qui signalent la présence d'une grande technicienne et d'une grande styliste. Enkelejda Shkosa n'a – hélas – que peu d'occasion de faire entendre ses mérites dans un rôle d'Hedwige que Rossini n'a pas développé outre mesure. La ligne excessivement vibrée dans le premier acte, trouve dans le final des accents moins heurtés et une couleur d'ensemble qui séduit durablement. La jeune Jennifer Courcier campe le rôle de Jemmy avec une énergie et une carrure réjouissantes. La projection est d'une belle ampleur, avec des irisations dans l'aigu qui laissent penser que le fils de Tell prélude à une belle carrière. Parmi les seconds rôles, on saluera cet impeccable pêcheur Ruodi, rôle aussi furtif que redoutable et dont Philippe Talbot se tire avec grand brio. Tomislav Lavoie est un Melcthal convenable mais sans excès, à l'image du Walter de Patrick Bolleire. Côté autrichien, le Rodolphe de Grégoire Mour ne démérite pas mais cède en intérêt à l'excellent Jean Teitgen, dont le luxueux Gessler pourrait bien faire figure d'incarnation modèle, tant par la qualité de la projection que pour les couleurs et l'intensité ténébreuses qu'il sait exprimer.
Le grand triomphateur de la soirée est dans la fosse et il s'appelle Daniele Rustioni. Le caractère et la vigueur de sa battue font de ce Guillaume Tell un monument de précision et de fureurs confondues. Les cordes brillent d'un éclat charnel très soutenu, distribuant les interventions des vents comme autant d'éclats lumineux qui produisent un effet de feu roulant dans l'introduction et qui ponctuent l'action de reliefs énergiques. Ce Rossini regarde ouvertement vers les climats d'un romantisme musical à la Verdi, sans négliger pour autant les eaux-fortes et les inventions d'un Wagner dessinant Rienzi et Fliegende Holländer. Les équilibres donnent aux chœurs une présence confondante, doublée d'une cohésion qui donne au jeu et au théâtre une liberté remarquables.
