
Le chœur des hébreux de Nabucco fut dès la création objet d’une lecture entre les lignes de la part du public d’alors : les hébreux en réalité, étaient ces italiens encore oppressés par l’occupant autrichien et le chœur devint cri de ralliement puis même (et jusqu’à aujourd’hui) hymne officieux de l’Italie moderne. Si tout le monde convient de cette relecture, c’est que tout le monde convient que Nabucco dit quelque chose qui va bien au-delà de l’histoire que l'oeuvre raconte. Pourquoi dans ces conditions agresser une relecture moderne qui ne dit pas autre chose que ce que signifie l’œuvre par-delà les siècles ? C’est bien la question qui assaille devant l’accueil houleux reçu lors de la première, en pleine contradiction avec la lecture faite de l’œuvre depuis sa création.
Dès le lever de rideau en effet à la vue du décor (les coursives d’un navire de guerre moderne ou du moins, de l’an 2046, après une apocalypse dont témoignent des images vidéo – la Syrie ravagée d’aujourd’hui) les premiers cris fusent, de manière si coordonnée qu’ils ne peuvent être spontanés. Une de mes voisines envoie des sms sans doute à ses sbires postés à des endroits stratégiques du théâtre. Tout semble avoir été calculé à l’avance pour faire tomber la production. Cela se calme pourtant assez vite ; parce que la réussite musicale impose le silence et que la salle commence à se lasser, mais les cris reprennent à une pause théâtralisée. Aux saluts, Stefano Ricci et Gianni Forte sont hués certes, mais comme n’importe quel metteur en scène dérangeant, sans faire taire les bravos, plus importants.
Au-delà de ces jeux de cirque familiers du théâtre lyrique depuis des lustres, on peut constater que ces « défenseurs » de l’art lyrique ne se sont pas autant égosillés lors de la représentation de I due Foscari , autrement plus discutable, et que tout au long des autres représentations, le public, réputé nerveux et difficile (c’est sa légende), est apparu d’une placidité voire d’une indifférence presque coupables, applaudissant à peine les chefs, intervenant quelquefois à contretemps, et sûrement pas une force de soutien pour les artistes. Ils se sont réveillés ainsi à contretemps, protestant contre une production enfin digne d’intérêt.
Ricci/Forte, performing arts ensemble est une compagnie qui a fait du théâtre un moyen de poser au spectateur des questions sur notre monde, en en regardant les problèmes voire les tares. Suivant les enseignements de Brecht, il s’agit de faire du théâtre un outil d’analyse du monde, pour faire du spectateur un être averti. Gianni Forte expose parfaitement leur démarche dans l’interview qu’il nous a accordée en mai dernier, que le lecteur peut consulter en cliquant sur le lien ci-dessous « 100% Furioso ».
Il est évident que par la trame, mais aussi par l’histoire de la réception de l’œuvre en Italie, Nabucco ne pouvait échapper au scalpel de l’analyse chirurgicale proposée à Parme. Et cette fois-ci, les prérequis d’un festival qui doit présenter des visions différentes, alternatives d’œuvres rebattues sont respectés.
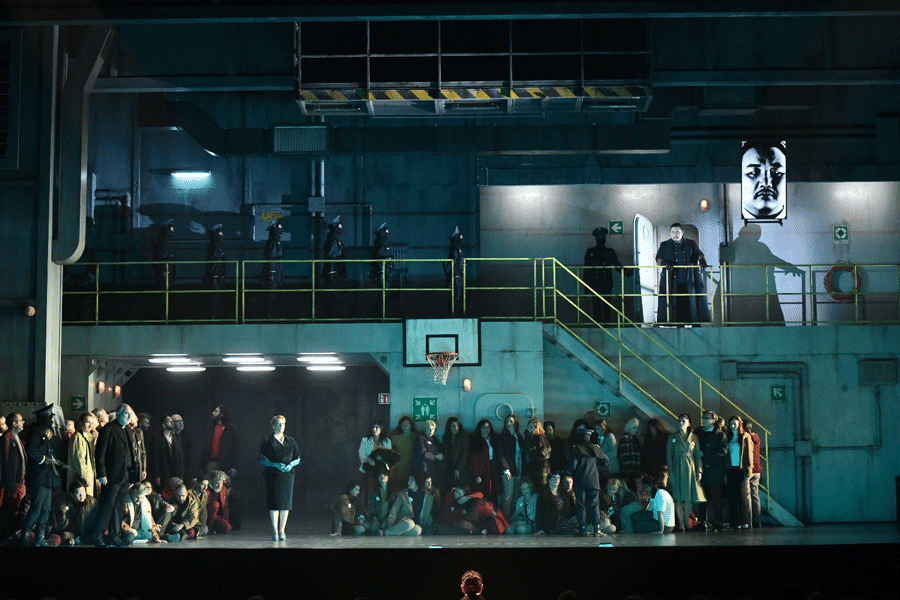
La première observation est la transposition de la problématique des hébreux élargie à celle des peuples victimes de l’oppression, et notamment des migrants ou des réfugiés de toutes les époques dans une Italie où la question migratoire est un enjeu politique, sur lequel certains jouent sans regard pour la simple question humaine. Le décor, un navire militaire, est une sorte d’arche de Noé nouvelle manière, pour une communauté d’oppresseurs revenus à des rites anciens et ravivés pour l’occasion ; c'est un cadre volontairement glacial et métallique, parcouru de gardes sans cesse aux aguets, d’où une notion d’enfermement démultipliée : un navire est un espace clos, les victimes sont doublement prisonnières et de l’espace et de ceux qui les ont accueillis d’une manière si peu hospitalière, parce qu’on ne peut plus vivre sur la terre ferme dévastée.
On demande à ces réfugiés dès le départ de se débarrasser de leur gilet de sauvetage orange, seule tache de couleur vive dans cet univers glauque (et seul moyen de s’échapper) puis de se faire identifier par Zaccaria, en habit de prêtre, catholique sorte de référent et d’intermédiaire entre les opprimés et les oppresseurs. On est bien proche d’un univers concentrationnaire (en cohérence avec l’identité des victimes et de l’histoire des hébreux) où chacun devient un matricule.
Ricci/Forte posent d’emblée la question de l’oppression, en cohérence avec le livret.
Mais Nabucco est aussi la question des oppresseurs et de leurs ambitions internes. Fenena est la fille de Nabucco, non reconnue, et laissée au milieu des opprimés, soigneusement mise à l’écart par une Abigaille qui suit de manière serrée son prétendu père et se fait photographier au milieu des malheureux pour sa com. Et Nabucco dont le portrait veille sur un écran vidéo, apparaît en habit d’autocrate, comme ces dictateurs d’Asie Centrale auxquels le chanteur d’origine mongole d’Amartuvshin Enkhbat peut d'ailleurs laisser croire de manière plus réaliste.

Nabucco, c’est l’histoire d’une oppression, mais aussi d’un coup d’État, où Abigaille s’empare du pouvoir au moment où Nabucco aveuglé se prend pour un Dieu. Là encore, la mise en scène respecte parfaitement les données du livret, provoquant aussi l’agitation du public au moment où Abigaille, toujours soucieuse de son image, distribue les cadeaux de Noël au pied d’un sapin, son portrait ayant remplacé celui de son père, humilié, détruit qui emporte son cadeau comme un vieillard dans un EPHAD l’emporterait : constat d’une déchéance.
Parallèlement, le décor évolue, s’élargit en un horizon fait d’œuvres d’art empaquetées, restes d’une civilisation disparue, reste d’une culture en jachère. D’ailleurs on se demande si ces œuvres sont celles qu’Abigaille vole pour son usage personnel, ou si elles sont entreposées là, sorte de restes inutiles dans un monde déshumanisé et aculturé : là aussi, il y a la couleur d’un avertissement directement adressé au statut de la culture dans le monde aujourd'hui, objet de tourisme plus que de pensée, et tout particulièrement à la culture italienne, à la manière dont la culture est traitée dans ce pays à la richesse patrimoniale incomparable : y faut-il voir un hasard dans la manière dont on devine la statue du Moïse de Michel Ange empaquetée, choisie évidemment par sa relation au sujet et au peuple hébreu.
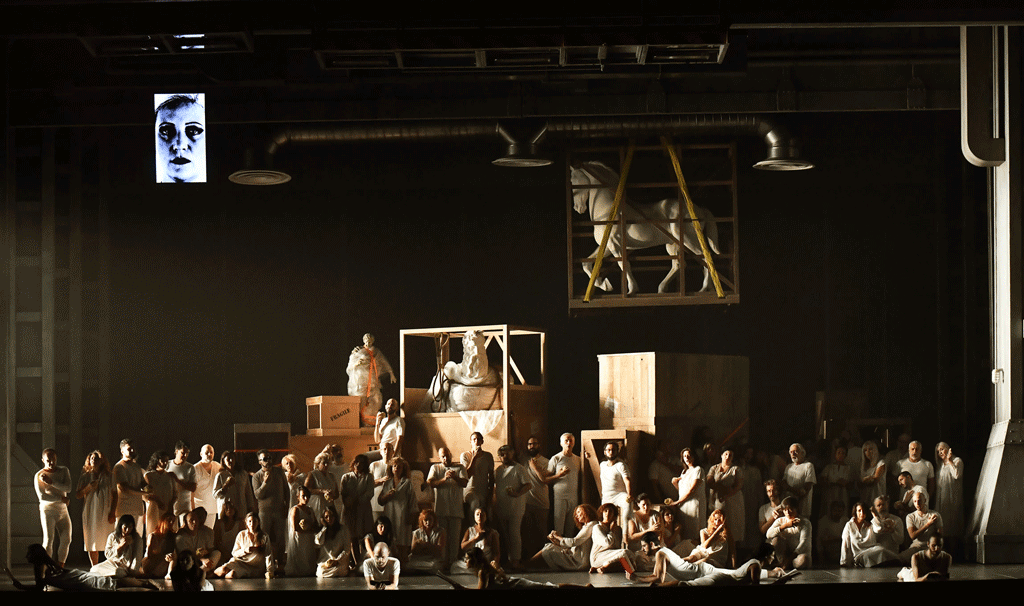
Faut-il voir un hasard aussi lorsque le chœur entame le « Va pensiero », distribué entre les statues et les caisses d’œuvres d’art dans une image magnifique avec l’éclairage mordoré et nostalgique d’Alessandro Carletti, lui donnant aussi une valeur presque identitaire, qui semblerait dire de manière déchirante : « Italie que fais-tu de ta culture ? et donc de ton identité profonde ». C’est l’une des données centrales de ce travail que de montrer que le monde déshumanisé présenté est plus qu’en germe dans le monde d’aujourd’hui, et notamment dans la Péninsule, parce que Nabucco justement a une valeur emblématique pour ce pays et peut donc aussi dire cette histoire. Derrière les yeux, Stefano Ricci et Gianni Forte portent un discours d’autant plus fort sur cette Italie qui se perdrait que lors de la préparation du spectacle, le pouvoir italien était porté par l’extrême droite. Ces images génèrent un malaise évident, parce qu’au-delà de l’Italie, il y a aussi le reste du Monde qui ne file pas meilleur coton. Si « La nave va », elle va très mal.
C’est donc une vision hautement politique que cette lecture propose en essayant à la fois de respecter le livret et son déroulement, de respecter aussi son esprit, mais aussi de dire ce qu’il signifie entre les lignes : Verdi si lié à l’identité de l’Italie était à la fois un artiste européen, ouvert et profondément humaniste et donc il faut porter ce message, qui dépasse les frontières de l’époque, de la tradition et du pays qui l'a vu naître.
Deux points enfin sont à signaler :
- D’une part, Ricci et Forte ne s’arrêtent pas aux parties musicales, mais proposent un spectacle continu et tendu en profitant des pauses qu’ils meublent de pantomimes signifiantes : la première (déjà houleuse) montre les soldats passant au broyeur les livres qu’ils ont enlevé aux réfugiés (le danger des livres, mais aussi DU Livre, c’est à dire du Message, du Verbe : bien des dictatures n’aiment pas trop le discours religieux – à commencer par les nazis), d’ailleurs Zaccaria le brandit comme pour résister.
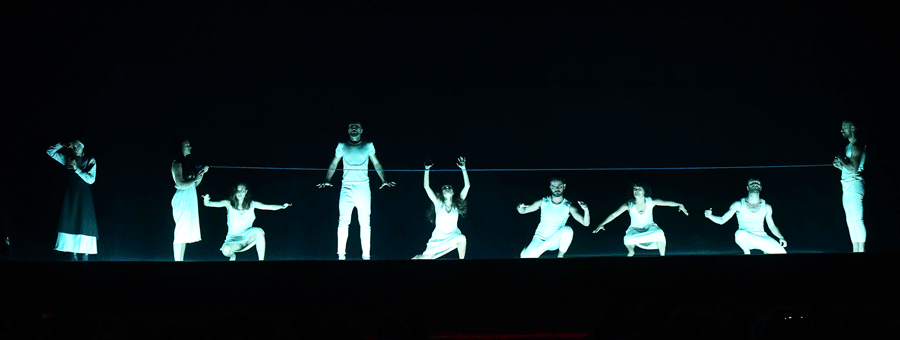
Les noyés Lors d’une deuxième pause, dans une chorégraphie très bien faite et émouvante, c’est la noyade et la mort des réfugiés qui est dansée, par une simple corde bleue tirée qui figure la mer et des corps qui s’y rattrapent, s’y collent et s’y noient. Une vision qui rappelle évidemment ce qui se passe en Méditerranée orientale et qui exige le silence, mais qui a été gâchée par les réactions de certains hurlant « basta », « sveglia », « musica » (et d’autres cris plus agressifs) montrant une totale absence de sens du théâtre et de ce que peut-être une stylisation. Effet détruit.
- D’autre part, le final montre une Abigaille qui meurt dans la joie générale, demandant pardon avec son double qui est pendu : on pense aux images de la mort de Saddam Hussein à laquelle sans doute se réfèrent les auteurs, mais bien plus, cette image nous dit la violence continue des pouvoirs quels qu’ils soient. Nabucco a beau retrouver son pouvoir au nom de son nouveau Dieu dont il a épousé la foi, et la loi et donc épouser l’humanité portée par Zaccaria, il n’y a pas de temps pour la clémence, pas de temps pour la réconciliation ou le pardon, valeur chrétienne centrale mais une permanence de la même violence. Cette fin n’est pas optimiste.

De ce travail très rigoureux, aussi bien par les décors à la fois réalistes et abstraits de Nicolas Bovey par les éclairages vraiment magnifiques d’Alessandro Carletti que par le travail millimétré de Stefano Ricci et Gianni Forte, on doit retenir non seulement le sérieux de l’entreprise, mais aussi l’heureux présage que l’opéra en Italie puisse sortir de visions traditionnelles et momifiées. Certains ont tendance à souligner que l’opéra allemand se prête mieux que l’opéra italien à des « lectures » décapantes. Ricci et Forte nous montrent le contraire : quand une lecture est intelligente et donne du sens, elle éclaire une œuvre, quelle qu’elle soit, et l’opéra n’est pas forcément condamné à des mises en scènes illustratives faites pour de belles photos, avec des beaux costumes dans des décors rutilants. Faire plaisir parce qu'on fait penser devrait être une loi du théâtre aujourd'hui.
Mais comme toujours, un grand travail de mise en scène trouve aussi son sens et son appui dans un travail musical exemplaire ; sinon il tourne à vide. Une des causes de l’échec des hurlements des agités est justement le succès musical de l’entreprise, si souvent interrompue par des ovations à scène ouverte, avec le bis bienvenu du « Va pensiero… ». Il faut effectivement d’abord rendre justice au chœur magnifique du Teatro Regio préparé par Martino Faggiano, clarté de la diction, phrasé, puissance mais aussi sens de la nuance et de la couleur. Un moment d’exception.
Il faut ensuite rendre justice au jeune chef Francesco Ivan Ciampa, qui d’abord ne bronche pas devant l’agitation du public, et même devant les agressions (« Maestro comment pouvez-vous permettre cela ? »). On comprend qu’il y a une cohésion forte dans l’équipe artistique, sans doute heureuse dans son ensemble de contribuer à quelque chose qui enfin sorte des sentiers battus. Sa direction n’est jamais tonitruante, toujours tendue, avec une vraie pulsation et un orchestre sans scories. Il y a l’énergie, la force, mais aussi la dynamique et le lyrisme, sans jamais de relâchement. Ciampa fait partie de cette jeune génération de chefs italien qui en ce moment arrivent à un niveau d’excellence enviable : quel autre pays peut se vanter d’un tel nombre de jeune chefs intéressants : on commence à se les arracher à l’étranger. Malgré les difficultés de la vie artistique locale, les conservatoires continuent à former et produire des artistes vraiment dignes d’intérêt. Il en va de même pour les orchestres, souvent d’une qualité qui va bien au-delà de leur réputation.
Et puis il y a une distribution sans l’ombre d’une faiblesse, à commencer par les rôles de complément très bien tenus par la jeune Anna puissante de Elisabetta Zizzo, de Gianluca Breda (Grand prêtre sonore) et l’Abdallo de Manuel Pierattelli.
L’Ismaele d’Ivan Magrì au timbre clair et à la voix bien projetée est moins lyrique peut-être, mais plus engagé, très expressif et presque plus guerrier dans une partie souvent sacrifiée.

Annalisa Stroppa est une Fenena lyrique, à la voix très présente, au timbre chaud et de grande qualité : elle sait s’imposer dans les ensembles tout en montrant dans les parties solistes un raffinement exemplaire. Voilà une artiste qui s'impose peu à peu comme l'un des plus intéressants mezzos de la scène actuelle .

Michele Pertusi remporte un triomphe mérité : il a tout, l’autorité indéniable, le sens du texte, dit avec une attention extrême, veillant l’expression de toutes les inflexions, avec un sens de la couleur exemplaire. C’est à la fois un chant complètement maîtrisé, et une expression d’une humanité profonde. Tout dans sa technique de fer rappelle quel belcantiste et quel rossinien il fut. Vraiment fabuleux.
Saioa Hernández est une Abigaille exceptionnelle. Elle a évidemment les aigus nécessaires, mais aussi l’agilité vocale, l’homogénéité du grave à l’aigu (notamment dans les scalette initiales) mais aussi une retenue, un certain lyrisme qui la rend, notamment dans la scène finale, particulièrement émouvante. Elle domine le rôle, dans sa froideur et aussi dans ses failles. Monstrueuse, mais humaine. Et son chant complètement dominé donne à voir tous ces aspects du personnage. Une Abigaille qui sait nuancer, c’est assez rare pour être souligné. Il n’y en a pas beaucoup sur le marché.
Enfin, Amartuvshin Enkhbat, qui a une voix naturelle exceptionnelle en étendue, en profondeur et en puissance a beaucoup muri : il a désormais un phrasé italien impeccable, une diction exemplaire et une véritable expressivité, ce qui lui manquait naguère. Il en résulte un Nabucco en tout point exceptionnel, avec une autorité sans défaut, mais aussi dans les moments plus retenus une véritable présence, notamment dans sa scène avec Abigaille (partie III): les « deh perdona… ad un padre che delira » sont vraiment lacérants. Superbe.
Voilà une production qui devrait montrer le chemin à un Festival Verdi dont l’identité ne semble pas encore bien assise. La réussite de l’entreprise, malgré les cris d’orfraie, est un gage important pour l’avenir. Un Festival Verdi ne sert à rien si nous est présenté ce qu’on voit partout ailleurs. Même si le public local, qui baigne dans Verdi et s’en fait le défenseur depuis longtemps, au point d’être considéré comme une « légende théâtrale », proteste, c’est tout de même la voie de la singularité qu’il faut emprunter, pour marquer son territoire. Mais cette voix n’est garantie, on l’a vu, que si la musique est irréprochable, car alors toute l’entreprise prend sens. Ricci/Forte d’un côté, Ciampa et toute la distribution de l’autre nous ont montré quelle puissance visionnaire Verdi peut atteindre quand le sens de l’œuvre est ainsi révélé.


Sorry. I understand French well but cannot write it. Hence, my English.
I disagree with you totally.
The problem was not that this Nabucco was moved from Babilonia to a 2047 oppressed nation. The problem is that they did it in a very ineffective way.
Mimes everywhere bothering in a visible way the great singers. Useless additions of book grinding, people drowning etc.
This is the arrogance of a couple of relatively unknown directors who believe that the opera becomes theirs and disregard Verdi completely.
This is also the need of reviewers that understand very little of music and focus only on the staging.
Go to Salzburg to see how Handel and Mozart and also Verdi can be “modernized” without destroying their music. The public in Parma, that you clearly consider unsophisticated and less intellectually capable than you, would not boo in Salzburg.
Best
Buongiorno Sign. Andreotti
Non condivido ovviamente il suo commento. Vado a Salisburgo come Lei, e come dappertutto, certe regie sono buone, altre meno…
Non sono sicuro che l'ultima Aida salisburghese sia stata un modello di modernità. E non penso che la Medée di quest'anno sia piacuta, pur moderna…
Ma poco importa. Vorrei rispondere solo sul pubblico di Parma che non disprezzo come sembra supporlo. Anzi, che non apprezzi una regia e lo faccia sapere perché no, ma non già dall'alzare del sipario ! Che manifesti la sua ira alla fine dell'opera, non disturbando lo spettacolo, sarebbe più giusto. Mantengo che un parte del pubblico "aspettava" la produzione per disturbarla. Mantengo anche che la regia di Ricci/Forte da all'opera di Verdi un vero senso, e ne rispetta il libretto.
Cordialmente
Guy Cherqui