
Le public debout hurlant son enthousiasme, c’est une vision rare, sinon rarissime à Genève. Et pourtant, après quatre heures de spectacle sans entracte (mais avec la possibilité d’entrer et sortir, ce dont les spectateurs n’ont pas trop abusé d’ailleurs), on est resté cloué dans son fauteuil, de peur de rater pendant les quelques minutes d’absence quelqu'idée fulgurante, quelqu'image fascinante.
Car Daniele Finzi Pasca, a choisi de montrer tous les possibles du rêve : l’univers onirique est en effet l’une des clefs d’un spectacle fait d’images successives, de séquences qui utilisent toutes les ressources du théâtre, la virtuosité, la technique théâtrale traditionnelle, la technologie et la variété des genres, avec l'humour en prime, dans une oeuvre qui est musicalement particulièrement et volontairement répétitive (c’est le principe de la musique de Philip Glass) et dont la transcription scénique tranche, et finalement aide à différencier cette musique.
Et ce qui vient de la fosse est particulièrement vivant et étonnamment varié : peu à peu on s’habitue à ces rythmes et on s’y plonge, et on s’amuse des variations, des répétitions, des retours de motifs et des changements progressifs. Les textes ne nous fatiguent pas trop (répétitions de chiffres ou de notes) et sont vraiment mis merveilleusement en bouche par les voix de la Haute École de Musique de Genève, qui a fourni aussi les jeunes musiciens, formant pour l’occasion un excellent Einstein Ensemble que le chef Titus Engel dirige avec une rare souplesse. On pourrait en effet rendre cette musique mécanique et lancinante, on pourrait faire plonger l’auditeur dans une sorte de géométrie sonore ennuyeuse et anesthésiante, ici au contraire Titus Engel a choisi le travailler sur la variation et la variété, sur la dynamique, sur le changement permanent dans la continuité, ce qui fait qu’au bout des quatre heures, la musique apparaît moins répétitive, voire allègre, voire colorée (illusion sans doute d’un spectateur fasciné et hypnotisé par le spectacle qui, aux mirages de la scène croit entendre répondre des mirages sonores). Car la partition fondée sur très peu de motifs, se développe en 4h au point de sembler diverse. Comme le dit Titus Engel, « beaucoup de remous avec peu d’ingrédients ». Il en est résulté un travail attentif avec les élèves de la Haute Ecole de Musique (trois ateliers depuis un an environ) qui sont, par le fait d'être des "élèves", plus disponibles, plus ouverts et moins engoncés dans des certitudes ou dans une tradition, et puis il a effectué aussi des enregistrements avec et sans les voix pour que les acteurs-chanteurs-acrobates de la compagnie puissent répéter sur les rythmes voulus, la cohésion entre scène et plateau étant déterminante dans pareille œuvre.
La fosse concentre tout ce qui est vocal et musical (il faut souligner la prestations très remarquable des voix du chœur), avec l'émergence du merveilleux violon solo de Madoka Sakitsu et du côté des voix, d'une seule soprano (Ana Belén Gabaldon Sanchez) qui apparaît sur scène pour chanter (sans paroles) dans un moment d’une grande beauté et sensibilité : c'est le seul moment référé à l’opéra traditionnel. Mais – est-ce un paradoxe?- aussi bien Daniele Finzi Pasca que Titus Engel se réfèrent, pour expliquer la contemporanéité de l'œuvre, au monde ancien. Finzi Pasca précise « j’appartiens à une manière de concevoir le monde qui est celle de la Renaissance », soulignant par là qu’il est cirque, acrobatie, théâtre et donc tout à la fois , en lui-même singulier dans sa pluralité ; et Titus Engel précise combien le travail sur le baroque l’a aidé à comprendre et travailler la musique contemporaine, dont il est considéré comme un spécialiste, et rappelle au passage qu’autoriser les gens à rentrer et sortir de la salle était une pratique des temps baroques (même si sortir d’une salle alors sans sièges ou sortir d’une loge est plus facile que faire lever des rangées entières de spectateurs). Car c’est bien le principe baroque que Glass a ici appliqué d’œuvre longue (les opéras duraient quelquefois bien plus que les quatre malheureuses heures genevoises) et a favorisé la liberté picorante du spectateur, qui peut choisir ses moments.
Titus Engel pratique le matériel musical avec un tempo très libre car il n’y pas d’indications précises dans la partition, Glass et Wilson ayant monté le spectacle ensemble, sur le moment. Le chef a dû se référer aux enregistrements existant pour s’orienter, mais il a gardé, comme pour la musique baroque, une très grande liberté d’initiative et de fait cela sonne autrement. Et c’est une performance remarquable qui a été ici livrée. Là aussi Aviel Cahn, en faisant appel à d’autres forces genevoises (Haute École de Musique, Festival de la Bâtie), réinscrit le Grand Théâtre au cœur des forces créatrices de la ville, et non à côté. Enfin, par un opéra en quatre actes qui n’en est pas un, il permet à un public qui n’a rien à voir avec l’opéra d’entrer dans la maison voir ce qui se passe , et comme tout le monde, de rester fasciné par le spectacle offert.
Car fascination et séduction sont bien les deux mamelles du spectacle conçu sur la musique de Philip Glass, avec un travail évident construit avec le chef, car comme entre Glass et Wilson, il y a entre Engel et Finzi Pasca un système d’écho scène-fosse qui donne à l'ensemble une respiration qui se ressent profondément.

Wilson est le maître des abstractions, des ombres, de la géométrie des déplacements et de la lenteur. Finzi Pasca montre d’abord la concrétude : c’est un spectacle concret qui montre des gens et des choses ; onirique ne veut pas dire abstrait, il signifie simplement que le concret s’étire vers l’impossible, un concret plastique, où une robe orange devient comme les volutes d’une méduse à la faveur d’une plongée dans un aquarium d’une acrobate-danseuse, on voit des vélos, mais des vélos qui volent (un monde qui discrètement rappellerait un Jean Bellorini), une sirène volète en l’air sur fond de vidéos vaguement aquatiques, mais aussi une plage, où Einstein se repose sur une chaise longue (ça Wilson n’avait pas osé…), où des joueurs jouent au ballon, ou au badminton.
Et tout commence et se clôt sur le bureau d’Einstein, sur ses collaborateurs affairés qui déplacent dossiers et livres, et Einstein qui écrit au tableau noir ses formules cryptiques, mais on s’aperçoit que la bibliothèque grandit insensiblement jusqu’à prendre toute la hauteur de la scène. C’est là la relation élastique entre le réel et le rêvé, c'est là le basculement. Fascinante aussi la scène où la dite bibliothèque est vue au centre sur un écran vidéo et où les acrobates semblent monter et descendre et voleter, alors que la caméra reprend ces acrobates au sol mimant les mouvements sur un décor qui fournit la clé du trucage vidéo : ce dévoilement fascine au point que la longue séquence paraît passer en un éclair. Jeux sur les miroirs, jeux sur les lumières dans les miroirs avec ces longs tubes lumineux diversement agencés qui s’adaptent au rythme musical en un ballet horizontal ou vertical, image abstraite immédiatement traversée par un homme qui vole, intrusion du concret ; mais aussi jeux sur le capote de torero, avec lumières et miroirs, moines tibétains (évidemment choisis pour leur capacité innée à léviter), mariée qui finira, elle, en lévitation. Voilà les personnages qui traversent ce spectacle à la fois irréel, réaliste, et toujours poétique.
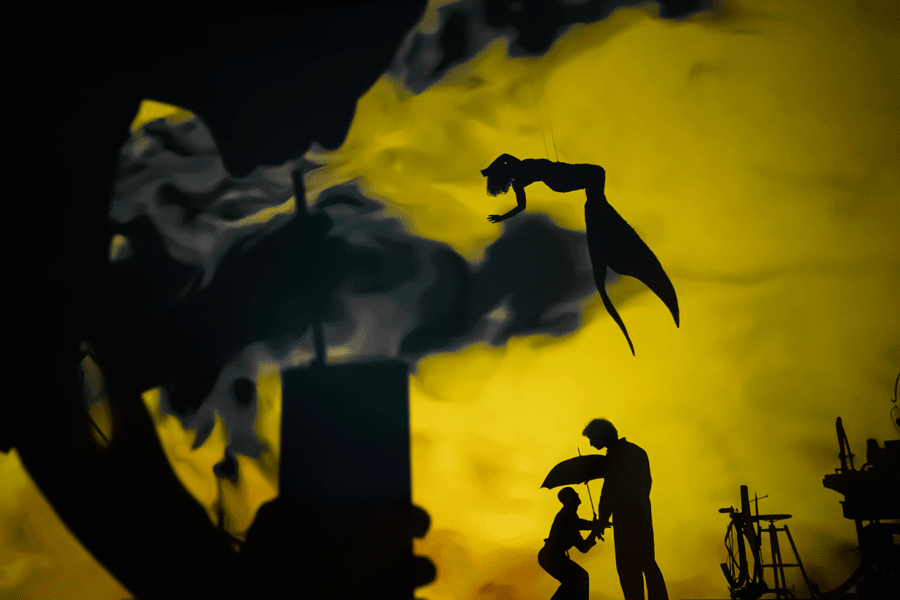
On s’aperçoit vite que ce travail cherche à traduire les conséquences des recherches d’Einstein sur notre monde, sur notre espace vital et et sur l'espace des possibles, sur ses possibles physiques en terme de gravitation, de profondeur, d’infini : on marche, on danse, on vole, on nage, dans une valse étourdissante de formes et de tableaux différents, qui clouent le spectateur dans son fauteuil, avec la dose d’humour jamais exagérée, une succession de pointes de sourires toujours esquissées, comme la manière dont une acrobate trempe son pied dans l’eau qu’on croit être un bassin peu profond, et que l’autre y tombe à la surprise de tous, parce que le bassin est en fait un aquarium circulaire qui surgit des profondeurs ! On pourrait citer aussi le surgissement brutal de la sirène, plus fausse que nature, et tellement vraie pourtant "nageant" dans les airs. Il faut souligner d’ailleurs à ce propos le travail éminent des techniciens du théâtre : c’est aussi pour Cahn une manière d’éprouver la machine dont il dispose et d’en mesurer les capacités. Examen réussi…
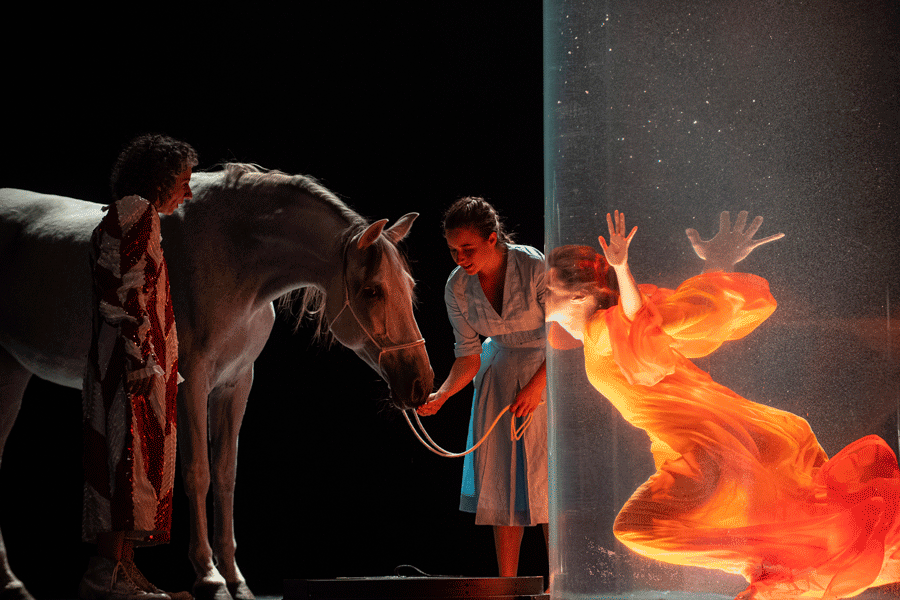
Et puis la fin, avec ces paillettes argentées qui tombent à l’infini sur le plateau, qui font croire d’abord à une fin un peu convenue, dont le prolongement dans le temps change complètement notre vision. Voilà la scène traversée par les diverses images du spectacle, comme à rebours (dont ce magnifique cheval blanc qui regardait avec tant de curiosité la femme méduse dans son aquarium) à travers une brume lumineuse qui devient brume de nostalgie, presque fête de la mélancolie.
Ainsi Aviel Cahn((À signaler parmi les nouveautés l’excellent programme de salle, clair, au design séduisant qui éclaire la production avec des interviews et des textes limpides et sans aucun pédantisme)) a pris l’initiative de faire sortir Einstein on the beach de l’éternelle contemporanéité dont on va dire, 40 ans après « oh ! ça a un peu vieilli », parce qu’il la fait entrer au répertoire, c’est à dire dans le monde des œuvres reprises parce qu’elles ne vieillissent plus. Il a rompu le charme Glass-Wilson, peut-être suranné même si génial, et a fait entrer l’œuvre dans notre actualité, en montrant qu’elle peut affronter une autre production, une autre équipe, et qu’elle vit, et je dirais même plus, elle en vit d’autant plus en montrant qu'elle a de l'avenir.

