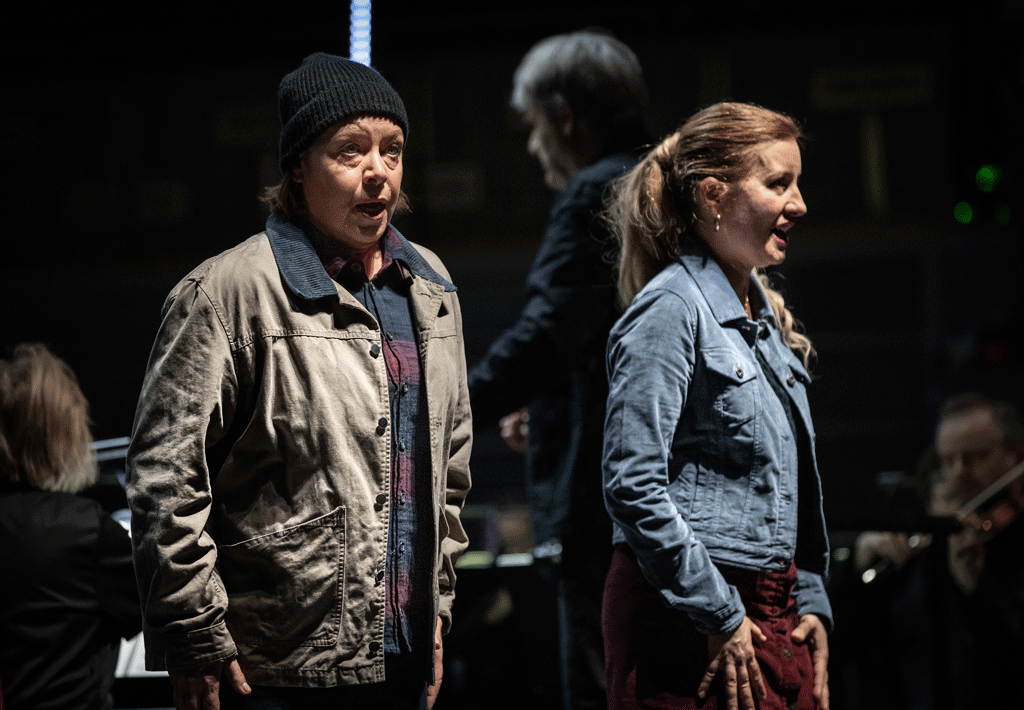
Konserthuset aime bien braconner (gentiment) sur les terres du Kungliga Operan (Opéra Royal). L’hiver dernier, c’était une double affiche, Dubbeldrama (Double drame) avec Erwartung de Schönberg et Le Château de Barbe Bleue de Bartók dans une version semi concertante (Bengt Gomér, ici aux costumes, y tenait le rôle de metteur en scène et de scénographe). Nina Stemme y partageait l’affiche avec Johannes Martin Kräntzle et Katarina Karnéus et c’était un grand moment.
En cette année anniversaire Beethoven, Nina fait la paire avec John Lundgren, qu’elle ne quitte plus, vu qu’elle l’affrontait déjà dans Le Château de Barbe Bleue à l’Opéra de Munich quelques semaines auparavant. Le parallèle n’est pas vain : dans les deux mises en scène, Nina est undercover. Flic de choc jouant les fausses victimes pour sauver les femmes précédentes dans Barbe Bleue, Léonore se travestit ici en Fidelio pour filer à la rescousse de son petit mari. Notre époque est décidément placée sous le signe de l’intrigue policière…
Et de la société de contrôle : le plateau est entouré de néo-néons LED verticaux, délimitant l’espace scénique, entourant les musiciens de barreaux lumineux (prison laser, de Star Wars à Subway). Au fond, une cage tout aussi lumineuse (rappel du siècle des Lumières…) accueillant Florestan et au centre, un mirador-réverbère LED, qui rappelle le dispositif carcéral mais aussi nos « mobiliers urbains ». C’est sans doute ce que veulent souligner Bengt Gomér (scénographie et lumière) et Helena Helle Carlsson (costumes) : la prison et la tyrannie ont contaminé l’espace commun et le passage de la liberté à l’emprisonnement peut être plus rapide et arbitraire qu’on ne le croit (on pense au film Missing de Costa Gavras, voire à certains contrôles « préventifs »… en France en ces derniers temps de Frondes diverses). Ainsi, les sbires de Pizarro ont des uniformes qui ressemblent étrangement à des combinaisons paramilitaires et Pizarro lui-même, avec son blouson type Bombers, ressemble plus à un vigile qu’au gouverneur qu’il est censé être.
L’orchestre est donc emprisonné et, avant l’Ouverture, des femmes circulent avec des photos à la main. On pense aux femmes des Desaparecidos Argentins. Elles les montrent aux musiciens sans succès… Un sbire brutal arrive avec un homme et l’installe sans ménagement au pupitre : c’est Thomas Dausgaard !
Léonore en quête de son desaparecido de Florestan, homo sacer selon Agamben, poussée par les femmes, se tranche la natte pour se jeter dans la gueule du loup. Affranchissement, rite de passage, attachement à celui qu’on aime, Léonore-Mathilde de la Mole prend la voie de non-retour sous les encouragements de ses compagnes d’infortune.
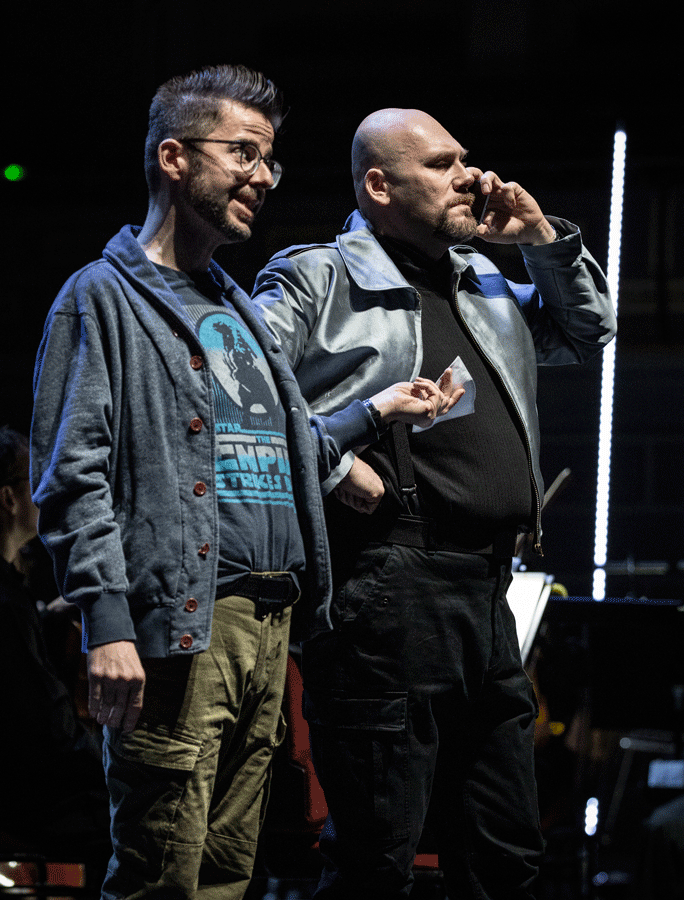
Des rumeurs annonçaient puis n’annonçaient plus une version semi concertante, puis qu’elle serait assurée ici à Stockholm mais peut-être pas à Paris… Sur le même thème, le programme papier du jour n’indique pas qui tient le rôle de Jaquino. On aurait pu craindre le pire et pourtant c’est un très bon Jaquino en la personne de Daniel Johannsen qui tient le rôle ainsi que celui du récitant en allemand permettant de trancher dans les longs récitatifs. Jaquino est un rôle plutôt ingrat, de chien dans le jeu de quille, avec peu de chant. Il est ici l’outsider, le nerd : il porte d’ailleurs un T‑shirt de The Empire Strikes Back, le deuxième volet, noir, de la trilogie de George Lucas. L’Empire fait écho aussi à cette notion de pouvoir, de spectacle concentré (revers de la médaille du notre, spectaculaire diffus)((selon les catégories élaborées par Debord dans sa Société du Spectacle)) à l’œuvre dans Fidelio et dont l’âme damnée dans un gant de fer serait Pizarro.
C’est en tout cas une très bonne idée de donner à Jaquino le rôle central explicatif et Daniel Johannsen fait le show, en enfilant presque une tenue Papagenesque (le côté Singspiel et Mozartien du premier acte) avec une diction très précise d’Évangéliste à la Bach((rôle dans lequel il excelle, apprend-on, dans le programme… du Théâtre des Champs Elysées)) et un beau charisme. Il ne faut jamais se moquer des nerds : le monde leur appartient et généralement, plutôt tard que tôt, ils finissent par obtenir ce qu’ils veulent, comme on le verra à la fin de ce Fidelio. Ce Daniel Johannsen/Jaquino est la très bonne première surprise de la soirée.
Il forme un beau duo avec Malin Christensson, mozartienne bien sûr mais pas seulement (elle tint la partie de soprano dans une Mahler 2 ou encore des rôles de soprano léger chez Wagner). Elle nous a paru ce soir-là un peu empêchée avec une émission réduite, un spectre un peu étroit malgré de très belles couleurs, une vraie fraîcheur et beaucoup de légèreté. On a d’abord craint pour la suite mais elle s’en est tirée à chaque fois sans (trop) dépareiller avec le reste de la troupe, y compris dans le quatuor.
Pour l’heure, comme dans le Barbe Bleue Munichois, Stemme-Léonore s’investit totalement dans sa couverture. Ici, Sam Brown, le metteur en scène (on lira plus bas la chronique par Guy Cherqui d’un Il Barbiere di Siviglia à Genève en 2017), la fait flirter ouvertement avec Marzelline, sans remords pour la déception à venir de la jeune fille (à l’encontre du livret). La fin justifie désormais les moyens. Encore un signe de notre époque.
Hommasse, bonnet enfoncé, blouson type jean (unisexe mais faisant écho à celui de Marzelline et à celui qu’elle portait avant l’Ouverture, un peu plus féminins), Stemme incarne un Fidelio moderne, assez commun.
Rocco est Johan Schinkler dont la basse généreuse s’accorde idéalement au rôle de bonhomme terre à terre, soucieux de ses intérêts, un peu naïf et sans doute guère courageux mais aussi plein de bon sens lié à sa condition. Il donne à son air Hat Man nicht auch Gold beineben (n°4), un côté léger, presque bouffe, mais aussi solide et sérieux si on pense aux contingences de sa condition et Schinkler joue agréablement des deux registres. On le reverra avec plaisir cet automne dans le rôle du Roi Marke à Folk Operan dans une nouvelle production de Tristan & Isolde par Linus Tunström et dirigé par Marit Strindlund.
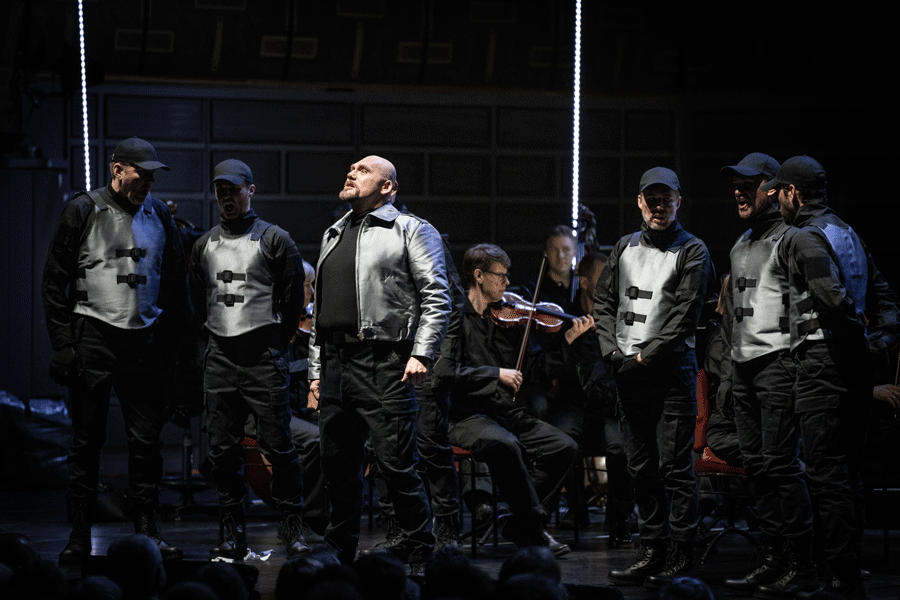
La seconde bonne surprise est celle de voir s’ébattre sur la scène les deux monstres de théâtre que sont Stemme et Lundgren. On ne les sent pas seulement à l’aise, ils sont totalement dans leur élément, arpentant la scène comme un terrain de chasse pour fauves.
Lundgren, dont le physique en impose, est un monstre de cruauté (après Barbe Bleue, évidemment…). Il est tout en jeu : mines, air supérieur, roulades d’yeux, pression physique impressionnante. Il occupe la scène qui lui appartient totalement. Sa voix gagne chaque année en assurance et en profondeur : on l’avait trouvé inégal en Wotan au Kungliga Operan en 2017, lors du deuxième cycle, puis assez impressionnant en Holländer à Bayreuth en 2018 et on se réjouit de le retrouver à nouveau à Bayreuth cet été en Alberich. Ici encore, c’est sa diction hyper précise qui frappe, dans son Arie mit Chor (n°7) mais plus encore dans son duo avec Rocco (n°8). On se souviendra longtemps de son Ein Stoss – und er vertsummt ! si expressif, tout de malignité consommée.
Pendant le solo de Fidelio (n°9 récitatif et air Abscheulicher ! Wo heilst du hin et Komm, Hoffnung, lass den letzen Stern), Stemme s’installe au cœur de l’orchestre pour se donner du courage et nous enflammer car la leçon est magistrale. On pense à Birgit Nilsson, dont elle a reçu le prix l’an passé. Quel théâtre et quel feu ! On ne cesse d’être ébahi par son jeu et sa plasticité vocale. D’un coup, le lourd Fidelio hommasse redevient frêle jeune fille par la grâce de sa voix, sa fraîcheur évoquant ses doutes et angoisses et surtout sa foi absolue et résolue en sa mission. On est sous le choc. On aimerait suspendre le temps mais on est (malheureusement ?) emporté par le flux de la musique.
Ce qui étonne toujours c’est que Stemme a une puissance incroyable qu’elle utilise avec parcimonie ou plutôt dont elle ne veut jamais tirer totalement parti. Elle travaille le sens, les couleurs, s’adapte à la salle, aux collègues, au moment présent et on sent toujours qu’elle a une réserve inépuisable. Tout est fluide (superbes arpèges descendants), aisé, galvanisant. Sa sortie après son air ne peut retenir les applaudissements du public. Triomphe.
Ultime atout de ce Fidelio, Radiokören. Le chœur de la Radio Suédoise, toujours aussi parfait, investit la salle par les portes latérales du parterre, entourant le public de ses voix pour se recentrer sur la scène. L’effet est consommé, surtout en Suède où il rappelle les cérémonies chorales de Sankta Lucia (Sainte Lucie), mais toujours efficace. Comme à chaque fois, on se délecte de ce chœur si professionnel et enthousiaste, un des joyaux de la couronne suédoise. Des tuilages parfaits, des descentes caverneuses dans les graves et un magnifique Premier Prisonnier, quasi angélique.

On aime beaucoup le ténor Michael Weinius ici ((on lira plus bas le compte-rendu de Guy Cherqui sur son Siegfried dans la production Dieter Dorn de Genève)). On l’a entendu personnellement dans tous les grands rôles wagnériens au Kungliga Operan (notamment en Lohengrin en 2012, en Parsifal en 2013 et 2016 et en Siegmund toujours en 2013 puis 2017, en Tristan en 2015…) et il nous a enchantés à chaque fois par son engagement scénique, son chant jeune et clair, jamais époumoné. On suit avec plaisir sa montée en grade sur les scènes prestigieuses ((il sera Tristan face à Ricarda Merbeth à Covent Garden en avril et mai)). Il est forcément à la fête dès le début de l’acte II avec son récitatif et air Gott ! Welch Dunkel hier ! O graunvolle Stille et In des Lebens Frühlingstagen, chanté presque comme un lied Schubertien.
Le second acte, ouvrant la Zukunftsmusik à venir (mélodrame et duo Rocco/Leonore, n°12), est encore plus ramassé que le précédent, dans des tonalités plus pastel, mozartiennes : les numéros s’enchaînent à présent à tambour battant, et même à timbales battantes avec un timbalier preste, félin, presque jazz. C’est d’ailleurs le sens de la mise en scène et de la direction de se concentrer sur l’action, toujours sur un rythme haletant (avec un Thomas Dausgaard au four et au moulin, n’hésitant pas à se retourner pour suivre un chanteur), pas toujours évident pour les bois et les cors mais l’ensemble est très efficace, à l’image du quatuor (n°14), confrontation/révélation avec un Pizarro/Lundgren plus assoiffé de sang que jamais (Er Sterbe !, terrifiant dans les sifflantes serpentines).
Sortie de gros guns, trompettes salvatrices (en coulisses), Es schlägte der Rache Stunde en somme. Après un très beau duo Leonore/Florestan qui permet d’apprécier encore la maestria de Stemme s’accordant totalement avec Weinius, O Namenlose Freude !
On se passe de l’Ouverture Leonore III, à rebours de la tradition popularisée par Mahler, toujours dans le sens de la concentration recherchée depuis le début du second acte et l’arrivée de Fernando achève de clore l’action. Fernando est le baryton Karl-Magnus Fredriksson, chanteur de lieder émérite (il fut l’élève de Dietrich Fischer Diskau) et pilier de la troupe du Kungliga Operan. On l’a entendu cette année dans un Oneguine((dans une production très intéressante de Vasily Barkhatov)) au bout du rouleau mais très en forme en Germont dans la nouvelle production de La Traviata((mise en scène d’Ellen Lamm)). Avec un timbre chaleureux et une belle présence, il résout les problèmes, « non pas comme un tyran insensible » mais « comme un frère qui cherche à connaître ses frères », à la Sarastro donc, c’est à dire à la main fraternelle… quelquefois lourde : Pizarro prend la place de Florestan dans la cage. Gentils réunis, méchants punis, chœur allègre, femmes retrouvant leurs maris enfin libres. Happy ending. On aurait aimé peut-être une fin moins univoque, les indices scéniques du début pouvaient y conduire (on pense à la chansonnette ironique Happy End poussée par Hélène Surgères et Sonia Saviange à la fin de Femmes Femmes de Paul Vecchiali) mais elle colle à la partition et à l’esprit de l’opéra. Peut-on envisager notre monde contemporain, de spectacle diffus, toujours selon les mots de Debord, et à tendance de plus en plus policière sinon concentrationnaire, trouver une fin heureuse par l’arrivée d’un bon ministre aux allures de Despote ?
Une note douce-amère flotte pourtant, preuve que tout n’est pas que miel et ut majeur, dans les échanges de regards (l’un est heureux, l’autre honteuse et gênée) que se jettent Jaquino et Marzelline « condamnés » à reformer leur couple d’avant Fidelio. C’est ce regard et cette prise de main (reprise en main forcée ?), très Così pour le coup, que l’on garde à l’œil pendant le glorieux final avant de se laisser couler, malgré tout, dans l’effusion musicale des retrouvailles conjugales.

