
Bartlett Sher est un metteur en scène favori du MET, précédé d’une réputation flatteuse aux USA, tant au théâtre, qu’au musical ou qu’à l’opéra. Cette production spectaculaire, aux décors de Michael Yeargan monumentaux autant qu’inutiles avec de riches costumes XVIIIe assez réussis (de Catherine Zuber) est une de ces productions faites pour de belles photos,qui rendent heureux le spectateur avide de tape à l’œil. Elle commença sa carrière à Salzbourg en 2008, puis à la Scala et enfin au MET avec le couple Grigolo-Damrau . Dramaturgiquement elle n’apporte rien qu’une illustration aimable et traditionnelle du drame au demeurant bien rendu par les librettistes Barbier et Carré. En fait le décor unique (une façade Renaissance) entoure un espace de jeu tout aussi unique et donc ce décor énorme ne sert à rien qu’à la photo, car tout se déroule sur l’espace central, tour à tour palais des Capulets, place de la ville, chambre des amants et tombeau avec quelques éléments plutôt épurés, ce qui contraste avec le pompeux du cadre. Était-il utile de construire des décors aussi monumentaux seulement comme cadre ? Des toiles peintes auraient suffi…ou le vide à la Peter Brook, qui aurait peut-être donné une valeur plus grande à l’espace central et moins étouffé le spectacle.
Les costumes riches et jolis à voir n’ont pas d’autre fonction non plus que d’être jolis et font simplement ressortir la richesse du côté Capulet et le côté mauvais garçon de la bande de Romeo (les Montaigu). Du point de vue dramaturgique, du point de vue de la conduite d’acteur, on est au degré zéro, chacun faisant ce qu’il fait toujours, la mise en scène laissant les chanteurs à leurs habitudes.
Il ne se passe donc rien, rien de plus que ce que le livret nous dit, sans intérêt aucun, sauf qu’on se concentre ainsi sur la musique de Gounod, qui fleure la fin de la mode du grand opéra avec ses chœurs (mais sans son ballet ici coupé), avec ses nombreux personnages, son rôle travesti (Stephano) et son agitation. Seul moment particulièrement bien réglé, le deuxième acte et ses duels, parfaitement au point, comme dans tout film américain qui se respecte, grâce à la chorégraphie des combats travaillée au cordeau par B.H. Barry.

Musicalement, les choses passent sans encombre, même si elles auraient pu être plus stimulantes, notamment en ce qui concerne la Juliette de Diana Damrau. Il ne suffit pas d’un couple vedette pour faire la réussite d’une soirée et l’hirondelle (ici l’alouette…) ne fait pas le printemps. Diana Damrau sort d’une période de fatigue et la voix n’a pas la sûreté nécessaire, les aigus sont difficiles, assez courts, voire à la limite de la justesse, et le premier air, la valse Je veux vivre tombe singulièrement à plat : manque de brillant, manque d’énergie, manque de vivacité juvénile. Les moments plus lyriques sont mieux dominés, avec de magnifiques mezzevoci et une technique de fer mais elle semble rester souvent extérieure et n’arrive pas à habiter ce soir un rôle où elle a souvent triomphé pourtant.
Vittorio Grigolo au contraire n’a aucun problème vocal, la voix est éclatante, le timbre solaire, et c’est un Roméo contrôlé (plus que ce à quoi il nous a habitués) que Grigolo propose. Donc on vérifie une fois de plus que Grigolo est l’un des grands ténors lyriques de ce temps et que peu de ses collègues peuvent lui disputer une voix exceptionnelle.

Mais Roméo, même avec sa vaillance et sa fougue, n’est pas Alfredo : même avec une technique notable, Grigolo n’arrive pas à cueillir le personnage dans toute la délicatesse et la poésie inhérentes au rôle. Ce que les Shicoff ou les Kraus jadis réussissaient, en travaillant sur la subtilité et le verbe, à savoir dessiner un univers, d’une jeunesse rêveuse et un amour éperdu qui transforme le personnage de chef de bande à pacificateur, et qui trouve en l’amour la source d’une maturité nouvelle, Grigolo n’arrive pas à le rendre pleinement et passe quelquefois à côté. Ce n’est pas une question de diction, car son français est impeccable, c’est une question d’intériorité qui n’est pas toujours au rendez-vous, et de profondeur qu’il n'arrive pas toujours à faire sentir, y compris dans Ah, lève-toi soleil un peu trop lumineux et insuffisamment éthéré…Il réussit néanmoins à émettre des sons magnifiques, des mezzevoci très réussies et à être très contrôlé dans Comme un flot de la lumière se perd dans l’infini, mais pour mon goût, la couleur générale est un peu trop brillante malgré les qualités très réelles et une prestation notable. C’est donc ni une question de voix, ni de technique, ni de diction, mais peut-être de style.
En dehors du couple protagoniste, beaucoup de rôles moins importants sont bien tenus où l’on remarque d’abord le Mercutio bien planté de Mattia Olivieri. Le jeune baryton italien outre une présence scénique notable et un jeu alerte et vivace, montre une diction française enviable même si son air de la reine Mab a peut-être besoin d’un poil de brio supplémentaire. Un nom déjà remarqué qu’il faut suivre.
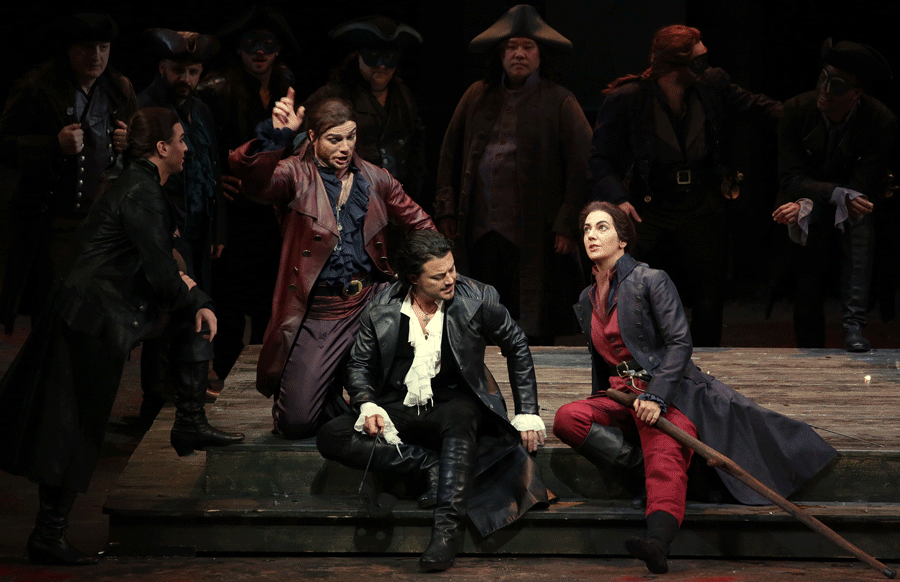
Autre élément notable, le Stephano de Marina Viotti, au mezzo lumineux, affirmé, à la diction claire, à la voix puissante qui ne manque pas d’intensité, son air Que fais-tu, blanche tourterelle très réussi est plutôt un des beaux moments de la soirée.
Notons aussi le frère Laurent à la fois chaleureux et humain de Nicolas Testé, à la basse puissante et claire, qui donne au personnage un vrai poids et le Capulet à la belle autorité de Frédéric Caton, tout comme le Duc épisodique mais à l’intervention marquée de Jean-Vincent Blot mais le Tybalt de Ruzil Gatin manque un peu d’arrogance et de relief, malgré un jeu satisfaisant (beau duel). Enfin dans le rôle de Gertrude, l’excellente Sara Mingardo me semble un peu en sous-régime. Il est vrai qu’elle est aussi sous-utilisée dans ce rôle.
Le chœur de la Scala préparé par Bruno Casoni au phrasé impeccable rappelle quelle formation il est, avec sa puissance et son sens du rythme.
Enfin Lorenzo Viotti à la tête de l’orchestre de la Scala pour la première fois n’a pas démérité en obtenant un beau succès auprès du public milanais. Malgré un prélude un peu trop éclatant ou brillant peut-être, il a su accompagner avec élégance et finesse les grands moments lyriques du drame et scande d’une manière affirmée les éléments de la tragédie, c’est à fois vigoureux et très contrôlé avec une vraie capacité à ciseler le texte musical. Il a bien convaincu dans les moments les plus lyriques, et sa direction a le mérite de la clarté et de la rigueur. C’est une entrée plutôt réussie dans le temple milanais à, la tête d’un orchestre très au point et sans scorie aucune…
Une soirée contrastée, une mise en scène insatisfaisante, même si « fidèle au livret », et un ensemble très digne, mais qui ne transporte pas .

