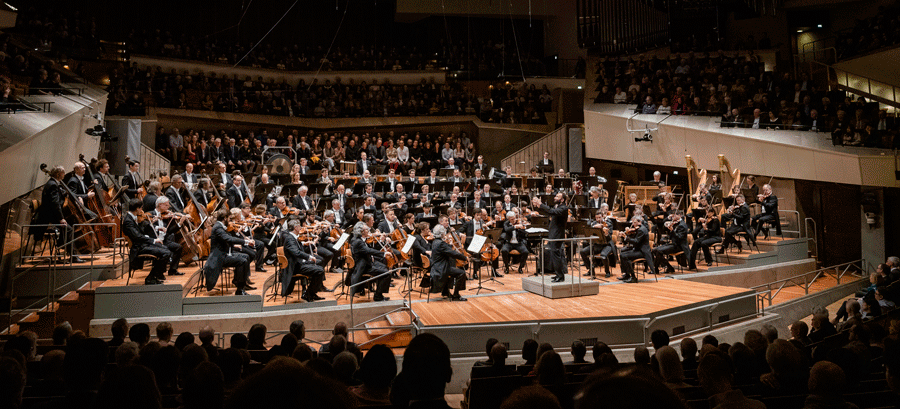
Le programme de la soirée est exclusivement consacré à cette Sixième, on pourrait dire « concentré » plutôt que consacré. Et nous avons beaucoup tardé à publier cet article, les événements extérieurs à notre volonté n’y étant pas étrangers, mais aussi une réflexion sur cette manière de diriger qui peut aussi bien désarçonner qu’enthousiasmer.
Nous voulions donc faire un peu le point sur ce chef, que nous admirons, évidemment, mais qui échappe aussi par son approche des œuvres à ce à quoi nous sommes habitués.
Kirill Petrenko est d’abord un lecteur des partitions, un lecteur scrupuleux, attentif à en donner tous les détails, sans que rien n’échappe : ce travailleur acharné revient sans cesse sur les œuvres, remet les choses sur le métier, et se remet aussi sans cesse en question à travers ces relectures, et aime les concerts successifs qui peaufinent, qui éclairent : ces symphonies de Mahler il les a dirigées à Bregenz et Feldkirch, avec son ancien orchestre, qu’il connaît bien, dans une ambiance familière et rassurante.
Le personnage ne manque pas de sécurité, il craint simplement sans cesse d’avoir laissé un aspect de la musique de côté, de ne pas avoir assez labouré la partition. C’est une approche d’abord particulièrement modeste de la musique qu’il veut rendre dans une sorte d’exactitude maniaque. D’où peut-être pour les orchestres un contact différent devant des demandes très précises, d’aller jusqu’au bout dans leur manière de rendre le son, de demander des choses qui paraissent peut-être difficiles ou impossibles. Les chanteurs qui ont travaillé avec lui savent ce perfectionnisme qui a pu mener les horaires de services à être dépassés, ou des chanteurs à travailler avec lui plusieurs heures sur un détail.
On ne peut en effet considérer seulement ses prestations comme limpides, détaillées, lumineuses ou faisant entendre des détails qu’on n’avait jamais entendus. C’est vrai, c’est vérifiable à chaque concert, mais après ?
La deuxième observation est évidente, mais gagne à être rappelée : Kirill Petrenko, né en février 1972, a 48 ans. Et les jugements critiques ont tendance à comparer ses concerts aux autres chefs actuels, et notamment les plus anciens : le Mahler de Haitink, le Beethoven ou le Wagner de Barenboim, le Mahler de Rattle, ou même décédés, comme Claudio Abbado ou Carlos Kleiber.
Plusieurs musiciens affirment qu’il rappelle Kleiber, par le travail minutieux de préparation, par le rapport à l’orchestre, par le résultat ensuite fulgurant. Comparons aussi les âges : Karajan arrive à la tête des berlinois à 47 ans, et Rattle lui aussi à 47 ans tout comme Petrenko, tandis qu’Abbado arrive à 56 ans.
Comme on le voit sur les quatre derniers Chefdirigent, trois sur quatre arrivent à la charge au même âge. Seul, Furtwängler arrive à la tête de l’orchestre à 36 ans. Des observations qui ne remettent pas en cause les qualités des uns et des autres, mais qu’on doit avoir en tête lorsqu’on joue aux comparaisons. Entre le Karajan de 1955 et celui de 1987 ou 1988, il y a de larges différences, tout comme l’Abbado de 1970 et celui des années 2000.
Pourtant les mélomanes ou même certains critiques ont une fâcheuse tendance à comparer le (relativement) jeune Petrenko et l’Abbado de 70 ans qui dirigeait Mahler à Lucerne, ou le Wagner d’un Barenboim du même âge et même plus à celui de Petrenko qui dirige son Ring de Bayreuth à 41 ans. Juste pour info, si Abbado dirige sa Résurrection salzbourgeoise à 32 ans, il aborde Wagner à 48 ans (Lohengrin à la Scala) et la IXe de Beethoven encore plus tard. Barenboim dirige son Ring de Bayreuth à 44 ans. Si l’on veut comparer, il faut le faire d’âge à âge, le Ring de Petrenko à Bayreuth peut être comparé à celui de Barenboim, mais celui de 1988, pas le Ring du Barenboim de 2019…
Cela pour préciser que le Mahler que nous entendons de Petrenko aujourd’hui est un Mahler qui évoluera. Connaissant le chef et sa méthode de travail, on n’a pas encore fini de le découvrir.
Grandes différences aussi dans la manière de répéter : on sait en revanche que Claudio Abbado était considéré comme très décevant en répétition par beaucoup de musiciens d’orchestre quand ils répétaient avec lui, parce qu’il ne disait rien ou peu et qu’au bout de trois heures, certains se demandaient s’ils n’avaient pas perdu leur temps…Un « maestro », ça parle, ça enseigne et ça commande, m’avait dit un jour un de ceux-là.
Petrenko demande, et il demande sans cesse avec une affabilité à laquelle on ne peut résister, mais en demandant (et aussi en expliquant : les musiciens du Bayerisches Staatsorchester ne cessent de dire combien il est intéressant à écouter) il verrouille et veut tirer de l’orchestre un certain son, d’autant plus avec cet orchestre-là capable de ce que d’autres ne peuvent pas offrir ou produire.
Troisième élément, déjà noté ailleurs : nous ne sommes qu’aux premiers concerts avec le Philharmonique de Berlin. Lors de son élection, plusieurs voix ont souligné que le chef les avait peu dirigés, d’autres ont affirmé qu’il s’agissait d’un second couteau pour orchestre en décadence (on sait depuis la Guerre de Troie ce qu’il advient des Cassandre…).
Quand Abbado a repris Berlin, combien ont péremptoirement affirmé que le son des Berlinois était perdu. Par force : le son de Karajan ne peut être entendu sans Karajan…Par force, ils avaient choisi Abbado parce qu’il n’était pas, mais pas du tout Karajan. Donc les considérations sur la qualité des orchestres, et notamment des meilleurs tiennent plus du bavardage que de l’étude rigoureuse, chaque orchestre a sa personnalité, son histoire et ses traditions. La seule chose qui soit vraie et vérifiable, c’est que la plupart des grands orchestres internationaux sont dans leur composition même internationaux, ce qui n’était pas vrai du tout dans les années 1970. Rares sont les orchestres au son encore vraiment idiomatique. Staatskapelle Dresden ou Gewandhaus Leipzig en Allemagne peut-être, mais pas les Berlinois, mais un orchestre, c'est aussi une histoire de groupe, et aussi malgré les origines diverses des musiciens, une histoire et une tradition et des habitudes que tout entrant se doit d'adopter.
Sir Simon Rattle à la tête des berlinois ne m’a pas toujours convaincu, notamment dans les grands classiques du répertoire, en revanche, dans d’autres répertoires (XVIIIe, répertoire français, ou américain du XXe) il est souvent magnifique. Il avait aussi un souci d’obtenir un son de l’orchestre, qui souvent ressemblait à une mise en scène du son, notamment dans Mahler : c’était souvent spectaculaire, ce n’était pas toujours convaincant parce que cela semblait superficiel. C’est un chef qui était – m’a‑t‑il semblé, plus libre avec Birmingham (et aujourd’hui avec le LSO) qu’avec Berlin.
Le compagnonnage de Claudio Abbado avec Mahler remonte aux origines de sa carrière. À un moment où Mahler n’était pas un universel musical comme il l’est devenu après la parution des enregistrements Bernstein (bien que de très grands chefs avant lui l’eussent dirigé ou enregistré). Il y a comme cela des compositeurs qui aujourd’hui paraissent naturels au public et qui il y a cinquante ans ne l’étaient pas du tout ou pas tout à fait : on n’entendait pas de Chostakovitch qui, guerre froide aidant, était plus vu à travers ses atermoiements face au pouvoir soviétique qu’à travers sa musique. Et Mahler était si peu fréquent que c’est Abbado qui a imposé à Karajan sa fameuse Résurrection de Salzbourg de 1965, alors que Karajan lui demandait un Requiem de Cherubini.
Kirill Petrenko est de cette génération qui a toujours connu Mahler dans les programmes de concerts, tout comme Chostakovitch d’ailleurs, voire d’autres comme Janáček dont la fortune commence après les années 1980. Et d’ailleurs assez tôt, il dirige Mahler dans les années 2000, car contrairement à ce qu’on dit, il a bien bâti son répertoire avant d’arriver à Berlin. À l’opéra bien sûr où il dirige beaucoup d’œuvres variées, notamment du répertoire italien, mais aussi au concert. On oublie trop souvent qu’il a une formation supérieure en Autriche et qu’il s’est confronté très vite dans sa préparation à Brahms, Beethoven, Mahler.
Un coup d’œil sur la programmation 2020–2021 des Berlinois montre d’ailleurs sa propension à proposer des programmes assez composites ou surprenants, avec des œuvres peu connues du public, tout comme la symphonie de Josef Suk entendue début janvier ou celle de Franz Schmidt la saison précédente. Petrenko connaît bien le répertoire post-romantique et il l’aime. Il n’est jamais aussi à l’aise que dans R.Strauss, Wagner, Mahler, et tous ces compositeurs de la fin du XIXe ou du début du XXe.
Son Mahler est d’autant plus intéressant qu’il contraint le spectateur à partir de la forme musicale, et que la forme est ici d’une certaine manière le fond. Il n’est pas évocatoire à la manière d’un Abbado ou d’un Gatti. Pour avoir entendu plusieurs Mahler par Daniele Gatti ces derniers mois, on est sur des registres opposés, mais chacun convaincant dans son ordre.
Mais cette Sixième est bien autre chose qu’une démonstration de forme et un exercice de style : elle est même dans sa manière de se présenter un peu ambiguë. Je me souviens de la Sixième d’Abbado avec la Filarmonica della Scala le 30 octobre 2012, le fameux marteau du dernier mouvement trônait au sommet de l’orchestre, bien en vue, et donc déterminant pour la lecture de l’œuvre. Ce soir il est invisible parmi les percussions et donc un instrument comme un autre, qui ne doit pas être exposé spectaculairement dans sa monumentalité. C’est un autre discours qui est porté ici, un discours plus dynamique. J’ai relevé une phrase de Stefan Zweig qui parle de Mahler de manière très juste et qui s’appliquerait parfaitement à cette symphonie : « toute sa vie durant, il courut ainsi en avant, expulsant, renversant piétinant tout ce qui lui faisait obstacle, il courut et courut, comme talonné par l’angoisse de ne pas atteindre l’accomplissement. » ((Stefan Zweig, Le retour de Gustav Mahler, Actes Sud, 2015, p.44)).
C’est un peu ce sentiment qui domine dans la lecture de Kirill Petrenko. Nous ne rentrerons pas dans le débat sur la place de l’andante et du scherzo : ce sont des décisions que les chefs prennent en fonction de critères musicaux qui valent aussi bien dans un sens que dans l’autre. Ce sont des décisions de chef, et Mahler lui-même laissait aux chefs l’initiative de modifier si nécessaire (il s’en était ouvert à Mengelberg). Il est connu qu’un Toscanini modifiait les partitions pour obtenir des effets qu’il désirait. C’étaient des pratiques ordinaires qui aujourd’hui ont moins cours.
Ce qui intéresse ici c’est l’impression diffusée d’un dynamisme et d’un apparent optimisme, dans une symphonie appelée « tragique ». On a vu que Petrenko, qui n’est pas un chef à effets gratuits, n’a pas fait du marteau un instrument monumental et des coups de marteau un moment. Il refuse en effet un tragique qui serait théâtral et spectaculaire, et il lui préfère un tragique de situation. Au sens où une symphonie « tragique » n’est pas une symphonie forcément « dramatique » : le tragique du destin humain consiste à assumer son destin peut-être, mais de continuer la lutte, doive-t-elle conduire dans le mur. Le dynamisme exprimé, qui donne l’impression d’une lumière et d’un optimisme marqués à certains moments, est en fait presque réduit à la marche.
Ce mouvement initial m’a toujours fait penser à L’homme en mouvement de Boccioni qui est postérieur de 7 ans à la création de la symphonie. Mais il y a quelque chose qui rapproche dans ce mouvement : L’homme en mouvement en 1913, à la veille de la guerre mondiale, est bien un homme qui marche vers un mur ou une catastrophe.

Ainsi le mouvement et la dynamique que Petrenko imprime ne sont pas une sorte de lumière qui anime, mais presque la dernière lueur avant la chute, et surtout, avant une chute que les événements vont confirmer les années suivantes, à commencer par la mort de sa fille Marie en 1907, un an après la création de la symphonie, mais pas seulement des événements personnels : le moment de la composition est plutôt un moment heureux pour l’homme Mahler. Rien n’empêche de considérer le « tragique » en un sens bien plus large, presque plus cosmique. Rappelons-nous le titre « Les somnambules » donné au beau livre de Christopher Clark qui montre le mécanisme de la marche à la guerre de 1914. Il y a dans l’approche de Petrenko une sorte d’évocation d’un « somnambulisme », d’une marche vers un inconnu, comme un optimisme de l’aveuglement – qui donne à cette approche une force presque nouvelle, presque inconnue et d’une cruelle ironie. Du même coup il souligne tous les contrastes de cette musique, sans rien atténuer, en construisant une sorte de dialectique de la décision (1er mouvement) et de la nostalgie mélancolique (andante), à laquelle répond le scherzo grinçant, à la limite du désespéré. Ainsi Petrenko ne cherche ni à atténuer les aspérités, ni à arrondir les angles, il cherche surtout à mettre en relief l’incisif face à l’émollient, la décision face à la nostalgie, cherchant à aller au bout de chacun. Le tragique, il le recherche dans cette contradiction consciente : et comme par hasard, Mahler a à peu près le même âge que Petrenko quand la symphonie est créée (46 ans), il y a là une vigueur affirmée, une sorte de pleine santé individuelle qui ne ménage ni les effets de contraste, ni les évocations qui respirent ni même les intuitions tragiques.
Dans ce premier mouvement, entre la marche initiale, décidée, résolue, presque aveugle, et l’évocation de la nature, cette respiration à peine effleurée, par le violon solo de Stabrawa, les cloches de vache, les bois (extraordinaires à Berlin comme toujours), bientôt contrastée par la reprise de la marche, c’est tout un univers de déchirures qui se laisse voir, d’un monde à la fois fait de sorcellerie évocatoire et de quelque chose de menaçant qui peine à être bien défini.
On est sur le fil du rasoir, et ce n’est pas un hasard si cette 6ème est un basculement. Kirill Petrenko souligne d’ailleurs à la fois un tragique en absolu, pas forcément lié à l’individu, mais à un contexte, une situation, une intuition, et une volonté de Mahler d’alléger ce qui pourrait apparaître inutilement lourd, d’où cette volonté de clarté de limpidité, mais en même temps un discours qui ne cherche pas à homogénéiser, mais au contraire à juxtaposer le lyrique et le tragique, le passé (?) et l’avenir (?), l’individu et le monde, et à respirer une nature encore évanescente, voire déchirante.
Une telle conception a besoin de la confrontation immédiate du premier mouvement non avec le scherzo, mais avec l’andante, c’est à dire un moment d’apaisement, le dernier peut-être, qui n’est pas sans regarder vers l’adagio de la 4ème Symphonie, mais une apaisement qui garde quelque chose de fortement nostalgique (le cor anglais), voire lacérant, une dialogue entre un intérieur déjà désolé et une respiration encore large. Et Petrenko allège l’approche au maximum pour appuyer la différence avec ce qui précède et ce qui va suivre. Contrairement à ce que certains affirment, il ne s’agit pas d’effets formels ou d’une approche superficielle, il s’agit au contraire d’une lecture approfondie de la partition et de la tradition critique, et les analystes les plus précis soulignent le réseau serré des contrastes, et des absences de liaison entre les différents moments.
Le scherzo dans cette perspective évidemment n’est plus le prolongement sarcastique du premier mouvement, mais la réponse presque dérisoire à l’andante, où la couleur presque désespérée de la danse devient danse macabre (le xylophone !), et pour laquelle il garde un tempo soutenu qui rappelle le premier mouvement, mais un premier mouvement presque en dérision : il y a là une variation grinçante qui répond à l’apaisement précédent, et souligne le sentiment d’instabilité, ce fil du rasoir que nous évoquions plus haut. L’orchestre suit évidemment avec sa virtuosité coutumière, et alterne ces moments de pâle sourire et de glissement inquiétant vers l’inconnu. L’attention de Petrenko aux détails se lit évidemment à la clarté du rendu, mais aussi à son souci de rester toujours dans une volonté de cultiver cette ambivalence entre la course initiale et ce qui sera la catastrophe finale.
Nous avons souligné les aspects dialectiques de cette approche, de la marche décidée initiale apaisement de l’andante, grincements du scherzo, et même à l’intérieur de chaque mouvement et notamment du premier, des moments de suspensions (pizzicati de rêve comme toujours à Berlin) avec de longues pauses entre les mouvements, comme s’il fallait un peu rentrer en soi.
Le finale, dont on connaît la longueur particulière (30min) est un peu un réceptacle de ces différents moments, dont il reprend souvent des évocations. L’accord initial « indicible » (merveilleuses harpes…) selon Adorno qui a laissé une longue analyse de ce mouvement donne la mesure d’une complexité telle que ni Walter ni Klemperer ne s’y confrontèrent au moins au disque. On y retrouve dès le début la marche initiale, les notes grinçantes du scherzo, un tempo soutenu. Petrenko mène le tout à un rythme de « course à l’abyme », comme pour afficher une volonté à la fois résolue et désespérée, on y retrouve donc cette dialectique tragique dont il était question au début de cet article. On va consciemment et résolument dans le mur. Les Berlinois suivent leur chef avec tension palpable et une concentration visible, on le comprend avec le tempo imposé et aussi l’attention de tous les instants du chef sur les éléments de l’orchestre pour rendre ce son d’une clarté étonnante en dépit de la complexité de construction du mouvement et surtout rendre la multiplicité des couleurs tout en ne s’y complaisant pas.
Et Petrenko évite tous les effets attendus, et du même coup il refuse les émotions qui seraient effets de l’interprétation et non d’une lecture très attentive de la partition. Sans avoir rien de froid, sa Sixième n’a pas le côté dramatique qu’on y entend quelquefois, au sens d’un drame qui serait personnel et d’un débat individuel. Cette volonté de suivre la partition avec une exactitude presque maniaque, est un programme de lecture qui donne aux musiciens une sorte de liberté surveillée au service d’un projet.
En ce dernier mouvement, il ne met rien en scène : observant que Mahler lui-même n’a cessé d’alléger la composition de l’orchestre, il impose par exemple deux coups ((Mahler en avait prévu initialement cinq)) de marteau au lieu des trois (il évite le troisième, suivi par les quelques mesures finales). Nous avons vu qu’il fait du marteau un instrument parmi les autres sans le mettre en valeur comme une sorte d’instrument visible du destin. La reprise de l’accord initial est à chaque fois de moins en moins spectaculaire, et de plus en plus « banalisée » au milieu du discours général. Pour Petrenko, la tragédie naît des contrastes et des ruptures plus que d’une homogénéité sonore qui en atténuerait les aspects incisifs. En analogie avec la peinture, il travaille le trait à la Tintoret, par opposition à un Titien. Et par le seul trait, par le seul scalpel, il dégage une sorte de Mahler lacéré, sans issue, qui regarde le monde confronté au mur, un Mahler tragique, loin des drames familiaux et bourgeois et il en donne en quelque sorte une lecture prophétique.
Cette netteté des contours, sans sfumato, sans concession à ce qui serait une atténuation des formes a pu gêner certains qui attendaient du « sentiment ». On passe sans cesse de l’Eden à l’Eden perdu qui ne se retrouvera pas, du sublime au ciel « bas et lourd », y compris à l’intérieur des mouvements respectifs : Petrenko procède (et c’est souvent le cas) par rupture de construction, qui demande souvent à l’orchestre une virtuosité particulière, mais en même temps il évite de s’attarder ou de se complaire dans le sublime, d’où un tempo vif, mais pas vraiment plus rapide que les 82 minutes indiquées par Mahler… avec effet sur le public garanti qui fait un triomphe à l’orchestre et à son chef
Par ailleurs, on sent que se construit avec l’orchestre peu à peu un discours, une entente : nous n’en sommes qu’au début d’une relation qui devrait avec le temps trouver sa respiration et ses rythmes, et déjà, autour de Mahler, que les musiciens connaissent bien (cette symphonie a été depuis 2004 interprétée plusieurs fois par l’orchestre), on sent une moindre tension que sur des répertoires moins labourés, même si la concentration est visible.
Il reste que l’auditeur va devoir aussi s’accoutumer à cette approche assez inhabituelle (et c’est au fond ce qu’on demande à un nouveau Chefdirigent) peu complaisante, mais qui fait grand effet en salle. Les deux Mahler que Petrenko a dirigés cette saison (dont l’un, la 4ème, dans des conditions, on le sait très particulières) montrent un souci de rester au plus près de la partition, de rechercher en elle tous les effets musicaux, sans plus de liberté de ce que le compositeur permet au chef : il en résulte ici une Sixième impressionnante par la virtuosité, les rythmes, les ruptures, la respiration et le sens réel d’un tragique sec et sans espoir, mais en même temps fortement marquée les refus de ce qui pourrait être un spectaculaire gratuit ou surjoué, une sorte de mise en scène qui d’une certaine manière, trahirait l’idée que Petrenko se fait de Mahler et en ferait un artifice.
Vous pouvez entendre cette symphonie dans la « Digital Concert Hall » des Berliner Philharmoniker ( Soirée du 25 janvier 2020) : https://www.digitalconcerthall.com/en/concert/52522#

