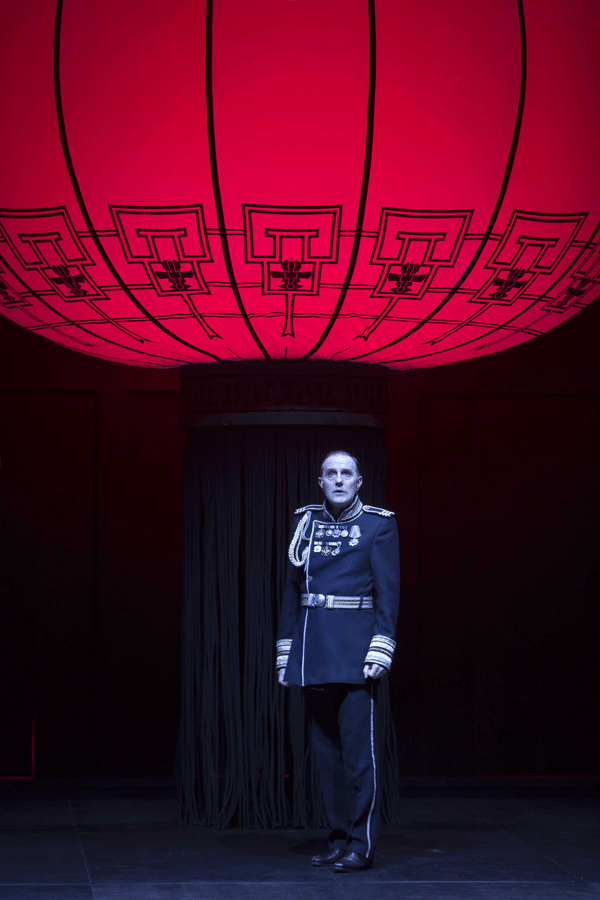C’est donc une belle histoire que celle de Frühlingsstürme (Tempêtes de Printemps) qui renaît après 87 ans de silence et d’oubli. Jaromir Weinberger est un compositeur tchèque qui a vécu et enseigné aux USA dans les années 20, et qui après 1938 devra fuir son pays et s’installer de nouveau aux Etats-Unis, où, dépressif, il se suicidera en 1967 atteint d’une tumeur au cerveau. On lui doit plusieurs opérettes et opéras, dont le plus célèbre est une des prochaines créations de la Komische Oper en mars prochain, Schwanda, der Dudelsackpfeifer (Schwanda, le joueur de cornemuse) créée à Vienne en allemand par Clemens Krauss, après avoir été créée en langue originale en 1927 au Théâtre National de Prague, et qui fut aussi représentée au MET (Artur Bodansky) et à Covent Garden (Clemens Krauss encore) ainsi qu’à Buenos Aires.
Frühlingsstürme a été créé rien moins que par Richard Tauber, le rôle de Lydia Pawlowska étant tenu par Jarmila Novotná, qui fit une grande carrière de soprano au MET, mais qui tourna aussi des films, y compris une version de La fiancée vendue par Max Ophüls. De bonnes fées s’étaient donc penchées sur le destin de cette opérette dont la carrière fut brutalement interrompue.
Comme la plupart des œuvres de l’époque interdites ou détruites par les nazis, Frühlingsstürme ne fut pas reprise après-guerre, et fut oubliée. D’autres modes, d’autres œuvres, d’autres styles régnaient après-guerre, et le monde de l’opérette a été marqué profondément par l’american style (voir par exemple la manière dont Im weiss’n Rossl (L’auberge du cheval blanc) a été complètement transformé par l’influence américaine. Et ces triomphes de la République de Weimar furent complètement et oubliés et supplantés.
Et si l’on s’intéresse aujourd’hui à Frühlingsstürme c’est d’une part que la musique en est exceptionnelle et que la trame est très particulière, puisqu’elle se passe en Mandchourie durant la guerre russo-japonaise (1904–1905). Kosky faitd’ailleurs remarquer que l’opérette aime beaucoup la guerre, à commencer par La Grande Duchesse de Gerolstein, d’Offenbach, parce que la guerre étant désordre, permet des délires et des folies sur la scène.
La trame raconte l’histoire d’un grand amour qui se termine par une séparation et un adieu entre une comtesse russe et un officier japonais, et fait inévitablement penser au Pays du Sourire de Franz Lehár, mais aussi à Madama Butterfly en moins tragique, ou à d’autres histoires d’amour impossible ou difficiles, comme Eugène Onéguine, dont l’histoire est assez proche, notamment au dernier acte. De toute manière en ces premières décennies du XXe siècle, l’amour d’une russe et d’un japonais n’était pas forcément habituel et ces amours « mixtes » sont promises à l’échec voire au drame.
À cette histoire est liée aussi une affaire d’espionnage sur fond de guerre. La capitaine Ito, officier japonais est un espion qui a réussi à s’introduire comme majordome auprès du général en chef de l’État-major russe, Vladimir Katchalov (rôle parlé). Lydia Pawlowska se trouve en Mandchourie par un hasard qui la fait soupçonner elle aussi aussi d’espionnage. Elle a jadis aimé Ito d’un fol amour, mais ils se sont perdus de vue et elle est désormais l’objet d’une cour assidue du général Katchalov. Mais elle retrouve son Ito, sous les traits du majordome qui est pris entre son devoir d’espion et son amour. Arrestations, séparations, condamnations à mort, coups de feu, mais finalement Ito réussit à s’échapper, Katchalov à la demande de Lydia fermant les yeux sur ce prisonnier, au risque d’être limogé.
Tous se retrouvent, à la fin de la guerre, à San Remo, dans un hôtel où sont négociées les conditions de la paix.
Les hôtels aussi sont des lieux privilégiés de l’opérette, il s’y passe toujours une foule de choses… Ito est devenu le plénipotentiaire japonais. Croyant avoir été trahi par Lydia et désespéré, il s’est marié dans l’intervalle… Mais il retrouve à l’hôtel de San Remo sa chère Lydia et ils sont bien près de recommencer (ou continuer) leur histoire, mais la raison prévaut, et Ito reste avec sa femme tandis que Lydia épouse Katchalov, chacun étant conscient que l’amour n’est pas mort, mais qu’il est plus raisonnable de laisser les choses en l’état (ce que l’appellerai le syndrome d’Onéguine…)
Il s’agit donc d’une histoire douce-amère, dans une ambiance de guerre où tous les personnages sont plutôt positifs et tolérants, c’est une des marques de l’opérette, où aucun des personnages n’est ridicule, et où tous portent une tendresse inhérente qui fait le charme indéniable de cette œuvre. Il y a des espions, il y a la guerre, il y a une violence sous-jacente, mais il y a toute cette intrigue traversée par l’amour, et portée par deux couples, le couple sérieux Ito/Lydia et le couple plus comique et léger Roderich Zirbitz le journaliste et la jeune Tatiana, fille du général Katchalov (Papsi pour les intimes). Roderich est le chasseur de scoops qui a réussi des photos compromettantes du général, qui lui en veut donc et refuse de lui donner sa fille. Une intrigue dans l’intrigue où Katchalov perd à tous les coups.
Les personnages principaux sont tous tendres, c’est un fait indéniable, mais chacun joue son jeu de masques, si bien qu’à chaque action, il y a des arrières pensées et que chacun a quelque chose à cacher, Ito aime Lydia, mais est un espion en mission, il doit donc aussi la trahir ou la fuir, Katchalov le général aime Lydia, mais il la soupçonne d’espionnage et lui tend un piège, le journaliste est une sorte de Fregoli qu’on voit en cuisinier, puis en magicien pour pénétrer l’Etat-major russe, Tatjana, la fille de Katchalov ne cesse de rouler son père dans la farine, et pour finir fait croire à son mariage, alors qu’elle n’a pas épousé le journaliste Roderich Zirbitz. Bref rien n’est stable, rien n’est sûr, et Kosky y voit aussi un signe de l’instabilité des temps et d’une époque de forte agitation politique et sociale, marquée par la montée du nazisme et la crise des sociétés.
Car le travail sur cette œuvre, tout comme du les exhumations de Paul Abraham ou d’autres œuvres de la période qui marquèrent la Berlin de la république de Weimar, est d’abord réhabilitation d’une période et d’artistes que l’arrivée du nazisme a écrasés, et fait disparaître quelquefois au propre, hélas, quelquefois au figuré. Puisque ces œuvres ont été effacées de la mémoire collective et que la période même de la République de Weimar, l’un des moments artistiquement et culturellement les plus riches de l’histoire allemande et européenne, dont les juifs furent souvent les animateurs, dans tous les arts, a été écrasée par son histoire politique d’instabilité et de faiblesse. Ainsi donc Kosky, juif australien installé en Allemagne, dans une ville qui fut et reste la plus ouverte d’Europe, fait acte de civisme et d’engagement, sans discours superflus, par une simple politique artistique dont le succès prend le public (qui afflue) à témoin : ça rit, ça sourit, c’est rempli de jeunes, c’est un public vivant, réactif. Qu’on est bien à la Komische Oper !
Le coup de génie de Kosky, c’est de dire quelque chose de très sérieux, d’autant plus sérieux par les temps qui courent où les vérités historiques sur la Shoah sont mises en doute par des pourritures qui commencent, en Allemagne et ailleurs, à avoir pignon sur rue (voir l’article d’Igor Levit que nous avons traduit dans Le Blog du Wanderer), en ne tenant pas de discours moralisateur ou monitoire, mais en faisant rire, sourire, et pleurer, en remettant au goût du jour des œuvres que la barbarie/la pourriture avait enterrées. En montrant leur valeur, en montrant que 90 ans après, elles fonctionnent, elles font rire, elles attirent le public, il met le doigt du même coup sur leur qualité intrinsèque et sur les mécanismes totalitaires, raciaux, barbares, qui les avaient annihilées. Il répond par l'art, par le jeu, par le rire aux tendances délétères du monde d’aujourd’hui. Et c’est très fort.
Mais il ne suffit pas de réhabiliter, et on a vu plus haut quel temps il a fallu pour révéler Frühlingsstürme (dont la Première le 26 janvier coïncidait plus ou moins avec les 75 ans de la libération d’Auschwitz), il faut aussi pour faire honneur à l’œuvre, que le spectacle soit incontestable. Et il l’est évidemment, dans une mise en scène époustouflante et en même temps très épurée, apparemment simple et rigoureuse qui est un feu d’artifice d’invention, de joie, de tendresse, si bien qu’il laisse le public à la fin avec la seule envie qui vaille, celle de revenir voir le spectacle.

Le principe est comme souvent chez Barrie Kosky (voir la longue interview qu’il nous avait concédée à Dijon : lien ci-dessous) celui de la boite (décor de Klaus Grünberg et Anne Kuhn), du cube géant, de la Box (le Jack in the box qui surgit de la boite) une box qui s’ouvre et se ferme, se déploie, et qui à chaque fois adopte une ambiance particulière, par le jeu de décors minimalistes : les lampadaires de papier rouges suffisent pour indique la Chine ou l’Asie par exemple.
Le lever de rideau est à ce titre emblématique : la « box » s’ouvre et nous nous trouvons autour d’une table, enfumée, éclairée comme dans un tripot. On a l’impression d’une maison de jeu…eh non ! Ce jeu, c’est le jeu de la guerre et c’est une réunion stratégique d’État-major où l’on bouge les soldats comme des boules de roulette…de roulette russe bien entendu…puisque c’est de l’armée russe qu’il s’agit. Par cette seule image initiale Kosky en dit plus long sur la guerre que bien des discours (en cela on pense à La Grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach). La guerre, c’est un jeu où les puissants s’amusent avec les pions que sont les vies humaines et les soldats…
Car cette image si surprenante, évidemment s’enchaine ensuite par des scènes désopilantes (celle du journaliste cuisinier notamment qui doit faire des bouchées à la reine brunes ou blanches et où le général dit « brunes, naturellement » avec la connotation à la couleur brune…Bref, cette boite d’où sortent idées, scènes, et personnages devient vite coffre aux merveilles, qui se refermera lors de la dernière image, au dernier acte, où Ito dans un dernier effort pour rejoindre Lydia, trouvera boite close.
Cette boite qui est boite de jeu est la boite de tous les possibles , celle où on va croire à la paix, à la guerre, à l’amour, celle qui va se transformer tour à tour pour figurer nos rêves, mais aussi notre culture, nos préjugés, nos références.
Et la mise en scène de Barrie Kosky est un merveilleux artisanat qui est rythme, mécanique de précision, et aussi un étonnante capacité à construire une mécanique avec peu de choses, un grand lampadaire suffit pour donner une ambiance, des costumes (de Dinah Ehm) qui oscillent entre plusieurs époques et plusieurs lieux, années trente, années folles, époque contemporaine : la femme japonaise de Ito n’est pas en kimono, mais il lui suffit d’un déhanchement, d’une manière de porter un châle ou une robe, et elle donne l’idée du kimono de la japonaise, les chinois sont tous en noir, avec des costumes très sobres de subalternes, mais aucun personnage asiatique n’est grimé, aucune « yellow face » : un costume vaguement chinois et un bonnet suffisent à donner une identité : on est au théâtre et on y croit. Dans une opérette où russes, chinois et japonais se retrouvent en Mandchourie et parlent tous en allemand, les questions identitaires se posent d’une autre manière…
On est à l’opérette, il y a des dialogues parlés, des ballets comme toujours réglés par Otto Pichler, le chorégraphe attitré, avec cette fois l’emploi exclusif de danseuses (alors que dans Anatevka le ballet n’était composé que de danseurs, et qu’il était mixte – mais sans différentiation de costumes- dans Die Perlen der Cleopatra) tantôt style fox trot, tantôt style Lido avec des trucs en plume, et escalier, comme dans la comédie musicale américaine logée aux Ziegfeld Follies, avec des intermèdes qui ont été développés et même des inventions comme l'ensemble final (c'est plutôt un air final de l'héroïne ou du couple des héros qu'on attend) de tous les protagonistes.
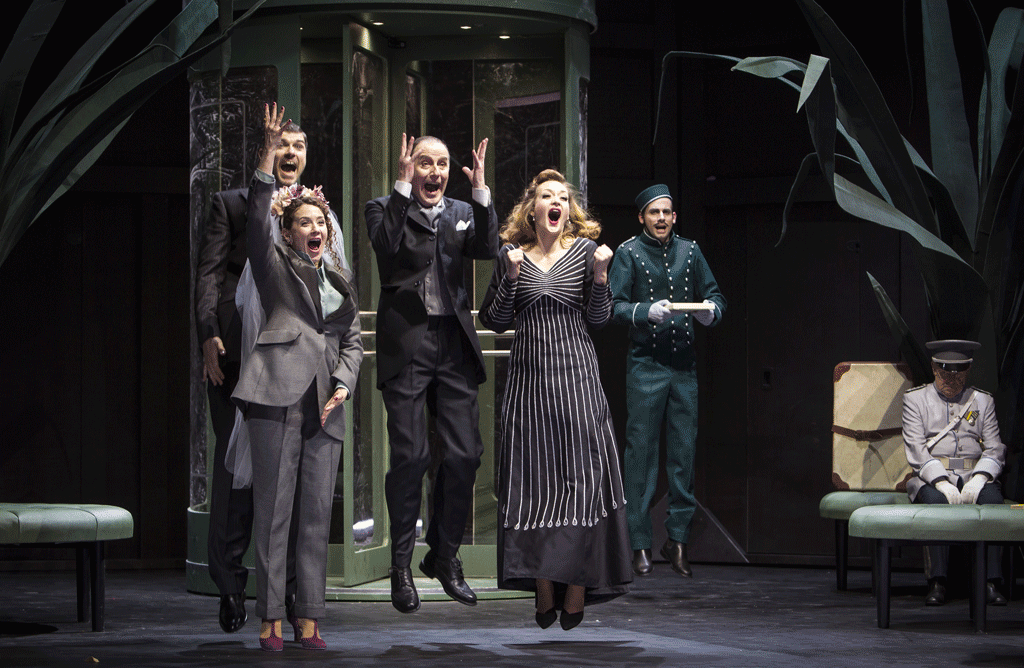
Car Kosky souligne qu’il en va de l’opérette comme du répertoire baroque, elle s’adapte au lieu, elle s’adapte au public, elle s’adapte aux nécessités. Nous sommes une époque qui a le culte du respect de l’œuvre, et de son intégrité « toute l’œuvre et rien que l’œuvre », qui ne supporte pas que tel ou tel moment soit coupé, (avec des polémiques infinies), alors qu’aux temps baroques et même au XIXe, les opéras étaient adaptés aux lieux, aux chanteurs, aux humeurs, avec des airs d’autres œuvres ou d’autres compositeurs intégrés si nécessité. Alors Kosky (sur une œuvre qui est inconnue et reconstituée, et donc sans danger que le puriste du coin n’intervienne) a donc rallongé des ballets, imaginé des intermèdes, adapté l’opérette à sa vision, prenant d’ailleurs appui sur une musique elle-même complètement ouverte à tous les genres. Kosky est musicien, il sait ce qu’il fait et sait parfaitement qu’à l’opérette, c’est le tempo, le rythme qui compte. Et ici il est haletant. Car l’œuvre telle qu’elle est présentée alterne chant, mime, ballet, dialogues sans jamais connaître de rupture, ménageant l’alternance d’éléments émouvants et d’autres désopilants, et quelquefois les deux, comme cette fabuleuse scène de l’acte II où Lydia promet de se donner à Katchalov s’il sauve Ito, et où celui-ci tout à son amour éperdu se « prépare » dans une longue scène muette en constatant son âge, sses capacités physique, et finit par chanter (c’est l’extraordinaire acteur Stefan Kurt qui joue Katchalov, rôle parlé) avec une voix grêle qui n’est pas une voix d’opéra l’air de Lenski d’Eugène Onéguine, en russe, et qui fait passer tour à tour du fou rire à l’émotion. Un moment pareil est inoubliable tant il est suprêmement interprété, mais l’idée de l’air de Lenski, tiré d’Eugène Onéguine dont le dernier acte ressemble tant au dernier acte de l’opérette de Weinberger est simplement un joyau.
Pour que tout réussisse, il aussi réunir une distribution sans failles. Elle est dominée par le rôle parlé de Katchalov, interprété par l’acteur Stefan Kurt dont nous venons d’évoquer l’un des grands moments : il réussit une performance éblouissante, passant du rire aux larmes, de l’émotion à la trahison, de l’autorité, voire de l’autoritarisme à la faiblesse, son visage si plastique, incroyablement expressif, à la fois débonnaire et roublard est fabuleux à observer : il vaut à lui seul le détour, mais il y a tous les autres, dont tous les rôles principaux sont tenus par les membres de la troupe, dont on mesure ici la qualité et l’engagement, signe de l’absolue supériorité du théâtre de troupe lorsque l’ambiance de la maison atteint ce degré de cohésion : Dominique Köninger, baryton, chante le journaliste correspondant de guerre Roderich Zirbitz qui essaie de s’introduire dans l’État-major pour tirer des photos et qui en même temps séduit (sincèrement) la fille du général Katchalov (Tatiana), avec ses transformations, sa vivacité, sa chaleur communicative, et aussi un beau timbre velouté, à ses côtés la jeune soprano Alma Sadé, vive, lumineuse, espiègle, à la voix suraiguë et au rythme si ébouriffant. Et puis il y a l’autre couple, central, Lydia Pavlovska chantée par Vera-Lotte Boecker, a la voix magnifiquement contrôlée et qui sait donner à ce chant toutes les couleurs voulues, de la vamp fatale à la Garbo à l’amoureuse éperdue. Son jeu est presque cinématographique, le personnage voulu par Kosky en fait une Madone des sleepings sortie d’un film des années trente, le personnage est parfaitement incarné, y compris dans ses émotions, dans sa manière de passer de la mondaine à l’amoureuse, dans sa justesse de ton. Son chant a la couleur voulue, le lyrisme voulu avec une belle technique : magnifique incarnation.
Ito c’est Tansel Akzeybek, lui aussi en troupe à la Komische Oper, ténor lyrique qu’on vit pour la première fois à Saint Etienne dans L’Elisir d’amore et qui est devenu depuis aussi un pilier de Bayreuth (Meistersinger avec Kosky et Jordan, mais aussi Tristan avec Thielemann et Katharina Wagner). Avec ses moyens, avec une voix qui n’est pas si grande, mais bien posée et toujours bien projetée, il reprend le rôle qui fut de Richard Tauber, aux aigus notables, avec une délicatesse qui lui est spécifique et une humanité qui en fait un personnage particulièrement émouvant, notamment dans toute la dernière partie, où le désespoir l’a saisi, en constatant que son amour pour Lydia, réel et partagé, ne pourra plus jamais être vécu. Belle incarnation, jamais histrionique, toujours sensible.
Mais tous sont à citer, tant chacun est juste dans son rôle, même les plus petits, Tino Lindenberg (le colonel Baltischev), Luca Schaub (Le Grand-Duc), Arne Gottschling (Shibato), Yannik Heckmann (Kawa-Kami), Martina Borroni (qui est danseuse et interprète si justement le profil de l’épouse de Ito avec de si justes mouvements) Sasha Goepel qui est Strotzki, ce qui permet de savoureux jeux de mots avec l’illustre (presque) homonyme, sans compter les douze merveilleuses danseuses.
Et le tout est mené de main de maître par le « Kapellmeister » de la maison, Jordan de Souza, le chef canadien qui accomplit sa dernière année à la Komische Oper et à qui l’on doit déjà des soirées intéressantes (je me souviens d’un très bon Onéguine par exemple). De Souza a su trouver le rythme juste et surtout l’esprit de l’œuvre, une œuvre plus complexe qu’attendue, qui passe sans cesse d’un style à l’autre, on y retrouve Strauss et Lehar bien sûr, mais aussi du jazz, mais encore Dvorak, Smetana, Strauss (Richard) et Zemlinsky, toute une tradition idiomatique (Weinberger est tchèque), mais aussi post-romantique. Une musique incroyablement riche et raffinée, que Jordan de Souza réussit à faire entendre et surtout à faire comprendre, grâce à une direction d’une rare clarté, avec ses ruptures, avec son lyrisme, avec ses sourires et sa mélancolie : à la tête de l’orchestre qui se déchaine en pleine confiance, il réussit une vraie performance, lui qui tout au long de ces années, avec des changements de directeur musical, a incarné une continuité de qualité et surtout un certain esprit de la maison. C’est un nom a considérer avec attention parce que c’est un jeune chef vraiment excellent.
Un dernier mot : après le succès de la Première il y a la « Premierenfeier » où tout le public est convié dans le foyer (même tradition à la Deutsche Oper et à la Staatsoper – pas de réception privée réservée à des invités), les bars sont ouverts, on peut acheter à boire et à manger et le maître de cérémonie Barrie Kosky qui est l’intendant du théâtre présente un à un, tel un bateleur ou un Monsieur Loyal les protagonistes connus et moins connus de la production, c’est un moment joyeux où tous sont fêtés, et c’est surtout un moment où l’on sent quel cœur bat dans cette maison, quel esprit y règne et comment tout cela influe sur la qualité de la production globale. C’est une troupe, une maison, un ensemble, qui défend une idée collective du théâtre, allez-vous étonner que ce soit aujourd’hui des trois opéras de Berlin le plus populaire, le plus joyeux et le plus inventif !