 Le public est invité à deux heures sans entracte d’un spectacle conçu à son tour comme une sorte de tableau vivant, scandé en moments, en saynètes qui soulignent la dramaturgie assez lâche de l’œuvre, comme ces fresques qui racontent des épisodes de vie de saints ou des épisodes bibliques : Damiano Michieletto impose l’idée religieuse, comme s’il s’agissait quelque part de ce que j’oserais appeler une messe blanche, puisque la couleur blanche s’impose, un blanc clinique et ascétique. Chaque scène a son titre, de La veillée à La damnation comme un parcours, comme la succession de stations d’une Passion et le chœur se situe au-dessus, comme un chœur d’anges baroques. En ce sens la production sied à la Ville Éternelle. Sans aucun doute cette mise en scène d’une élégance et d’un esthétisme tout italiens n’offre pas une vison habituelle..
Le public est invité à deux heures sans entracte d’un spectacle conçu à son tour comme une sorte de tableau vivant, scandé en moments, en saynètes qui soulignent la dramaturgie assez lâche de l’œuvre, comme ces fresques qui racontent des épisodes de vie de saints ou des épisodes bibliques : Damiano Michieletto impose l’idée religieuse, comme s’il s’agissait quelque part de ce que j’oserais appeler une messe blanche, puisque la couleur blanche s’impose, un blanc clinique et ascétique. Chaque scène a son titre, de La veillée à La damnation comme un parcours, comme la succession de stations d’une Passion et le chœur se situe au-dessus, comme un chœur d’anges baroques. En ce sens la production sied à la Ville Éternelle. Sans aucun doute cette mise en scène d’une élégance et d’un esthétisme tout italiens n’offre pas une vison habituelle..
Singulière la vision de ce Faust adolescent et dépressif, isolé, qui dort entouré de pilules, des restes d'un McDo, d'une photo de sa mère le tenant enfant, et d'un livre d'art ouvert à la page du Jardin d'Eden de Cranach, singulière aussi la vision d’un Méphisto qui n’a rien de diabolique, une sorte de mauvais garçon sympathique qui dès le début et avant même que Faust ne le rencontre, met en place le piège, singulière aussi la présence de Marguerite (en robe rouge passion…) bien avant son intervention, comme figure rêvée d’un amour peut-être enfantin.
 Car l’enfance a une importance déterminante, Faust est certes adolescent, avec sa relation problématique au père et sans doute aussi à la mère mais se retrouve dans ses rêves devant son double enfantin, qui à son tour rencontre le double de Marguerite, comme si tout n’était qu’un délire semi-comateux d’un Faust en perdition.
Car l’enfance a une importance déterminante, Faust est certes adolescent, avec sa relation problématique au père et sans doute aussi à la mère mais se retrouve dans ses rêves devant son double enfantin, qui à son tour rencontre le double de Marguerite, comme si tout n’était qu’un délire semi-comateux d’un Faust en perdition.
Il y a dans ce Faust une vision clinique et glaciale, quelque chose de médical (Faust git aussi sur un lit d’hôpital) dans un espace scénique est d’autant plus éclaté que Michieletto utilise (comme Frank Castorf et désormais tant de metteurs en scène) une steadycam qui retransmet sur écran ce qu’on ne peut voir de la salle, scènes derrière les cloisons ou gros plans sur les personnages.  Mephisto est le metteur en scène d’une histoire qu’il nous expose sous de multiples facettes, et Faust est son instrument.
Mephisto est le metteur en scène d’une histoire qu’il nous expose sous de multiples facettes, et Faust est son instrument.
Plusieurs moments sont magnifiquement traités :
- la marche hongroise où Michieletto choisit de montrer non la violence guerrière, mais celle du harcèlement ou du bizutage violent dont Faust est l’objet, tout aussi glaçante

- la rencontre avec Marguerite, métaphore de celle d’Adam et Eve dans un décor fait de visions du Jardin d’Eden de Cranach (allusion aux racines médiévales de l’histoire), avec des projections, mais aussi des éléments de décor, comme une sorte d’illusion baroque, non sans l’ironie d’un néon qui illumine le nom « Paradisus » et d’un Mephisto qu'on voit s'habiller en sympathique serpent de comédie.
- les dernières scènes, celles de Marguerite perdue, de Faust ravagé par le remords et la Damnation finale, virent au noir : le blanc est couvert d’un encombrant plastique noir, les êtres se recouvrent de poix ou de pétrole, de substance gluante qui étouffe leur physique et leurs habits, il n'y plus rien de la relative légèreté avec laquelle l’histoire est embrassée au départ, mais une tension se crée à la limite du supportable.
- la dernière image, apothéose baroque où la scène est envahie par des personnages qui tiennent des bougies tremblantes avec au centre Marguerite et un cercueil blanc qu’on avait déjà entrevu dans les scènes précédentes est impressionnante de beauté plastique et d’émotion.
Damiano Michieletto a travaillé à transformer l’univers berliozien un univers mental, débarrassé de tout romantisme encombrant, mais centré sur la perturbation psychique d’un jeune homme qui n’est pas au monde et qui cherche une voie. C’est une voix qu’il rencontre, celle d’un Mephisto qui n’a rien de diabolique, tout en étant un ange bien peu gardien, tout en blanc comme un magicien de music-hall (costumes de Carla Teti), qui veut s’amuser du monde et de ses rejetons-victimes, violant Marguerite et embrassant goulument Faust.
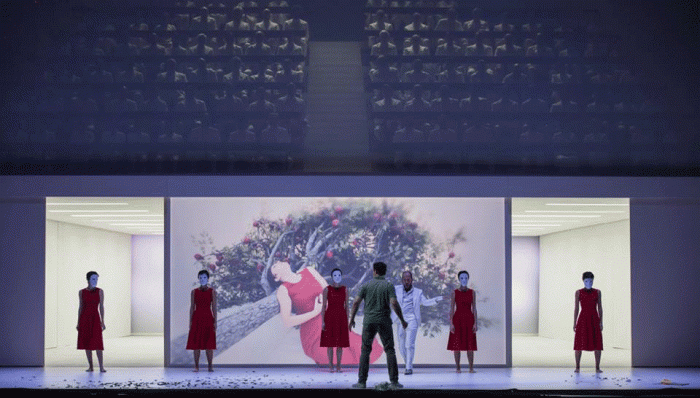 Mais en même temps le dispositif scénique et la manière d’organiser la trame renvoie à des tableaux religieux presque sulpiciens avec ce chœur fixe qui domine la scène , et cette Damnation a tout d’une parabole, la perdition d’une modernité mal comprise, la perdition des êtres abandonnés du monde, même si le personnage de Marguerite, entre petite fille, être fantasmatique et Eve au paradis ne trouve pas toujours sa cohérence, mais le personnage est lui-même un peu sacrifié par Berlioz. C’est à la fois un travail sur les références de l’époque, du Musset de la Confession d’un Enfant du siècle (publiée en 1836, 10 ans avant La Damnation) au spleen baudelairien, mais il réussit à tisser en même temps, et c’est là sans doute sa plus grande réussite, l’image d’une Damnation de notre monde, traçant un arc entre les mythes littéraires du XIXe et ceux cinématographiques d’aujourd’hui (Terence Malick). Très grand spectacle.
Mais en même temps le dispositif scénique et la manière d’organiser la trame renvoie à des tableaux religieux presque sulpiciens avec ce chœur fixe qui domine la scène , et cette Damnation a tout d’une parabole, la perdition d’une modernité mal comprise, la perdition des êtres abandonnés du monde, même si le personnage de Marguerite, entre petite fille, être fantasmatique et Eve au paradis ne trouve pas toujours sa cohérence, mais le personnage est lui-même un peu sacrifié par Berlioz. C’est à la fois un travail sur les références de l’époque, du Musset de la Confession d’un Enfant du siècle (publiée en 1836, 10 ans avant La Damnation) au spleen baudelairien, mais il réussit à tisser en même temps, et c’est là sans doute sa plus grande réussite, l’image d’une Damnation de notre monde, traçant un arc entre les mythes littéraires du XIXe et ceux cinématographiques d’aujourd’hui (Terence Malick). Très grand spectacle.
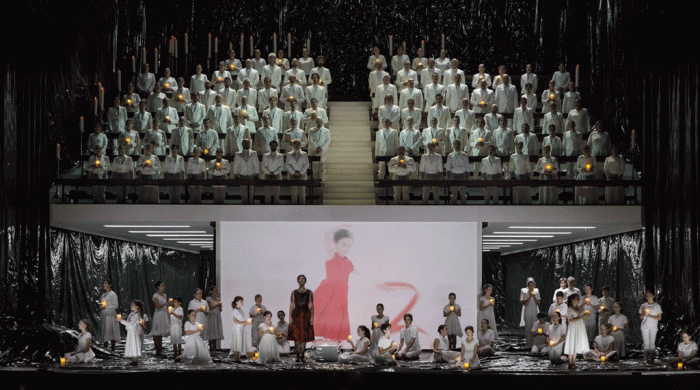 A cette véritable vision correspond un dessein musical non moins convaincant. La direction de Daniele Gatti, comme souvent, va à rebours de la tradition et propose un regard nouveau sur cette partition assez rebattue en France notamment. Gatti cherche à la fois à en exalter les raffinements avec un soin donné à la couleur, à l’exaltation de tous les pupitres, mettant l’orchestre (solide et qui le suit parfaitement) à rude épreuve, car la musique de Berlioz est évidemment à la fois peu familière à ces musiciens, et de difficile exécution technique. Il en résulte un son souvent allégé, très fin, qui exalte des moments d’un lyrisme très sensible. Mais Gatti n’oublie pas non plus la vision d’un Berlioz romantique, aux contrastes violents, une marche hongroise au rythme très rapide et une course à l’abime anthologique, pour achever par des dernières mesures de l’ordre du sublime. Il y a comme une gradation dans l’intensité, mais sans jamais renoncer à la clarté du discours ni à la finesse, sans jamais tomber dans l’excès sonore, même dans les moments les plus propices et toujours accompagnant la trame avec une grande délicatesse.
A cette véritable vision correspond un dessein musical non moins convaincant. La direction de Daniele Gatti, comme souvent, va à rebours de la tradition et propose un regard nouveau sur cette partition assez rebattue en France notamment. Gatti cherche à la fois à en exalter les raffinements avec un soin donné à la couleur, à l’exaltation de tous les pupitres, mettant l’orchestre (solide et qui le suit parfaitement) à rude épreuve, car la musique de Berlioz est évidemment à la fois peu familière à ces musiciens, et de difficile exécution technique. Il en résulte un son souvent allégé, très fin, qui exalte des moments d’un lyrisme très sensible. Mais Gatti n’oublie pas non plus la vision d’un Berlioz romantique, aux contrastes violents, une marche hongroise au rythme très rapide et une course à l’abime anthologique, pour achever par des dernières mesures de l’ordre du sublime. Il y a comme une gradation dans l’intensité, mais sans jamais renoncer à la clarté du discours ni à la finesse, sans jamais tomber dans l’excès sonore, même dans les moments les plus propices et toujours accompagnant la trame avec une grande délicatesse.
Quelques une des dernières productions musicales italiennes de Daniele Gatti sont nées de son séjour parisien, que ce soit son Pelléas florentin, que cette Damnation : imposer ce répertoire à un public peu connaisseur de ces oeuvres est aussi audacieux. Même s’il tient compte comme on l’a vu du romantisme berliozien (pourrait-il en aller autrement ?), il s’intéresse du point de vue de la couleur au Berlioz qui regarde un passé proche, aussi bien Beethoven qu’il admirait tant qu’un Cherubini dont on ne dira jamais assez l’influence sur la production du temps. Comme Michieletto qui navigue entre la modernité d’un Baudelaire et celle si contemporaine d’un Terence Malick, Danielle Gatti propose un Berlioz à la fois romantique, mais aussi classique et hiératique à la Cherubini, mais comme on sait, les grands classiques ont été écrits romantiquement, selon Sainte-Beuve.
Gatti dirige et accompagne avec une attention phénoménale une distribution non idiomatique, mais qui dans ce spectacle volontairement non « gallican » prend tout son sens.
Le Faust de Pavel Černoch (qui sortait de ses Don Carlos parisiens) n’a pas la pratique de la partition d’un Michael Spyres ni sans doute la perfection de sa diction ni la même qualité de timbre, mais il est le personnage voulu, psychiquement fragile, juvénile, avec une voix bien posée, et beaucoup de raffinements, notamment dans la deuxième partie : il réussit à imposer un Faust poétique et absent, solitaire et abandonné, et procure une réelle émotion. Ce ne sera sans doute pas un modèle de phrasé français, même si la diction est assez claire, mais c’est en tous cas un personnage cohérent, présent scéniquement et particulièrement sensible.
Veronica Simeoni était Marguerite, à la diction assez claire, mais à l’expressivité qui ne réussit pas à émouvoir jamais. La prestation n’est pas médiocre, mais manque à convaincre pleinement, même si à sa décharge on ne peut dire que Berlioz ait vraiment servi le personnage au niveau dramaturgique. Son « autrefois un roi de Thulé » est correctement exécuté, mais vaut surtout par le sublime accompagnement orchestral « D’amour l’ardente flamme » m’est apparu en revanche un peu distant.
 Goran Jurić était un Brander assez correct, vêtu en costume de paillettes d’artiste de supermarché, intrusion vulgaire et volontairement décalée et sa Chanson du rat vaut pour le rat qui rappelait un peu les rongeurs de Neuenfels dans le Lohengrin de Bayreuth.
Goran Jurić était un Brander assez correct, vêtu en costume de paillettes d’artiste de supermarché, intrusion vulgaire et volontairement décalée et sa Chanson du rat vaut pour le rat qui rappelait un peu les rongeurs de Neuenfels dans le Lohengrin de Bayreuth.
C’est Alex Esposito qui emporte quand même tous les suffrages en Méphisto, et à tous les niveaux : c’est un acteur, qui s’empare du rôle pour en faire quelque chose de tout à fait personnel, et d’encore moins méphistophélique que celui voulu par Berlioz. Il se moque de tout et du monde et des gens, et s’amuse à faire du monde et des gens ce qu’il veut, un manipulateur génial et sympathique, centre de toute l’attention. Mais vocalement, avec un phrasé parfait, une diction qui rend tout le texte lumineux, et une expressivité stupéfiante, il donne là l’un des Mephisto à la fois les plus originaux et décalés qu’on ait vu, mais aussi l’un des plus passionnants.
Le chœur dirigé par Roberto Gabbiani a vraiment été magnifique dans une partition où il intervient fréquemment, sa présence angélique ou spectrale (c’est selon) s’impose visuellement et vocalement. On entend le travail attentif de préparation.
On a dit combien l’orchestre avait suivi Gatti et la manière dont il avait répondu et c’est une très belle prestation qu’il livre là.
On l’aura compris, c’est sans doute une Damnation autre et inhabituelle, d'autant plus passionnante qui, bien qu’allant vers d’autres horizons que ceux d’un Berlioz idiomatique ou d’un Berlioz (magnifique au demeurant) à la Gardiner, nous fait découvrir un autre chemin, tout aussi berliozien, d’un Berlioz profondément libre, à la croisée des traditions européennes, romantique mais pas trop, classique mais pas trop, et incroyablement raffiné, dans une réalisation d’une rare intelligence et d’une très grande profondeur scénique et musicale suscitant des émotions indicibles. Berlioz, Grand Prix de Rome, a séjourné quatorze mois dans la Ville éternelle, a écrit le Carnaval romain, on se souviendra désormais aussi de la Damnation romaine.

