
Présenté la semaine précédente au Teatro Olimpico de Vicenza dans le cadre du Vicenza Opera Festival (voir ci-dessous le lien vers le compte rendu de Mauro Masiero), cet Orfeo débarque sur la scène du Grand Théâtre de Genève naturellement amputé du célèbre décor de scène de Palladio. Pour pallier cette illustre référence, on déploie ici toute une galerie d’effets vidéos signés Vince Varga qui multiplie à l’envi les contours du décor Renaissance sous des formes tantôt abstraites ou fractionnées alternant avec des représentations plus littérales (un sous-bois pour les scènes pastorales, une onde mouvante pour la scène aux Enfers). Tandis que cet écrin d’images numériques se borne à une fonction décorative et visuellement très confortable, la scène est recouverte d’une pelouse artificielle censée illustrer les prairies de Thrace sur lesquelles s’agitent et se prennent les pieds d’assez improbables bergers et bergères dans des tuniques couleur pastel. On doit cette esthétique hors d’âge à la costumière Anna Biagiotti – une esthétique qui n’épargne pas le rôle-titre, l’affublant d’une toge blanche et bleue rappelant furieusement ce Jésus-Christ Superstar tout droit sorti de l’univers de la comédie musicale éponyme. Impossible de se défaire de cette comparaison en voyant Orfeo dans ce chiton long auquel il ne manque qu’une auréole pour compléter le tableau.
Un mauvaise idée en entraînant une autre, on aura pris soin de reléguer en fosse un chœur déjà peu pléthorique. Au-delà d’une inévitable diminution acoustique, les chorégraphies de Sigrid T’Hooft ont tout le loisir de s’ébrouer dans une atmosphère entre kitsch et hippie au beau milieu de laquelle les chanteurs semblent littéralement abandonnés sur scène sans réelle direction d’acteur.
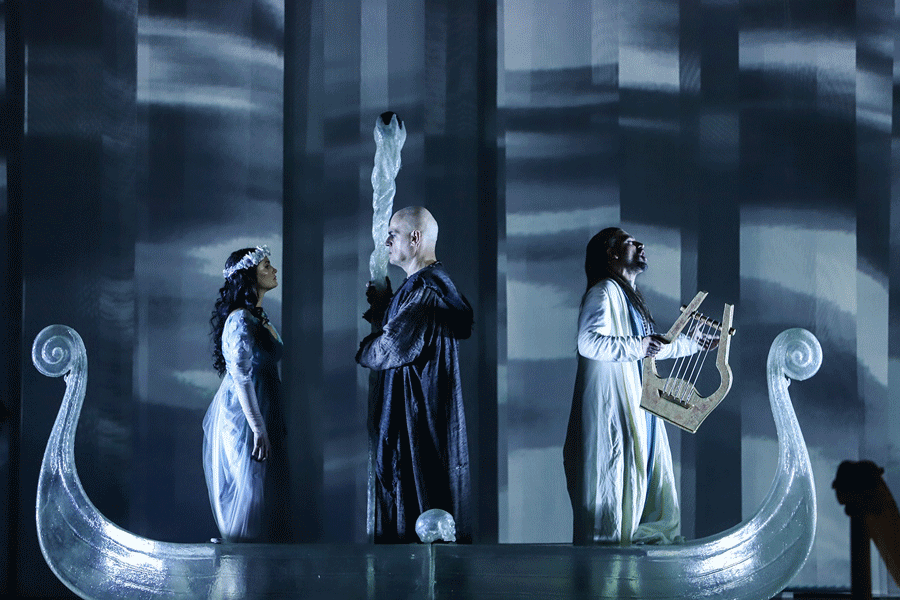
Avec la scène des Enfers, on revient heureusement à une relative sobriété, avec la barque de Caronte transportant les âmes des défunts de cour à jardin, à la surface d’un Styx changé en un immense miroir ténébreux. Cette curieuse nacelle plexiglas à roulettes transporte également le couple Pluton – Proserpine, avec Monsieur au gouvernail et Madame lovée sur des coussins tandis que ce pauvre Orfeo se contorsionne avec sa lyre pour tenter de les apitoyer. Il suffira d’un projecteur qu’on éteint pour signifier la perte d’Euridice – une simplicité qui tranche avec la bacchanale de l’acte V qui se substitue à la traditionnelle conclusion où Orfeo devient immortel, emporté aux cieux par son père Apollon.
Iván Fischer a reconstitué à cette occasion la musique perdue qui accompagnait la première version (1607) du livret de Striggio, absente de la partition imprimée à Venise par Monteverdi en 1609. Furieuses de voir Orfeo rester fidèle à Euridice, les Ménades mettent en pièce le corps du poète musicien, tandis qu’on célèbre un Bacchus transformé alternativement en satyre et Vénus boticcellienne. Cette conclusion inédite concentre (musicalement) l’intérêt d’une soirée qui menaçait ruine. Si l’ancien assistant de Nikolaus Harnoncourt trouve là une occasion de faire entendre ses talents d’écriture chorale et instrumentale (Vieni Imeneo), on ne peut que regretter une traduction scénique plus proche des Monty Python que d’Ovide et Virgile.

Cet humour aussi récurrent qu‘involontaire fait peser sur le chant la contrainte d’une crédibilité théâtrale bien mise à mal. À ce jeu difficile, on ne peut que saluer le choix gagnant de confier à Emöke Baráth les rôles de Musica et d’Euridice. Sa maîtrise du phrasé et de la ligne du récit font merveille dans le Prologue et le très exposé Io non dirò qual sia. La longueur du souffle et la délicatesse des altérations donnent au Ahi vista troppo dolce un parfum d’éternité. L’Orfeo de Valerio Contaldo offre une surface vocale contrainte par une diction appuyée. Son Rosa del ciel n’a pas l’éclat et la souplesse du Possente Spirto, mieux ajusté. Ni le Caronte ligneux et compassé d’Antonio Abete, ni le très gris Plutone de Peter Harvey ne soulèvent l’enthousiasme. La lumineuse Luciana Mancini (Messagiera et Baccante) dispute la palme de la soirée à la Proserpina de Núria Rial. La Speranza de Michał Czerniawski domine la prestation de Cyril Auvity et Francisco Fernández-Rueda, Pastore en demi-teinte. La direction linéaire d’Iván Fischer donne au Budapest Festival Orchestra une carrure et une austérité qui contrarient le sonorité naturelle des instruments historiques. Cette vision un rien corsetée cherche dans une mise en place rigoureuse un objectif certes louable mais peu convaincant sur la durée.

