
De la mise en scène impossible
Que faire d’une œuvre que tout mélomane porte en lui, connaît par cœur, pour laquelle il n’a plus d’attente, tant tout semble avoir été dit. Don Giovanni est l’avatar d’un mythe né au XVIIe qui compte jusqu’à nos jours des adaptations et des variations par dizaines. Mozart lui-même arrive en même temps qu’un Don Giovanni de Francesco Gazzaniga sur un livret de Giovanni Bertati bien proche de Da Ponte qui connaissait certainement l’œuvre (en un acte) créée en février 1787 à Venise. En ces quinze derniers jours de juin, entre deux Don Giovanni (Genève et Lyon) et Don Juan de Molière à Munich par Frank Castorf, le mythe est dans l’actualité.
Justement David Marton a fait ses classes auprès de Frank Castorf et Christoph Marthaler et sa manière de travailler rappelle évidemment ses grands ainés, notamment l’intégration de textes différents (Goethe dans La Damnation de Faust, Thomas Melle, auteur très connu en Allemagne dans ce Don Giovanni), l’insertion de bruits intempestifs (autoroute…) ou des coupures dans le livret, ainsi que de menus traficotages de la musique comme l’introduction à la première intervention de Leporello Notte e giorno faticar entendue dans les hauts parleurs et non en fosse ou l’absence totale de la figure du Commandeur, dont on n'entend que la voix et qu’on ne voit jamais, sinon sous la figure d’un adolescent.
Présenté ainsi, le mélomane amoureux de Mozart, compositeur sacral du Landerneau musical et médiatique, aura l’impression de voir la énième provocation d’un metteur en scène égocentrique.
Et il n’en est rien. David Marton essaie de rendre la multiplicité, voire la prolixité du mythe, estimant que le public connaît l’histoire, vue et revue sur les scènes d’opéra, et qui ne nécessite pas une représentation littérale, mais au contraire un travail sur le regard, celui des personnages et le nôtre. Il en résulte à la fois un travail sur la dramaturgie, très différente entre premier acte (une histoire assez conforme) et second acte (une série d’arrêts sur image, dans une vision plus dépouillée, presque hiératique, dans l'univers plus abstrait d'une succession d’airs se concluant par la mort de Don Giovanni, climax, point d’orgue et en même temps suspension, parce que sans le sextuor final (supprimé dans la version de Vienne ici présentée sans le duo Leporello-Zerline), cette mort nous paraît presque insuffisante, presque insatisfaisante. Au lieu de clore une histoire, cette mort par suicide (Don Giovanni s’ouvre les veines) nous donne envie d’aller encore plus profond, encore plus loin parce qu’elle ne clôt qu’une vie singulière, mais pas le mythe, pas les autres, pas le monde, car elle ne résout rien.

Un Don Giovanni polymorphe
Ainsi le Don Giovanni vu par Marton est-il polymorphe, il existe dans notre oreille d’auditeur, dans nos yeux de spectateur, dans une musique, dans le regard des autres : il existe dans tout cela à la fois, mais existe-il en lui-même ?
Il a dans cette vision une sorte de négation : négation de la trame que tout le monde connaît, qui fait aller ailleurs la mise en scène, négation des personnages les uns après les autres, à commencer par Leporello qui est un mélomane fanatique dirigeant devant ses enceintes et collectionnant les Don Giovanni : le catalogue est en ici catalogue au sens « discophilique » du terme puisque il y exhibe les différentes versions enregistrées. Il fait aussi surgir l’œuvre au sens où il est tous les rôles au début, puisqu’il dit les deux rôles dans son dialogue avec Don Giovanni muet. Un Leporello extérieur faisant surgir l’œuvre dans son fantasme eût pu être une piste, mais Marton abandonne bientôt ce filon-là, ou du moins le met de côté, les disques et le tourne-disque réapparaissant au deuxième acte dans la scène du cimetière, qui semble être un assemblage des reliques du premier acte, sorte de cimetière d'une vie antérieure.
Dans une autre vision « mélomaniaque » du drame, au moment des ensembles où Don Giovanni ou Leporello sont pris au piège par les autres (scène finale du premier acte) , l’action devient un étrange spectacle musical où les personnages s’assoient sur des chaises pour une représentation de salon où Don Giovanni et Leporello évoluent seuls sous le regard des autres devenus spectateurs d’une performance : Marton refuse de rentrer dans la trame pour faire encore une fois de la musique un objet de regard ou d’audition. De même "Il mio tesoro" est-il chanté par Don Ottavio comme un crooner et les autres personnages se mettent à danser (et plus) sous l'action de cette musique.
Il semble que dans son approche de l’œuvre ou du mythe, Marton ait lui-même la soif de Don Giovanni à essayer de vouloir tout saisir. Puis il laisse échapper et passe à autre chose, et ainsi le chemin vers l’œuvre plonge vite dans le tonneau des Danaïdes.

Car son Don Giovanni (Philippe Sly) traverse plusieurs états, il est ombre, personnage (et les autres sont alors des ombres), il est un Wanderer du sexe, mais d’un sexe passé, avenir, et bien triste au présent. Le personnage de Sly existe dans sa non-existence, dans ce voyage au bout d’une nuit sans fin et sans signification. À la recherche du sens perdu. Et dans cette perspective, la démarche de Marton, avec ses défauts et ses excès, et celle de son personnage, sont presque métaphoriques l’une de l’autre. Sa circulation parmi toutes les femmes (ou les possibles féminins) au moment de la noce de Zerline et Masetto le montre allant de l'une à l'autre y compris Cordula Wurst, des femmes qu'on retrouvera telles des momies du passé dans la scène du cimetière.
Donna Elvira est Antoinette Dennefeld, enceinte (réellement) mais cette situation évidemment enrichit encore la mise en scène qui rajoute une strate en faisant de Don Giovanni un mari, pour une fois dans son parcours …et du couple Elvira/Giovanni un couple qui fut l’espace d’un instant réussi.
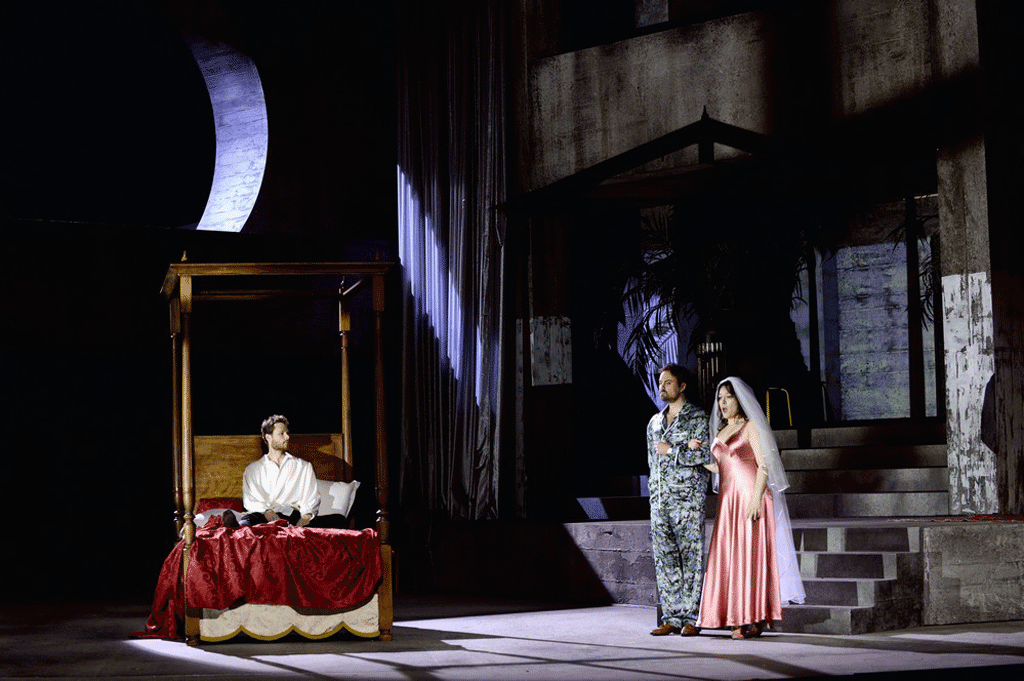
Don Ottavio est l’accompagnateur éternel de Donna Anna, dans un joli costume qui ressemble à un pyjama : ils apparaissent comme "couple" devant Don Giovanni assis sur son lit central : il les regarde entrer dans leur scène du premier acte pour constater la mort d'un commandeur qui est absent (c’est une voix et non un corps) : ils ne constatent donc rien, puis ils s’effacent en marchant à reculons, comme la scène inutile un film qui serait projeté à l’envers. Et puis ce couple toujours apparaissant "en couple" va s’installer dans une sorte de permanence bientôt ridicule, quand Anna chante « Non mi dir » Ottavio disparaît pour réapparaître chaque fois plus vieux et enfin vieillard chenu, attendant sa dulcinée pour l’éternité… ce que l’œuvre laisse entendre : au théâtre celui qui remet à « après » la pièce, dans un mois ou dans un an, remet les choses pour l’éternité. Ce qui n’est pas vu sur scène n’est et ne sera pas.
Destruction également du couple Zerline/Masetto : par la volonté du metteur en scène, ce Masetto est plus âgé (Piotr Micinski), et cette Zerline est asiatique (Yuka Yanagihara), tout simplement pour souligner que ce n’est pas un « couple » d’amoureux, mais un vieux qui se tape (achète) une asiatique. Et du coup, Don Giovanni soustrayant au barbon la jolie Zerline ne fait rien d’immoral…
Au bout du compte, ce Don Giovanni (Philippe Sly), n’a rien du séducteur irrépressible auquel personne ne résiste, c’est une figure grêle, à la voix tendre et malade en ce soir de première, presque transparent, mais au timbre juvénile et chaleureux. De plus, son plus bel air (Deh vieni alla finestra) est chanté tout seul, devant une fenêtre vide, sans que personne ne vienne. L'apothéose du rien. "Non" Giovanni.
Un Don Giovanni très théâtral
Il en résulte un spectacle complexe,très réfléchi par le propos et naturellement intelligent, très théâtral par l’attention au jeu, par l’engagement qu’il faut saluer de tous les chanteurs y compris de la part du Commendatore invisible (Attila Jun) : il en faut pour accepter de chanter sans être en scène pendant la représentation, .

Très théâtral aussi par un décor de Christian Friedländer en forme de vaste salle de béton, mal finie, qui tient du salon, d’un hall, mais en même temps d’un théâtre, avec ses deux grands rideaux, celui latéral qui laisse au départ apparaître le couple Anna-Ottavio et celui en rideau vénitien qui descend tel un sarcophage protecteur pour isoler Don Giovanni, ainsi qu'un rideau de scène bleu, de ce bleu familier des salles du XVIIIe qui va souligner les moments de théâtre dans le théâtre (final du premier acte) par une sorte de mise à distance brechtienne.
Autre élément théâtral, couronné du rideau de tulle à peine évoqué, le lit, central, qui apparaît pendant une bonne partie de l’œuvre, a quelque chose d’une vitrine de musée que l’on regarderait : Don Giovanni y regarde Donna Anna dormir, on y regarde Don Giovanni, on s’y précipite, comme un champ clos des fantasmes, mais un champ symbolique, une projection là aussi, quelque chose d’artificiel, la scène d’un petit théâtre du désir, d’un désir presque étalon sous la cloche d’un quelconque pavillon de Sèvres.

Enfin, s’il n’y a pas de Commendatore, il y a son substitut adolescent, qui apparaît au lever de rideau comme une évocation du « vert paradis des amours enfantines », et qui réapparaît dans la scène finale où il va déployer un linge dissimulant un rasoir ou un stylet, dans une scène stylisée comme une cérémonie de Hara Kiri, d’une très grande beauté plastique où le torse de l’adolescent se reflète dans celui de Don Giovanni, comme un passage de témoin, comme si ce commandeur était un rappel d’un Éden perdu, recherché et jamais retrouvé. Comme si la mort était la dernière expérience du désir.
Cependant il y a dans ce travail quelques coquetteries inutiles : autant l’ajout des mots de Goethe dans La Damnation de Faust avaient du sens, autant ceux de Thomas Melle, extraits du Monde dans le dos ((Die Welt im Rücken, Rowohlt Theater Verlag, Hamburg, 2016)) apparaissent moins convaincants (le surtitrage en rouge peu clair en est-il responsable ?), comme la manière dont le texte est déclamé par Don Giovanni au deuxième acte, devenant ainsi le héros bipolaire du roman. Comme Frank Castorf, l’un de ses maîtres, il « enrichit » l’œuvre d’autres textes censés l’expliquer ou la prolonger, mais autant il a réussi précédemment, autant les choses tombent-elles à plat soit par la solution technique trouvée, soit par la puissance relative du texte.
Il en reste un spectacle qui stimule, parce que le spectateur « averti » a vu des palanquées de Don Giovanni, loin d’être scéniquement convaincants, même par les plus grands et que celui-ci regarde le mythe à travers ses négations, ce "Non" Giovanni dont il était question plus haut. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui le découvriront sur les écrans le 7 juillet, ce sera de toute manière un beau spectacle que les curieux essaieront de comprendre et décortiquer.
Une musique haletante et profonde
Musicalement, il faut saluer le travail qu’ont effectué en commun David Marton (qui est musicien) et Stefano Montanari. La direction de Montanari, toujours très sèche, aux forts contrastes, aux tempos incroyablement rapides (ouverture) et très ralentis quelquefois, souligne le rythme haché des désirs désordonnés du héros, mais en même temps donne à la musique une vivacité et un dramatisme qui fait fi de tout ce qui pourrait être joli : nous sommes dans la palpitation, nous sommes dans le soubresaut, nous sommes dans l’instable et jamais dans le joli, au sens où l’on entend quelquefois « Mozaart » et nous sommes aussi dans la profondeur avec une belle fidélité à la partition (la fête chez Don Giovanni avec orchestre en scène, installé en hauteur comme dans les salles de villas, danse et contredanse) . Cette approche qui vient du baroque, que l’on connaît bien de la part d’un chef qui a commencé sa carrière dans le répertoire baroque, n’est pas « baroqueuse » au sens où on l’entend aujourd’hui. Ce n’est pas une coquetterie musicale, c’est un parti pris théâtral, qui souligne la part de l’inattendu, la part de rupture, la part de tendresse, la part d’inquiétude de cette partition et de cette lecture scénique , sans oublier la part de (longs) silences ; c’est sans doute ainsi qu’il faut lire le choix de la version de Vienne, non comme un choix archéologique, ou philologique, qui proviendrait des secrets de la musicologie, dont les scènes sont si friandes aujourd’hui essentiellement pour leur communication, mais pour des raisons dramaturgiques. Finir sur le sextuor, c’est en quelque sorte annoncer que tout est arrangé, alors que rien ne l’est (et cela Molière le dit merveilleusement dans son épilogue dans la bouche de Sganarelle), et finir « tranquillement » et légèrement. Finir par la mort de Don Giovanni, c’est souligner encore plus le drame de tous, laissés comme à l'abandon.
Le continuo au forte piano est aussi mélangé à des sons, dont celui obsédant d’une circulation qu’on suppose autoroutière, comme s’il y avait un monde extérieur réel et ce lieu à la fois clos et irréel qui serait le champ du fantasme et de la musique à la foi
Saluons aussi le chœur dirigé par Hugo Peraldo, toujours aussi plastique toujours aussi adaptable aux mises en scène (l’apparition est excellente au moment du mariage de Zerline et Masetto).
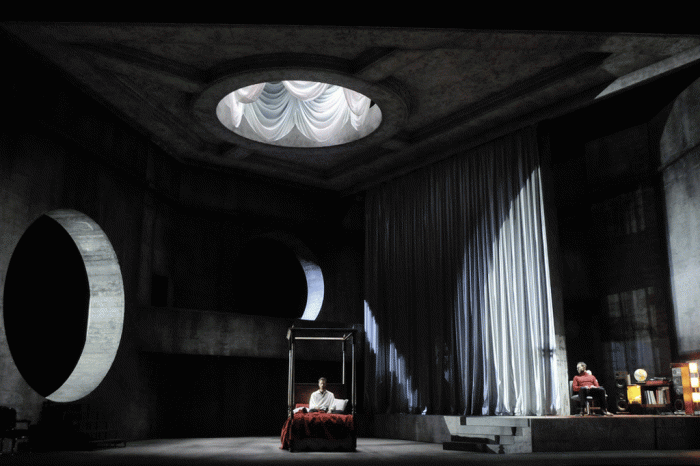
Philippe Sly (Don Giovanni) était annoncé malade. Certes la voix n’avait pas l’éclat qu’on pouvait y attendre, mais elle a gardé du style (notamment dans « Deh vieni alla finestra » magnifiquement exécuté) même si dans « Finch’han dal vino » le fameux air du champagne elle n’a pas l’éclat voulu. Enfin, son « La ci darem la mano » dansé avec Zerlina est délicieux parce que chanté sans volonté de domination ni de séduction, mais dit avec beaucoup de naturel et d’élégance et donc tout aussi convaincant. Oserais-je dire « qu’importe la maladie ? » car la voix colle tellement bien au personnage voulu par Marton que ce Don Giovanni en mode mineur convient et ne gêne ni l’exécution musicale ni scénique, et Philippe Sly a des qualités d’acteur, une sveltesse et une présence qui compensent largement la pâleur vocale contingente et somme toute relative.
Kyle Ketelsen est comme toujours remarquable d’engagement, de mobilité, de style, d’intelligence vocale et scénique, il réussit à se glisser dans tous les modes voulus par la mise en scène pour son personnage que Marton désigne comme le personnage principal, et qui sont multiples : il est tout aussi bien le Leporello traditionnel que le mélomane obsédé. Cette plasticité du personnage lui sied et il s’en sort avec les honneurs : son Leporello est intelligent, plein de relief, avec une vraie présence scénique et une voix bien posée, profonde, qui se distingue parfaitement de celle Don Giovanni dont il n’est pas du tout le double (contrairement à beaucoup de mises en scène), il est à la fois hors trame (début premier acte) et dans la trame (début du second, qui redonne à Don Giovanni un habit traditionnel du XVIIIe. Un Leporello « autant que de besoin » aux statuts divers, que Ketelsen réussit à rendre de manière particulièrement convaincante.
Le commendatore d’Attila Jun est invisible et sa voix surgit amplifiée, c’est peu gratifiant pour le chanteur qui se tire avec honneur de ce défi, même si on peut se demander si le public fait le lien lorsqu’il vient saluer à la fin…
Ottavio est Julien Behr et il se sort avec élégance du personnage et de ses deux airs : il n’est pas l'Ottavio ridicule de Ramón Vargas à Genève (voir notre article), il a une sorte de j’menfoutisme qui en fait aussi un personnage complètement plastique, à transformations, il devient ridicule et fait rire pendant l’air de Donna Anna « non mi dir », il chante « il mio tesoro » comme l’aurait fait Jean Sablon jadis. Dans l’ensemble ce Don Ottavio est un peu inhabituel, mais la voix est claire et bien contrôlée, à quelques menues scories près.
Masetto (Piotr Micinski) n’a pas le relief ni la jeunesse habituels : la voix est sans éclat, mal projetée, mais elle correspond aux exigences voulues par la mise en scène d’un Masetto plutôt négatif, même si toutes les femmes veulent se faire examiner par lui et même s'il ne cesse de contrôler la santé de Don Giovanni.
Zerline au contraire a une fraîcheur bienvenue et sait donner à son chant une certaine innocence non dépourvue d’un peu de duplicité. La voix est claire, bien projetée, la diction est bonne, le ton est juste, et le personnage bien construit : la scène qui accompagne l’air « Vedrai, carino, se sei buonino » est un effeuillage en règle où elle ôte une blouse puis l’autre à la façon d’une Salomé de la danse des sept voiles qui fait bien rie la salle : un peu de giocoso que diable!.
Antoinette Dennefeld est aussi une Elvira juste, qui manque peut-être un peu de « poésie » au sens où le chant reste moins éthéré que l’habitude, notamment dans « Mi tradi ». la voix est large, plus énergique que désespérée, mais le chant est précis et la diction parfaite, ainsi que l’expression.
Eleonora Buratto, comme à Aix l’an dernier, est une Donna Anna éperdue, au volume notable qui emplit sans peine la salle et au style bien contrôlé, c’est le personnage peut-être le plus « classique » : son « Or sai chi l’onore » est impressionnant et son « non mi dir » parfaitement en place, réussi tant par le style, les agilités que l’expression. Elle emporte l’adhésion et avec Kyle Ketelsen, domine la distribution.
Ce Don Giovanni ne cesse de déjouer les attentes, et les attendus, et ces déstabilisations sont bienvenues, même si le mieux est quelquefois l’ennemi du bien. Au total, malgré un ou deux buhs, un vrai succès.
On peut voir jusqu'au 10 janvier 2019 la retransmission de la représentation du 7 juillet sur Culturebox

