
Adriana Lecouvreur est une machine à émotions, et une grande démonstration vocale notamment pour les rôles féminins, Adriana a deux airs célébrissimes, Io son l’umile ancella presque en lever de rideau, et au dernier acte, Poveri fiori, immortalisés par les grandes interprètes du rôle, Callas certes, mais surtout Magda Olivero, l’Adriana du XXème siècle…
La Princesse de Bouillon, mezzo, rivale, a un air d’entrée redoutable, Acerba voluttà que tous les amateurs de voix connaissent, et les duos Bouillon/Adriana sont aussi des morceaux de bravoure. Plaisir de chant, plaisir singulier de l’émotion, qui laisse un peu sur la réserve le rôle masculin, celui de Maurizio (Maurice de Saxe),qui a un bel air au second acte L'anima ho stanca, e la meta è lontana mais c’est dans les duos que s’affirme la présence de cette voix qu’a immortalisée Franco Corelli dans les années 60

Tout cela pour dire qu’on avance en terrain miné, parce qu’Adriana Lecouvreur repose sur la seule capacité des voix à faire pleurer et à émouvoir, le livret tiré de la pièce de Scribe n’étant pas des plus excitants. Il faut donc saluer l’initiative stéphanoise qui se lance dans l’aventure avec des voix certes connues, mais nouvelles dans cette œuvre, , en coproduisant avec l’opéra de Montecarlo et celui de Marseille la production de Davide Livermore (réalisée ici par Alessandra Premoli) dont Wanderer a rendu compte en novembre dernier.
Davide Livermore superpose deux mythes du théâtre français, Sarah Bernhardt, mythe de l’époque de la composition (1902) et Adrienne Lecouvreur, mythe du théâtre du XVIIIe avec sa fin mystérieuse. Scribe et Legouvé l’avaient immortalisé, et Sarah Bernhardt fut en scène Adrienne Lecouvreur, cela suffit à Livermore pour construire le mythe de la grandeur et de la fin en superposant les deux actrices, au début du cinéma muet et pendant la première guerre mondiale, où Sarah Bernhardt continue de visiter les soldats (elle avait été infirmière de guerre pendant la guerre de 1870). Ces superpositions de destins permettent à Livermore de faire raconter à Cilea une histoire à peu près contemporaine (l’œuvre est de 1902) en essayant d’évoquer l’époque, le ballet Le Jugement de Paris renvoyant ironiquement aux ballets russes et à Nijinski, ou de faire envahir l’espace du troisième acte de soldats blessés (que Sarah Bernhardt visitait effectivement), ainsi que de rappeler le film muet sur Adrienne jamais retrouvé .Toutefois, la Sarah Bernhardt amputée du quatrième acte, avait dans la vraie vie 70 ans et la superbe Béatrice Uria Monzon en est loin…mais on fermera les yeux sur ces entorses.
Livermore organise l’espace autour d’un décor qu’il a conçu avec le studio Giò Forma) posé sur une tournette représentant essentiellement une scène de théâtre vue de la salle et des coulisses. Laissant supposer que tout est théâtre et que la vie d’Adriana et/ou de Sarah Bernhardt n’est qu’une longue pièce de théâtre.
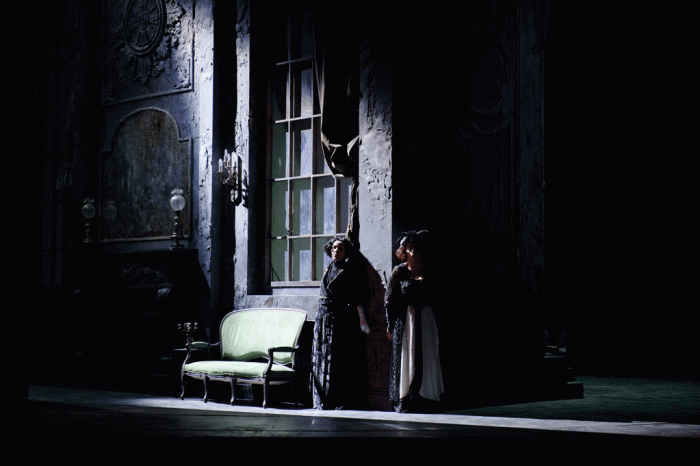
Seul le décor de l’acte II (chez la Duclos, qu’on ne verra jamais) impressionnant et inquiétant, laisse le théâtre pour une vaste antichambre en clair-obscur.
Dans son évocation de cette « belle époque » – et Livermore sait bien aussi le dialogue de l’époque envers le XVIIIe il suffit de penser au Rosenkavalier de 1911, pour que cette superposition, qui va certes mettre à mal quelques répliques du livret n’apparaisse pas comme un contresens. De plus la splendeur des costumes de Gianluca Falaschi fait aussi spectacle : dans un travail sur deux actrices mythiques de l’histoire du théâtre, tout doit faire spectacle et c’est au fond bien trouvé, ainsi que l’agitation des coulisses du premier acte, un des moments vraiment réussis de l’œuvre de Cilea, et de la mise en scène avec ses costumes colorés qui rappellent la Commedia dell’Arte et son agitation bon enfant. Il faut d’ailleurs saluer les rôles de complément qui sont tous bien portés : Cécile Lo Bianco (La Jouvenot), Valentine Lemercier (La Dangeville), Mark von Arsdale (Poisson) Georgios Iatrou (Quinault).
Si Virgile Ancely a un joli timbre de basse dans le Prince de Bouillon, il reste très raide en scène, avec des gestes stéréotypés sans aucun naturel, ce qui finit par gêner, au contraire de l’Abbé de Chazeuil de Carl Ghazarossian, parfait ténor de caractère, expressif, très à l’aise sur le plateau.
Une très belle surprise que le Michonnet de Marc Scoffoni, à la fois émouvant, naturel en scène, et surtout dominant parfaitement son chant : technique totalement maîtrisée, sens de l’expression sans jamais surjouer, parfaite limpidité du texte, belle projection et pour tout dire intelligence. Il est rare d’entendre des barytons totalement convaincants : Scoffoni en est un et n’appelle que des compliments. Un chanteur à suivre sans aucun doute car c'est une des voix émergentes les plus intéressantes.

Mais on venait surtout pour écouter Béatrice Uria Monzon dans sa prise de rôle, d’un rôle chargé d’histoire et de fantômes. Est-ce ce souvenir et la tension bien compréhensible qui au jour de la première n’a pas permis à Io son l’umile ancella de déployer l’habituelle fascination, manque de legato, vibrato accusé, manque d’appui sur le souffle : c’était une petite déception, mais bien vite effacée tant Béatrice Uria Monzon a su s’emparer du rôle, en lui donnant déjà sa marque, plus dramatique, plus énergique, avec beaucoup de relief et de vrais moments de théâtre (acte III). Poveri fiori fut particulièrement réussi et toute la partie finale ( où l'adéquation Adrienne/Sarah est la plus marquée) était empreinte de grande émotion et d’une vraie force en même temps.
Adriana, c’est une présence et on peut dire que Béatrice Uria-Monzon habite déjà le rôle, qu'elle a eu raison d'affronter au vu de l'orientation que prend sa carrière aujourd'hui..
À ses côtés, un Sébastien Guèze juvénile au timbre lumineux et aux moyens incontestables qui se sont étoffés, avec des moments de vrai contrôle (les mezze voci, les filati parfaitement maîtrisés) qui montrent une réelle maturité artistique et un net souci de caractériser le personnage par la couleur. Cependant, au début notamment, il a tendance à pousser la voix et passer inutilement en force (la voix passerait bien de toute manière) ce qui provoque quelques problèmes d’intonation et une nasalisation du timbre, et qui nuisent à la couleur et à l’expression. C’est vraiment dommage parce que les qualités sont réelles et que dans bien d’autres moments, il est dans la voix et dans l’allure le personnage et sait procurer une très grande émotion, toute la scène finale est vraiment une grande réussite, prenante et à certains moments – avec Uria-Monzon‑, bouleversante. C’est en tous cas un vrai Maurizio et je suis sûr qu’il va encore faire mûrir son approche ; très belle prise de rôle là aussi.

Le cas de Sophie Pondjiclis est différent : elle compose une Princesse de Bouillon (une prise de rôle là aussi) très contrastée par rapport à Adriana : plus Bouillon que Princesse, elle fait ressortir l’idée que des deux la véritable aristocrate n’est pas celle que l’on pense. La voix s’est étoffée, s’est élargie, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit vocalement une Princesse de Bouillon. Ses graves hallucinants et splendides (il est rarissime d’entendre de tels graves naturels non poitrinés) font plutôt entendre une Ulrica de Ballo in Maschera. Dans une voix homogène et si charnue des graves jusqu’au centre, le passage à l’aigu (puissant) n’est pas vraiment maîtrisé avec certains sons fixes ou criés – c'est un peu forcé pour tout dire dans un rôle qui se définit dans l’affirmation de ses aigus. C’est dommage car Sophie Pondjiclis est une chanteuse raffinée, très musicale, et que du point de vue de la diction et de la ductilité du texte, ainsi que de l’expressivité, elle effectue ici un beau travail de ciselure. Je l’entendis un jour dans Assisa a pié d’un salice (de l’Otello de Rossini) et ce fut une vraie révélation sur ses capacités de contrôle et d’intelligence du texte. J’ai plus de doutes sur la Princesse de Bouillon, même si son personnage est vraiment affirmé et intéressant.
Chez les trois en tous cas, on note un soin tout particulier à l'interprétation, à la couleur, à la diction très claire, on entend chez chacun tous les mots, et c’est un point essentiel que cette clarté de l’expression.
Fabrizio-Maria Carminati, vieux routier de l’œuvre a su dynamiser l’Orchestre Symphonique de Saint-Etienne, et soutenir les chanteurs, sans jamais les couvrir, leur permettant les respirations nécessaires et ajustant le tempo pour les mettre à l’aise, mais aussi donner une interprétation très lyrique et assez raffinée. Comme on aime Cilea.
Une représentation qui répond par son excellence aux efforts de la Ville pour soutenir son opéra.

