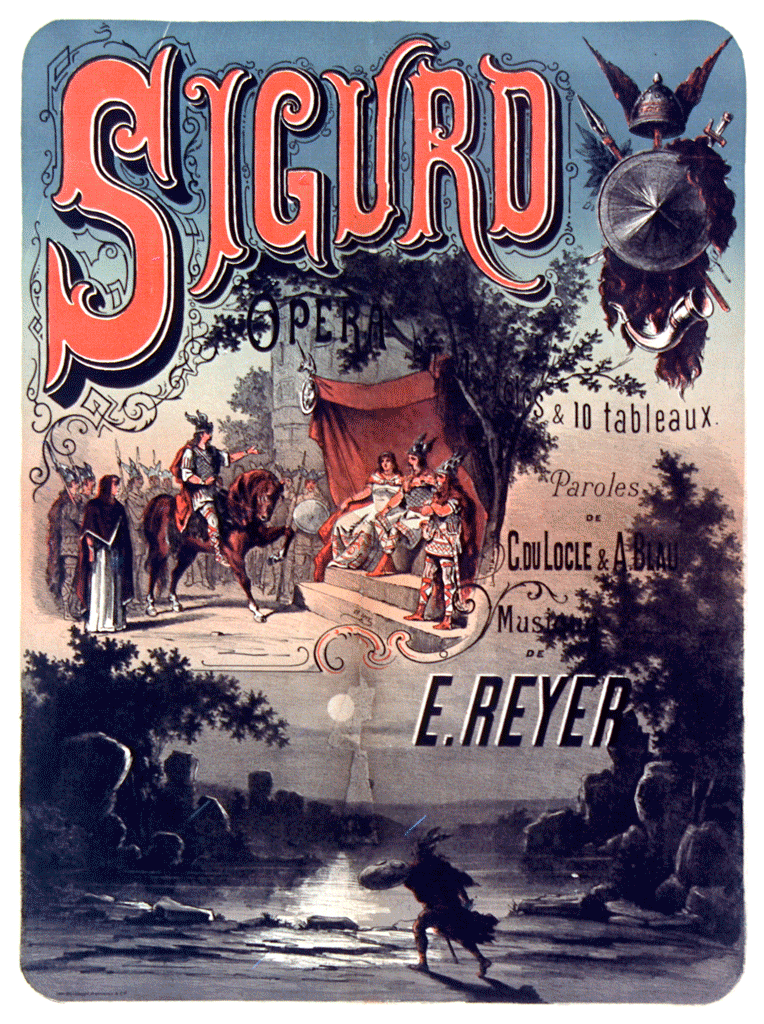 Le hors d'âge est à la mode, voilà que les salles préfèrent créer l'événement en cherchant dans archives aux faux-airs de brocantes plutôt que risquer une création. On pourra saluer au passage des salles comme l'Opéra Comique, l'Opéra du Rhin ou le Théâtre de la Monnaie, trois salles qui ont osé ouvrir avec des œuvres contemporaines. À Nancy, le nouveau directeur Matthieu Dussouillez inaugure son mandat avec le Sigurd d'Ernest Reyer, une œuvre donnée en version concert et qui trouve une justification dans le fait qu'elle avait été jouée pour la réouverture de ce même Opéra de Lorraine, jour pour jour le 14 octobre 1919. Serait-ce la seule raison qui justifiât le retour en grâce de ce fleuron de l'opéra français de la IIIe République ? Au-delà d'un aspect documentaire – encore faudrait-il réserver le terme aux plus compulsifs des archivistes – il faut bien avouer que l'œuvre ne dégage pas un intérêt qui justifierait un retour en grâce sous la forme d'une reprise scénique.
Le hors d'âge est à la mode, voilà que les salles préfèrent créer l'événement en cherchant dans archives aux faux-airs de brocantes plutôt que risquer une création. On pourra saluer au passage des salles comme l'Opéra Comique, l'Opéra du Rhin ou le Théâtre de la Monnaie, trois salles qui ont osé ouvrir avec des œuvres contemporaines. À Nancy, le nouveau directeur Matthieu Dussouillez inaugure son mandat avec le Sigurd d'Ernest Reyer, une œuvre donnée en version concert et qui trouve une justification dans le fait qu'elle avait été jouée pour la réouverture de ce même Opéra de Lorraine, jour pour jour le 14 octobre 1919. Serait-ce la seule raison qui justifiât le retour en grâce de ce fleuron de l'opéra français de la IIIe République ? Au-delà d'un aspect documentaire – encore faudrait-il réserver le terme aux plus compulsifs des archivistes – il faut bien avouer que l'œuvre ne dégage pas un intérêt qui justifierait un retour en grâce sous la forme d'une reprise scénique.

Il convient de s'interroger sur ces vingt années qui séparent la communication du scénario initial de Sigurd de sa création au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Il convient également de se replacer dans le contexte nancéen de 1919, partagé entre l'euphorie de l'inauguration du nouvel opéra et la volonté d'offrir à entendre un chef d'œuvre qui par sa thématique, rivalise de fait avec l'héritage wagnérien et fait office de résurrection nationale au lendemain de la Grande Guerre. À l'origine du Sigurd d'Ernest Reyer, il y a ce souffle épique que font souffler sur l'Europe du XIXe les publications successives du recueil des légendes scandinaves de l'Edda poétique. Fouettant jusqu'aux sangs les héritiers de l'âme romantique (eux-mêmes déjà pervertis par la celtomanie et l'"invention" des chants d'Ossian par Macpherson), ces récits reçoivent un écho particulier auprès de Richard Wagner qui se l'approprie et le réécrit largement pour en faire le sujet de sa Tétralogie. C'est bel et bien l'ombre tutélaire de Wagner qui plane sur les fonds baptismaux du livret de Sigurd – un mélange de fascination et de répulsion nationaliste qui prend sa source dans le scandale provoqué par les représentations de Tannhäuser à Paris en 1861.
La même année, le musicologue belge Emile de Lavalette publie une traduction française de l'épopée des Nibelungen. La lecture de l'ouvrage poussera Alfred Blau à rédiger le scénario de Sigurd qu'il ne tarde pas à proposer à Ernest Reyer. On voit déjà se dessiner, au-delà d'un intérêt purement esthétique, la volonté de rivaliser politiquement et musicalement avec la patrie de Wagner pour tenter d'allumer un contrefeu à la "musique de l'avenir". La matière littéraire de Sigurd multiplie les aberrations et les niaiseries dont la responsabilité est à rechercher moins dans la traduction romancée de Lavalette que dans la versification très improbable de Camille du Locle. Réussissant, au moins sur ce plan du style pompier littéraire, à surpasser le maître de Bayreuth, il reste dans ce livret des chefs‑d'œuvre qu'on ne résiste pas à citer comme ce délicieux chœur de femmes au début de l'acte IV chantant :
Pendant que la source jase,
En emplissant chaque vase
Imitons le flot jaseur…
Au-delà de cette prosodie de mirliton, il y a surtout cette imprudence à vouloir enfoncer le livret dans une matière chevaleresque qui prend très vite des allures indigestes. Là où Wagner polarisait son cycle autour de la question de la malédiction de l'anneau, il y a dans le Sigurd de Reyer une insistance à raconter les exploits d'un héros éponyme en isolant une zone de narration qui recouvrerait grosso modo celle du Götterdämmerung de Wagner. Les atermoiements de Camille Du Locle à livrer ses vers et les hésitations des directeurs successifs de l'Opéra de Paris retarderont la création de Sigurd. Composée entre 1863 et 1885, la partition a le temps de s'imbiber du dernier Berlioz et des rares irruptions parisiennes des opéras de Wagner durant cette période (Rienzi et Tannhaüser en tête). La thématique du livret et la proximité historique invitent l'auditeur de 2019 à scruter le moment où l'écoute devient possible dans ce continuum épais de marches harmoniques, de rutilances et de contretemps marqués à la grosse caisse et cymbale. Trois heures trente durant, Reyer réussit l'exploit de contourner les références explicitement wagnériennes. Au petit jeu du chat et de la souris, on finit par écouter en creux ce crépuscule à la sauce grand opéra français, orné d'une ferblanterie zim boum boum fouettant de rythmes binaires, une intrigue assez mince pour en extraire une forme de martialité ithyphallique ("Frappons les airs joyeux de hurrahs et de cris !"). L'enveloppe générale tend à une matière très bruyante et très sollicitante, traversée de temps à autres par des retours thématiques qu'on peut associer à des leitmotives, même si la technique n'a rien de comparable avec le modèle wagnérien.
Privée par la volonté du librettiste et la capacité du compositeur à envisager une œuvre rivalisant avec la dimension de l'Edda, l'intrigue de Sigurd se prend les pieds dans les ellipses successives. Pour exemple, la maigre justification du retour de Sigurd au château de Worms réside dans l'amour que lui porte Hilda, la sœur de Gunther. Celle-ci raconte au début de l'œuvre comment le héros l'a délivrée des Huns – les Huns pourtant, avec qui Gunther veut sceller une alliance, en offrant Hilda à Attila. Cette importance du rôle de Gunther marque une grande différence avec Götterdämmerung, où il est réduit à un personnage faible et falot. C'est lui qui, indirectement, profite de l'aveuglement amoureux de Sigurd pour sa sœur, par l'intermédiaire du philtre conçu par Uta, magicienne et nourrice de Hilda. Le héros propose, comme chez Wagner, de franchir le mur de feu et conquérir Brunehild en dissimulant son identité.

Il faut à ce monument d'art pompier une distribution qui puisse rivaliser avec les hérésies de l'écriture vocale, à commencer par le rôle-titre qui nécessite une ampleur des registres et une capacité à surmonter un orchestre souvent plus redoutable que les flammes qui protègent Brunehild. Peter Wedd relève le défi de chanter un rôle écrit à la serpe et qui donne tout son sens à la définition de ténor héroïque. Le timbre est ingrat et sans brillance particulière, souvent élimé par des prises d'air qui font blanchir les aigus par l'effort démentiel qu'ils nécessitent quasiment à chaque intervention. Le format de Brunehild sollicite la voix d'une manière beaucoup plus adéquate. La prestation de Catherine Hunold fait entendre une ligne et une souplesse qui donne à la vaillance du personnage une incarnation très convaincante. Camille Schnoor campe une Hilda très juvénile, tirant brillamment son épingle du jeu malgré des interventions rendues peu commodes par de périlleux et malaisés changements de registres.

À ses côtés, Marie-Ange Todorovitch réussit à donner une densité et une présence surprenante au rôle de Uta, la nourrice. Le Gunther de Jean-Sébastien Bou reste cantonné à une prudence relative qui maintient l'expression à fleur de notes pour un résultat en définitive assez décevant. Jérôme Boutillier impressionne davantage en Hagen, malgré des interventions assez limitées, tandis que qu’Éric Martin-Bonnet en Barde et surtout Nicolas Cavallier en Prêtre d’Odin assurent brillamment leurs parties. Frédéric Chaslin ne se contente pas de sauver le soldat Reyer, il s'impose avec brio et conviction comme l'ardent défenseur d'une musique qui exige un engagement sans faille à chaque mesure. Peu timoré dans les déferlantes de décibels, sa battue est d'une solidité à toute épreuve, dirigeant avec fougue un Orchestre de l'Opéra National de Lorraine qui trahit çà et là quelques approximations rythmiques. Les Chœurs d'Angers Nantes Opéra viennent porter main forte aux forces locales et le résultat satisfait largement aux exigences de l'œuvre, ce qui n'est pas peu dire.


Merci pour ce passionnant compte-rendu !