Dmitri Tcherniakov, comme à son habitude, propose une production à l’intérieur de trois espaces clos, trois pièces : au premier acte un salon de Yacht avec cet ameublement hi tech et bois si typique des navires de croisière ou des yachts de luxe, au second acte un autre salon, celui des espaces du palais de Marke, moins aéré, plus vieillot aussi, et au troisième acte, l’espace de Karéol, avec son papier défraîchi et ses meubles d’un autre âge, l’espace de l’enfance de Tristan, presque encore habité par ses souvenirs . Ainsi ces trois décors inscrivent-ils trois époques comme si le temps remontait.
Une vision dérangeante
Beaucoup de commentaires sur une production qui propose un couple bien peu traditionnel, avec un Tristan jeune, un peu distancié, assez peu concerné semble-t-il par l’histoire, et une Isolde dont la conduite est dictée par la passion : une confrontation de deux vécus plutôt que l’histoire d’un couple d’amants légendaires.
Ce qui frappe dans le travail de Tcherniakov, c’est d’abord une précision millimétrée dans les mouvements et les gestes des chanteurs, dans la relation des objets aux personnages, verres et bouteilles (Tristan et son équipe à l’acte I), sac à main (Isolde, acte I), réveil (acte III), et la construction d’ambiances radicales.

Qui regarde en coupant le son du premier acte la captation vidéo ((Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uYLQFxWTaCI )) ((Culturebox : https://culturebox.francetvinfo.fr/opera-classique/opera/tristan-et-isolde-de-wagner-a-l-opera-de-berlin-269589)) pourrait penser à une représentation d‘ Au théâtre ce soir, proposant un décor typique de Théâtre de boulevard. Ainsi Tcherniakov veut-il s’éloigner du mythe des amants éternels et proposer au contraire une lecture laïque et analytique de cette relation que tout empêche, à commencer par la société, mais aussi les individus eux-mêmes et dans cette mise en scène Tristan en particulier, un jeune homme mondain, avec son cercle d’amis qui promènent leur oisiveté arrosée d’alcool dans un beau yacht où tout est numérisé, une superficialité apparente qui cache des blessures plus profondes. On est loin du monde chevaleresque, de l’honneur et de la mort d'amour. Et de fait, Tristan dans le combat avec Melot est à peine blessé au deuxième acte et au troisième, il semble entré plutôt dans une prostration d’ordre psychique dans un univers plus mental que réel, sans être affaibli par une blessure qu’il n’y a pas. Il meurt d’une sorte d’attaque (il n’a cessé de bondir et de sauter pendant bonne partie de son monologue) à l’arrivée d’Isolde.
Isolde au contraire ne cesse de ruminer sa relation à Tristan, son amour né sur le cadavre de son ex-mari Morolt, une relation d’autant plus tendue que Tristan l’a quasiment vendue à Marke et la lui ramène. Dans cette vision plus traditionnelle, c’est Isolde seule qui semble d'abord faire l’histoire, par la force de la passion, une passion qui va peu à peu se transformer ou que Tristan va transformer en reprenant lui-même les rênes, puisque la Liebestod semble se conclure par le geste maternel de veiller l’enfant avec à la main le réveil des visions maternelles que Tristan a pendant tout l’acte.
Les personnages étonnent : on a parlé de Tristan et de sa bande, mondaine et nonchalante en face Isolde et sa confidente, amie, alter ego, cigarettes, alcool, sac à main (Isolde fouille nerveusement dans son sac à main) qui va ramener le mythe à une affaire privée, une affaire de personnes plus que de personnages. Une comédie dramatique et non un drame. Wagner le permet, lui qui appelle cette histoire Handlung (« Action ») et qui se garde bien donc de qualifier ce qui se passe. Tcherniakov se rue dans cette faille : c’est nous qui avons qualifié cette histoire de drame, c’est nous qui voulons à toutes forces un mythe, Wagner laisse un peu quant à lui le libre choix…
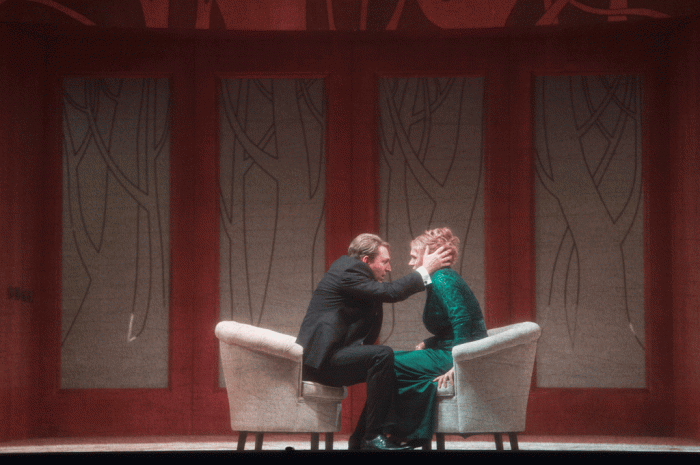
Une histoire de non-amour ?
Chacun dans ce couple se débat dans sa propre histoire : pour Isolde une passion jamais éteinte, plus « conforme », pour Tristan un compte à régler avec lui-même et de cette différence naît l’incompréhension et l’impossibilité. Ainsi Tcherniakov raconte une histoire impossible projetée non vers le futur mais toujours vers le passé et donc une histoire sans doute privée dès le départ de toute perspective sinon la mort : le philtre dans ce cas n’a aucun effet et le rire des amants après l’avoir bu est peut-être aussi le rire devant une sorte de mascarade à laquelle ils se prêtent par conformité à l’histoire qu’ils sont sensés défendre et illustrer.
Dans son théâtre, Tcherniakov s’attache souvent à un individu dont il fouille les motivations et les failles : facile dans Lady Macbeth de Mzensk où le titre donne la réponse, dans Pelléas et Mélisande, c’était Pelléas, dans Parsifal, c’est Kundry qui fait problème, dans Carmen, c’est Don José. Dans Tristan und Isolde, c’est Tristan dont on peut se demander d’ailleurs si les deuxième et troisième actes ne sont pas des pans de son monde mental, quand le premier acte ne serait que le monde réel.
On peut d’ailleurs comprendre ce parti pris : l’histoire de Tristan und Isolde est difficilement réductible aujourd’hui à une histoire d’honneur et de chevalerie, tant Wagner y a mis de ses lectures philosophiques et de son histoire personnelle, Mathilde Wesendonck, mais aussi Cosima : sa première fille avec Cosima née en 1865, l’année de la création, ne se nomme-t-elle pas Isolde ?
Comme souvent chez Wagner, l’opéra crée le mythe et non l’inverse. Que Tcherniakov s’attache à démanteler le romantisme apparent qui livre l’histoire en données brutes pour s’attacher aux chaines de causalité et aux explicitations possibles est une approche légitime et profondément actuelle. Seulement, et peut-être plus encore que dans son Parsifal, il raconte des possibles et les impossibles d’un amour humain et non l’histoire romantique et mythique d’amants littéraires. Il va même jusqu'à nier la possibilité d'amour. Pas de possibilité d'une île pour les amants de Cornouaille.

Un mythe épuisé par le théâtre
Tcherniakov semble nous dire que le mythe est épuisé, et que le théâtre-même en a épuisé tous les possibles, son troisième acte par le décor un peu désolé
 (et un papier vieillot représentant rochers et navires, comme projection de l’arrivée d’Isolde) n’est pas sans rappeler de très loin une vision à la Heiner Müller. Un décor pas forcément pauvre ‑la pauvreté n'a pas de sens dans cette histoire– mais qui renvoie à un monde lointain, une sorte de Terre étrangère pour reprendre le titre d’une célèbre pièce de Schnitzler. Un monde révolu fait des meubles de nos grand-mères, ce monde du souvenir d’enfance dans lequel semble s’enfoncer Tristan, où il rêve d’une mère et d’un père qu’il n’a pas vraiment connus.
(et un papier vieillot représentant rochers et navires, comme projection de l’arrivée d’Isolde) n’est pas sans rappeler de très loin une vision à la Heiner Müller. Un décor pas forcément pauvre ‑la pauvreté n'a pas de sens dans cette histoire– mais qui renvoie à un monde lointain, une sorte de Terre étrangère pour reprendre le titre d’une célèbre pièce de Schnitzler. Un monde révolu fait des meubles de nos grand-mères, ce monde du souvenir d’enfance dans lequel semble s’enfoncer Tristan, où il rêve d’une mère et d’un père qu’il n’a pas vraiment connus.
Mais le plus emblématique en ce sens est le deuxième acte, qui se déroule dans l’ambiance années 40 du palais de Marke, monde déjà un peu vieillot et vieilli, et présente un concentré des grandes mises en scène des 15 dernières années, par un système de signes qui prend sens, comme si les amants revivaient non leur vie, mais le théâtre dont ils sont le centre et qui les a « traités » : on y trouve Christoph Marthaler (avec le jeu appuyé sur l’interrupteur qu’Isolde allume), Peter Konwitschny (le papier peint qui imite les arbres du second acte de la mise en scène de Munich), Claus Guth (la table de la salle à manger), Katharina Wagner (quand Marke emmène Isolde à la fin) et évidemment Patrice Chéreau (l’arrivée de Marke qui regarde Melot dès ses premières paroles et non Tristan et montre ainsi qui est le vrai traître :
Tatest du's wirklich ?
Wähnst du das ?
Sieh ihn dort,
den treuesten aller Treuen ;
blick auf ihn,
den freundlichsten der Freunde
–
As-tu vraiment fait cela ?
L’as- tu rêvé ?
Regarde le
Le fidèle d’entre les fidèles
Regarde le
L’ami d’entre les amis
Il serait ridicule de penser que Tcherniakov à court d'idée se remplit de celles des autres. Dans ce deuxième acte au duo enchanteur, il souligne simplement une sorte d'épuisement des signes. Ainsi donc c’est bien un regard démystificateur, mais aussi « déthéâtralisateur » osons le mot, que porte Tcherniakov sur le drame. Il nous dit simplement que tout a été dit sur l’objet de théâtre, il reste à travailler sur l’objet d’étude et de penser au signifié de tout cela. Comme l’a titré une critique du spectacle : Tristan a lu Schopenhauer. Un opéra philosophique, une œuvre pour penser plus que pour émouvoir.Mais aussi, et évidemment, une œuvre sur le regard théâtral.
Isolde, un fantasme maternel ?
Ainsi donc modernité et autodestruction s’entremêlent dans une vision où l’on peut ne pas voir de suite logique entre premier acte et les deux autres, mais comme si les deux autres n’étaient que projections mentales, effets de filtre et non de philtre, du premier. Car ce qui semble être central dans cette vision, ce n’est non pas Isolde en tant que femme, que Tristan léger et frivole semble relativement négliger, mais en tant que substitut maternel, celle qui l’a soigné quand il était blessé, celle qui finira par le veiller dans une sorte de Mutterlicher Liebestod, mort d’amour maternel, reproduisant dans les lieux mêmes de l'enfance le fantasme de Tristan et peut-être lui donnant ainsi ce qu’il n’a jamais eu. Et d’ailleurs, conduisant Isolde à son oncle, substitut paternel, Tristan reconstitue un couple parental qui justifierait presque sa volonté d’aller chercher Isolde pour la porter à Marke.
Il y a là un territoire wagnérien à explorer : si on a dit que la question des pères est typiquement verdienne, celle des mères est typiquement wagnérienne et trouve son climax dans le dernier baiser maternel et premier baiser d’amour de Kundry à Parsifal. Quand Isolde s’enferme, un réveil à la main, pour veiller Tristan, comme il aurait voulu que sa mère le fît, alors nous sommes dans cet espace singulier qui propose une (psych)analyse du mythe.
La question des fantasmes de Tristan a été déjà posée par des mises en scènes, celle de Ponnelle en particulier à Bayreuth où Tristan rêve le retour d’Isolde et meurt dans la solitude désolée de l’arbre calciné, mais nous sommes ici dans une autre approche, très microscopique, presque scientifique qui cherche à expliquer, sans jamais asséner. Tout ce travail est un peut-être…

Le rire
Autre élément qui perturbe le spectateur au premier et deuxième acte, c’est le rire. Ce rire prend sans cesse la place de l’exaltation amoureuse : après avoir bu le philtre au premier acte et pendant le duo du deuxième, où Tristan et Isolde sont assis sur des fauteuils face à face, ou bien debout en fond de scène et où Tristan stimule Isolde à chanter comme s’il la poussait à l’exaltation presque en spectateur de la scène, comme si il voulait vivre en spectateur une histoire exaltée, regardeur de l’autre pour se conforter et non pour partager, comme un jeu qui a perdu sa valeur, comme un printemps adorable qui n'a jamais eu lieu. Ce rire franc répond aussi à la question posée par Tcherniakov sur le sens d’un amour donné par un philtre, sur la vacuité de cette magie là et même sur le refus d’un tel amour. La vérité de ces êtres est ailleurs. Mais le rire est aussi un gage d’humanité et une réponse à une angoisse ou une peur (peur du philtre ? peur de l’amour ?), en tout cas à une tension : le moment où on a eu peur d'y croire et qu'on n'y croit plus
On pourra discuter de ces motivations à l’infini et bien des spectateurs en sont sortis plein de doutes, s’interrogeant sur le sens d’un travail qui reste de toute manière difficile. Mais la frustration et l’incompréhension ne sont jamais un problème : l’art doit-il être forcément limpide ? L’hermétisme de Mallarmé, certains poèmes de René Char, certains tableaux de Pollock ? La compréhension n’est ni systématique ni obligatoire quelle que soit l’œuvre et même si elle semble « accessible », nous ne voyons souvent que les apparences des choses (la fameuse caverne platonicienne) mais il reste la fascination, il reste le sentiment qui vous saisit d’un besoin d’y revenir, – et l’existence d’une captation permet justement de revenir et d’observer- , et d’un besoin de comprendre et d’aller plus loin, si emblématique du Regietheater et d’une approche brechtienne.
Une question qui ne demande pas de réponse
On voit, et dans Tristan und Isolde notamment, tant de mises en scène pléonastiques, illustratives, romantiques au mauvais sens du terme pour faire rêver ou pleurer la Margot qui sommeille en nous, qu’un travail problématique qui nous heurte de plein fouet est bienvenu, parce que le Tristan und Isolde de Wagner pose des problèmes qui vont jusqu’au fond de ses questionnements philosophiques et théoriques, où le conceptuel se cache derrière un faux romantisme, d’ailleurs finissant à l’époque. Que les problèmes soient posés, sans qu’ils trouvent forcément réponse, seulement avec leurs possibles, me semble à la fois assez stimulant pour revenir observer attentivement ce travail, et assez évident pour faire saisir qu’un opéra tel que Tristan n’est pas qu’ivresse sonore ou histoire simpliste : l’art, c’est beau mais c’est aussi du boulot, disait Karl Valentin, et ce boulot est partagé par les acteurs et les spectateurs : peut-être ne peut-on pas tout comprendre, mais c’est bien ainsi parce que l’œuvre nous poursuit de ses silences. L’art est une question sans cesse posée au monde et chacun et chaque époque y apporte ou non ses réponses…Qui a épuisé les motivations de la Phèdre de Racine, ou de l’Alceste de Molière, ou les secrets de l’œuvre picturale de Raphael qui se présente comme une évidence au regard et qui pourtant ne cesse de faire question ?
Le mythe est dans la fosse
À cette conception difficile et problématique correspond un travail musical de Daniel Barenboim qui une fois de plus cherche à coller au travail du metteur en scène depuis assez longtemps pour construire avec lui une complicité où l’exaltante direction d’orchestre, dans un théâtre rénové au son d’une rare clarté, avec un orchestre au sommet, joue là aussi du contraste entre scène et salle, où l’émotion que dégage cette interprétation n'entre pas en contradcition avec la scène, mais en souligne les espaces de contraste, les frustrations, les déchirements, en installant entre ce qu’on voit et ce qu’on entend un espace qui d’une certaine façon reproduit la confusion mentale des héros représentés. Certains saisissent la question en se disant « la scène est cryptique mais au moins, la fosse compense… ! » comme si Barenboim et sa direction étaient la planche de salut du spectateur désorienté.
Barenboim, sans doute aujourd’hui le plus grand chef wagnérien, connaît à la fois son Wagner et donc sa Gesamtkunstwerk sur le bout des doigts. Dans ce travail où chacun est à sa place, musique et scène alimentent la distanciation nécessaire. Je me suis d’ailleurs demandé si le crescendo sonore qui aboutit à l’extraordinaire troisième acte, n’était pas métaphore des agitations intérieures de Tristan qui passe du rire à l’exaltation, de la vie au désir de mort. Il y a dans cette direction la passion, celle d’Isolde, la distance, celle de Tristan face à Isolde, mais aussi face à la société un peu abstraite et conforme du deuxième acte, mais aussi face à Marke avec lequel malgré tout il y a complicité.

Il y a aussi l’affichage de l’extraordinaire rapport entre musique et scène, qui culmine lorsque le solo de cor anglais (Magnifique Florian Hanspach-Torkildsen) est joué sur scène par le soliste, sur le futur lit de mort de Tristan, comme si dans ce monde mental la musique était part, comme si tout était « orchestré » , et sublimement : le solo du début du troisième acte restera une image fabuleuse de ce spectacle, que Kurwenal semble mettre en scène pour le réveil de Tristan, comme l’ange musicien du paradis.
La direction de Daniel Barenboim est un sommet sans doute difficilement égalable, j’oserais dire qu’elle continue d’être un sommet de production en production, en s’attachant plastiquement à chaque fois différemment à un univers et en le déclinant, dans le commentaire et non l’illustration, dans la variété aussi : Barenboim est de ceux qui ne dirigent jamais de manière identique à la veille. Autant de représentations, autant de productions, autant de Tristan. Ici on retiendra un tempo souvent lent, plus lent que l'habituel, un prélude anthologique, un fabuleux duo de l’acte II, avec des sons enchanteurs et un suivi de la scène exemplaire, et une manière de dessiner une ambiance au troisième acte dès le départ qui tend le drame et en même temps l'inscrit une mélancolie déchirante, un monde sans vrai sens où même l’amour est vide, que le chef d’orchestre soutient à bout de bras. Le mythe que le metteur en scène efface est dans la fosse.
Une distribution assez neuve, parfaitement en phase

Pour l’occasion, ont pu être réunis des solistes qui constituent une nouvelle génération, rassurante en soi parce que l’on peut afficher aujourd’hui des Tristan und Isolde variés et de bon niveau dans de nombreux théâtres en même temps.
Andreas Schager :
Le Tristan d’Andreas Schager n’est pas inconnu, on l’a entendu çà et là et notamment à Rome et on connaît les qualités intrinsèques de l’artiste. Un timbre magnifique, une puissance peu commune, un engagement sans failles. On en connaît aussi les défauts : impossibilité de contrôler le volume, difficultés à ne pas à un moment hurler au lieu de chanter et pour finir quelquefois, comme à Rome, perte de la voix. Avec les risques inhérents sur sa pérennité.
Dans le cas qui nous occupe, il est clair qu’Andreas Schager est revenu sur ce rôle et qu’il l’a travaillé, avec Barenboim sans doute, mais surtout bien en amont. Le contrôle sur la voix est bien plus marqué, les moyens sont économisés, il chante toujours avec le même engagement mais avec plus de discernement, et le résultat est tout simplement somptueux, et réellement fabuleux au troisième acte où il réussit une performance scénique et vocale proprement inouïe, scéniquement il bondit, saute, court et s’engage de manière tellement bouleversante que l’effort semble paradoxalement non l’épuiser mais le stimuler. La voix tient le coup, même si elle accuse un peu de fatigue, comme souvent chez les Tristan, mais rien qui ne soit que très ordinaire. Rien à voir avec ce que nous avions déjà entendu de lui dans le rôle. C’est vraiment en l’entendant dans cette production qu’on peut dire qu’un Tristan est né, et qu’il est vraiment exceptionnel.
Anja Kampe :
Anja Kampe est Isolde, avec ses moyens et son intelligence. Depuis que j’ai entendu Kampe avec Abbado dans Leonore de Fidelio en 2007, j’ai toujours la même impression d’une voix énergique et incarnée, d’une interprète exceptionnelle et de moyens réels qui ne suivent pas toujours, notamment au moment des passages, avec un aigu souvent triomphants (sa Sieglinde bouleversante à Bayreuth) des centres solides des graves un peu éteints, mais comme un vide entre le centre et l’aigu, avec quelquefois l’impossibilité de trouver une fluidité vocale suffisante.
Son Isolde est ici totalement convaincante, et soutenue de bout en bout par Barenboim qui adapte tempo et volume pour ne pas la mettre en difficulté, d’abord parce que la mise en scène, qui contraint l’artiste à un jeu moderne, à des mouvements naturels, lui convient mieux que des productions plus statiques. Elle fait vivre lsolde avant de la chanter, avec une expressivité, un soin à la parole, en engagement jusqu’au moindre des gestes qui là aussi alimente le chant et l’interprétation. Si Isolde est assise sur un banc et chante le duo côte à côte avec Tristan, cela détermine une gestualité, un ton particuliers, dans les fauteuils (si importants dans le travail de Tcherniakov) d’un salon de Yacht ou du salon vieillot du roi Marke, cela contraint à changer le ton, la tenue, le moindre des mouvements, avec des incidences sur un chant presque plus conversationnel qui s’adapte par sa variété et sa couleur, et l’on se trouve devant une Isolde vivante, juste, qui sait gérer ses moyens et totalement convaincante.
Quant au juge de paix que constitue la Liebestod, elle en donne une interprétation bouleversante, à la fois énergique et tendre, très différente d’une Liebestod qui ouvrirait les portes de la mort, parce qu’elle n’est pas Liebestod mort d’amour, mais Liebesleben, vie d’amour. J’ai en effet rarement entendu une Liebestod si « vivante » – si l’on peut me permettre le paradoxe, si incarnée, si fortement charnelle dans un morceau qu’on ressent comme éthéré et déjà ailleurs : elle est « hic et nunc », terrienne, elle s’impose et se pose et cela donne une Liebestod d’une très grande nouveauté. Sans l’ombre d’un doute, une Isolde nouvelle est née.
Ekaterina Gubanova :
Autour de ces deux interprètes d’exception, une distribution sans failles profondément juste où chacun est le personnage voulu. A commencer par la Brangäne de Ekaterina Gubanova, non plus suivante, mais meilleure amie, confidente, go between et à ce titre personnalité sans doute plus marquée qu’une Brangäne ordinaire. Energie, engagement, voix puissante et bien posée et projetée, Ekaterina Gubanova, habituée du rôle, lui donne grâce à cette mise en scène un vrai relief, et une vraie présence. Tout se passe comme si le travail scénique effectué poussait les chanteurs à sortir d’eux-mêmes y compris vocalement quand leur rôle est vu différemment de l’habitude ou de la tradition.
Stephen Milling :
Stephen Milling n’est pas le roi Marke vieillard qu’on a l’habitude de voir, en ce sens, Tcherniakov suit un peu Katharina Wagner dans son idée, mais il n’est pas le salaud de la mise en scène de Bayreuth, qui est citée, comme on l’a vu plus haut. La basse danoise, familière du rôle chanté à Florence, à Naples, à Vienne et aussi en 2014 dans la dernière reprise de la mise en scène de Kupfer de la Staatsoper de Berlin affiche ici une sérénité et une distance qui semblent favoriser Tristan cherchant au deuxième acte à renouer avec lui, comme si tout cela n’était pas si grave. La voix est sonore, bien projetée, avec une présence physique notable sur le plateau, une voix sans les ombres mélancoliques ni les harmoniques d’un René Pape, mais ce Marke là n’est pas mélancolique, il est d’une pièce, assez froid, et un peu momifié dans son rôle : la couleur et le dire de Milling conviennent .
Boaz Daniel :
Boaz Daniel est un Kurwenal qui n’a pas la couleur poétique d’un Michael Nagy ou d’un Gerd Grochowski, trop tôt disparu. Il a le dire et les attitudes d’un être d’aujourd’hui, notamment au premier acte, avec une diction et une couleur inhabituelles pour le rôle, qui convient au travail de mise en scène, sans vulgarité, mais sans un contrôle strict du chant : c’est très bien rendu, c’est vivant, c’est bien chanté parce que la voix est puissante, projetée, et domine bien l’orchestre. Ce rôle de Kurwenal-copain lui va bien.
Les autres rôles :
Très beau Melot de l’excellent Stephan Rügamer, les Melot notables sont si rares qu’on remarque celui-là et les autres rôles sont plutôt très bien tenus, Adam Kutny (Ein Stuermann) et Linard Vrielink (Ein Hirt, Stimme eines jungen Seemann) membres du studio de la Staatsoper de Berlin lui font honneur.
Un spectacle déconcertant sans doute, fort sûrement, une de ces productions qui vous accompagnent longtemps, sans qu’on sache toujours pourquoi, mais c’est le destin du grand art de garder sa part de mystère.


Soirée exceptionnelle dans tous les domaines, avec un moment magique de pur bonheur visuel et musical lors du duo du 2ème acte ou Tristan et Isolde chantent front contre front dans un amour (peut être) enfin trouvé pendant un court moment (Margot a pu verser quelques larmes sans se cacher!).
À signaler la veille, une Salomé passionnante
Désolé, mais l'ayant vu à la télévision, (donc différent, obligatoirement), je n’ai pas la même opinion, surtout du ténor. Pour moi, Schager souffre d’un vibrato bien trop large et disgracieux, sans doute parce qu'il a trop forcé la voix. S’il s'était limité à un répertoire moins exigeant, la voix serait sûrement plus contrôlée, le ton moins sec.