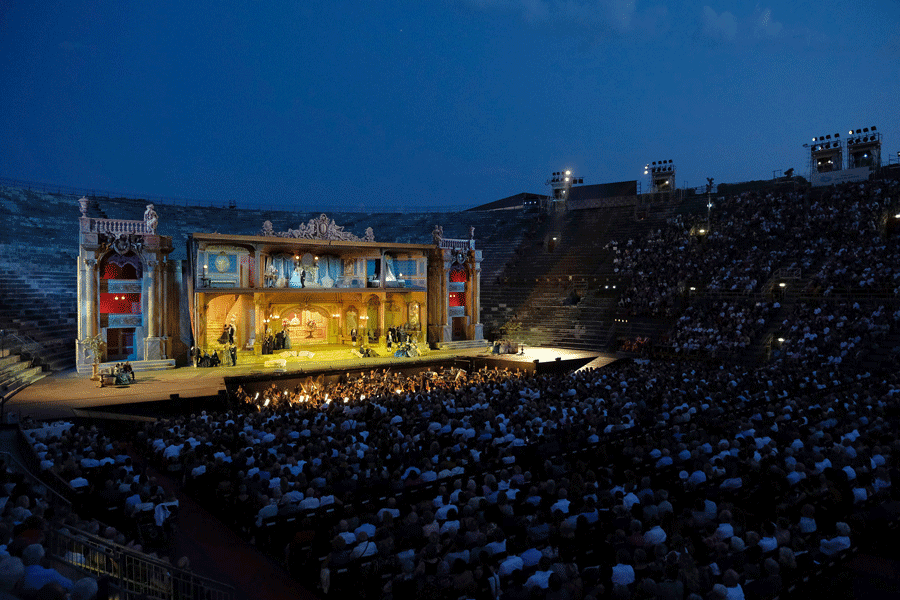
L’Arena a ses rituels, parmi lesquels l’agitation des gradins et des vendeurs ambulants, parmi lesquels la sonneuse de gong vêtue en fonction du titre affiché et annonçant le début de la représentation, toujours acclamée, rituel aussi que la présence d'un public chaleureux, heureux, populaire (et moins populaire aussi dans les « poltronissime »). Rituel enfin que la nécessité du grand spectacle, pour remplir l’énorme plateau. Pour l'occasion, la scène reste tout de même concentrée autour de l’énorme décor de Zeffirelli, comme une scène sur la scène, en style Napoléon III rappelant très vaguement l’Opéra Garnier. Pas d’utilisation des gradins de l’arrière scène, mais une concentration sur le plateau. Il est vrai aussi que les scènes intimistes de Traviata (Acte II, premier tableau et Acte III) pourraient mal s’accommoder de l’énormité du lieu. Et pourtant cette énormité les met justement en valeur.
Franco Zeffirelli est un metteur en scène des masses et du monumental, même si on lui doit une Aida notable pour le petit théâtre Verdi de Busseto (300 places). Les mises en scènes marquantes laissées sont notamment l’Aida de la Scala (la première, en 1963) dans des décors de Lila De Nobili, récemment reprise, La Bohème toujours à la Scala en janvier 1963 encore au répertoire (mais aussi une copie conforme à Vienne – en novembre 1963 -, encore au répertoire, tout comme sa Carmen qui remonte à 1978) et une production sensiblement différente dans le cadre plus vaste du MET (1981), mais aussi bien d’autres titres. En somme, Franco Zeffirelli a accompagné les trois plus grands théâtres au monde pendant des dizaines d’années. Qu’on apprécie ou non ce style de travail, il marque une époque, et marque aussi une tradition née de Luchino Visconti dont il fut l’assistant.

Cette filiation est particulièrement sensible dans le premier tableau de l’acte II, sièges en osier, plantes, qui alimentent évidemment la nostalgie.
Il y a dans ce travail à la fois cette référence nostalgique, mais aussi l’inscription par Zeffirelli dans l’univers Napoléon III (La Traviata est de 1853, tandis que La Dame aux Camélias est de 1848), c’est à dire dans un cadre quasiment contemporain de la trame de l’opéra. Avant Carmen (1875), Verdi a peint là quelque chose de son temps, d’un Paris qu’il connaissait bien, d’un univers social qu’il ne pouvait pas ignorer tant il est lié à l’opéra. Et pourtant, tous ses sujets jusque-là étaient des sujets historiques : La Traviata est le premier opéra de Verdi inscrit dans le temps et l’époque, un opéra contemporain en quelque sorte, et qui aborde (avec Dumas fils) la question du demi-monde, de la morale bourgeoise et de ses ravages.

Le travail de Zeffirelli doit naviguer entre grand spectacle (chœur nombreux, ballet bohémien de la scène chez Flora), et scènes intimes et concentrées (Acte I sur deux niveaux, celui du privé au 1er étage et celui du public au rez-de-chaussée). A ce titre, l’acte III ne manque pas d’allure, réduit à quelques personnages (sauf intervention, assez mal gérée au demeurant parce que peu claire, des masques de carnaval après l’addio del passato), dans ce grand décor abandonné du premier acte d’où il ne reste que quelques caisses.

Zeffirelli n’est pas un conducteur d’acteurs, les chanteurs sont livrés à eux-mêmes, encore plus dans cette représentation à la distribution quasi unique d’ailleurs, et à Vérone, la lisibilité de l’acteur est un leurre vu l’impossibilité de lire les gestes qui ne soient pas démultipliés, ou les expressions de visage. Alors, plus que mettre en scène, il illustre en construisant un univers, de références, soit personnelles soit stylistiques, et dans cette entreprise, il est rarement médiocre (sauf sans doute dans son Aida version 2 qu’il fit pour Lissner à la Scala, un peu ridicule par sa pompe excessive).
Zeffirelli a veillé à un décor qui regroupât les forces, qui pût aussi aider les voix à mieux réverbérer, notamment dans les scènes intimes, conçu comme une scène dans la scène, et qui demande des changements spectaculaires, mais finalement assez simples dans leur réalisations (ajout d’une verrière pour le premier tableau de l’acte II, puis des éléments de décor qui pivotent et le tour est presque joué au deuxième tableau pour la scène chez Flora).
En tous cas cette Traviata reste fidèle à sa vision, soit dans son film que dans ses mises en scènes passées, et s’inscrit directement dans le mythe zeffirellien . Il y a fort à parier qu’elle restera longtemps au répertoire de Vérone ; on s’y laisse prendre, comme à une Traviata rêvée qu’on a tous portée à un moment dans son cœur. Il y a dans ce spectacle quelque chose comme 50 ans d’opéra et plus qui passent, et cela parle évidemment aux générations qui ont vécu cette période ; peut-être moins les jeunes générations de fans d’opéras. Nostalgie et émotion donc, dans un spectacle attendu et qui ne déçoit pas.
Du point de vue musical, l’événement est aussi à la hauteur. Vu l’acoustique difficile de Vérone, il ne faut pas attendre une lisibilité exemplaire de l’orchestre, ni percevoir les raffinements d’une partition qui n’en manque pas. Et pourtant, Marco Armiliato propose une interprétation qui n’en fait jamais trop, très claire, précise, soucieuse de gérer l’énorme plateau (on y entend quelquefois d’inévitables décalages avec le chœur, mais pas ici) et d’accompagner au mieux les chanteurs. Un seul élément peut gêner, le son amplifié de l’orchestre en coulisse qui de la place où je me trouvais était assez perturbant, mais c'est un détail. En vrai professionnel, Armiliato sait rendre à la partition l’énergie qu’il faut dans les moments spectaculaires et attendus (le Libiam’, par exemple ou le chœur bohémien de la soirée chez Flora), mais il est surtout attentif dans l’acte II à permettre aux voix de s’épanouir, et notamment attentif à ce qu’on entende bien le phrasé et le style impeccable de Domingo, qui n’a plus toujours la projection demandée, tout comme l’accompagnement très senti de l’addio del passato de l’acte III avec la subtilité et la couleur voulues.
Vérone gère ces deux mois et demi de festival (du 20 juin aux premiers jours de septembre) un peu comme un théâtre de répertoire : il y a cinq productions d’opéra en alternance, et pour des artistes qu’on voit dans plusieurs productions, d’autres qui viennent seulement pour une à deux soirées, de même pour les chefs qui alternent. Cela signifie peu de répétitions pour les artistes invités, mais aussi des soirées très attendues ou réussies et d’autres plus pâles ou plus ordinaires et donc une qualité forcément irrégulière. Vérone est un lieu de communion fervente autour de l’opéra, moins un lieu du bel canto. La chance de cette soirée, c’est que ce fut les deux.
Et il faut rendre hommage aussi aux équipes techniques nombreuses et parfaitement rodées, qui changent ces énormes décors en peu de temps, par une coordination que les spectateurs ont sous les yeux, et aussi à la gestion des masses chorales, plus facile dans cette Traviata où elles sont réunies et regroupées, que dans Carmen (dont nous rendrons compte) où elles sont plus largement distribuées sur l’espace. Si, comme cela menaçait il y a quelques années, Vérone avait dû mettre la clef sous la porte, c’eût été une perte irréparable pour la tradition italienne, mais aussi pour tant de compétence gâchée : la qualité des « maestranze » (des équipes techniques) de Vérone et la compétence accumulée et transmise par une tradition qui remonte à 1913 sont quelque chose de tout à fait unique et exceptionnel, un vrai trésor de la culture italienne.
peu de remarques à faire des rôles de complément, assez bien exécutées, et on notera avec plaisir la présence de l'Annina de Daniela Mazzucato… Amarcord…
Un italien, une américaine et un espagnol ont fait triomphé ce soir la musique et l’opéra, art international s’il en fut.

Vittorio Grigolo était Alfredo, et ce fut un Alfredo exemplaire. On connaît le côté exubérant (et sympathique) du personnage, et quelquefois l’absence de contrôle d’une voix au timbre vraiment exceptionnel (il a retrouvé cette absence de contrôle par des saluts spectaculaires). Sans doute conscient d’être aux côtés de Placido Domingo qui fut Alfredo jadis (et quel Alfredo !) il a dominé ses passions, et proposé un chant plus contrôlé, particulièrement sensible et senti, avec des aigus lumineux et solaires, et un comportement convenant particulièrement au personnage, extraverti certes (de’ miei bollenti spiriti d’ailleurs plus retenu que d’habitude) mais sans jamais en faire trop (« strafare » disent les italiens) et cette interprétation plutôt mesurée tout en étant formidable de jeunesse, de vigueur et de don de soi est l’une des plus belles entendues ces derniers temps dans le chef d’œuvre de Verdi. Pas une faute de goût dans sa prestation, pas un moment vulgaire ou racoleur : il fut vraiment à la hauteur de la situation et un Alfredo exceptionnel.

Lisette Oropesa était Violetta, un rôle qu’elle chanta il y a quelques années et qu’elle a interprété l’espace d’un soir à Athènes quelques jours avant, histoire de se le remettre en voix. Ce qui étonne toujours chez Oropesa et qui ravit, c’est d’abord son phrasé italien quasi parfait, son sens de la couleur, l’impeccable contrôle de la voix et la tenue du souffle. On lui a reproché quelquefois une sorte de supériorité de la technique sur l’émotion ; on a au contraire ici l’union d’une technique impeccable et le sens donné à chaque mot, le poids de l’expression (quel deuxième acte ! quelle intensité dans amami Alfredo !) et l’intériorité, un mot étrange dans une représentation devant 15000 personnes, où elle est une petite tache blanche sur l’immensité de la scène. Lisette Oropesa, aux origines cubaines, a une évidente familiarité avec un phrasé latin, et une vraie sensibilité, outre une technique de fer acquise dans la formation américaine. C’est d’emblée une Violetta avec laquelle il va falloir compter, car m’est avis qu’elle va les multiplier. Son Addio del passato est exemplaire, et même sa lecture de la lettre, si claire. Et en plus elle a les notes qu’il faut, dans les agilités (ses gioir du premier acte) comme dans les moments plus lyriques du deuxième (dite alla giovine bouleversant et sans doute aussi décuplé par l’émotion distillée par son partenaire Domingo).
Placido Domingo, justement, applaudi longuement à son entrée à scène ouverte, reste un phénomène : malgré l’âge (né en 1941), malgré une voix qui n’a plus l’éclat d’il y a quelques années (même lorsqu’il chantait déjà les barytons), mais qui a la pâte et le grain d’un Germont-père. C’est certes un mythe vivant à qui on pardonnerait tout : mais justement il n’y a rien à pardonner, car avec ce timbre ‑là, clairement timbre de ténor (dès que les aigus sortent, on entend le Domingo d’antan), avec cette voix unique à qui en 1976 lors de ses premiers Otello on prédisait tout au plus deux ans, Placido Domingo est encore fascinant en soi, et pas en référence à son passé. Il y a sans doute moins de projection, mais il y a le phrasé, il y a l’expression, il y a l’extraordinaire humanité d’un chant qui bouleverse : sa scène avec Violetta secoue fortement, parce qu’il ne cherche pas à imposer, il est presque suppliant, presque soumis à Violetta elle-même bouleversée. Une scène d’anthologie, non par le chant « technique », mais par la rencontre de deux artistes qui savent exprimer l’émotion, qui savent veiller à rester contrôlés et qui réussissent à s'unir pour nous tirer les larmes.

Face à l’Alfredo de Grigolo, cette voix de ténor chante Di Provenza il mar avec un sens du phrasé unique, avec une émotion vraie, née non du style mais de l’extrême naturel de l’expression : il n’y là rien d’artificiel, et avoir face à face deux générations de ténors est quelque chose de fascinant et l’éclat de Grigolo (les éclats, vu la scène qui se joue en cette fin de tableau) répond point par point au ton fatigué, déçu, de Domingo. Jamais l’opposition père fils n’avait pris plus de sens.
Seul moment où l’on sentit un peu la difficulté, la réplique finale non udrai rimproveri d’ailleurs quelquefois coupée, d’une couleur plus barytonale et grave, n’a pas la clarté et la limpidité qui précède, mais c’est bien peu face à la performance globale.
Voilà une soirée où l’émotion fut d’autant plus forte qu’on a entendu une vraie et simple Traviata, sans fioritures, et sans jamais tomber dans l’excès ou la pleurnicherie ou l'histrionisme, d’une immense dignité, d’une très grande qualité, bouleversante, qui laisse un sentiment de plénitude. Une de ces soirées qui comptent dans une vie de lyricomane.

