
David Bösch c’est d’abord un univers, dessiné par ses compères Patrick Bannwart et (la plupart du temps) Falko Herold pour les costumes, un univers souvent désolé, pauvre, de décharges ou de maisons abandonnées, un univers nocturne aussi. Il a su créer une ambiance particulière à ses mises en scène, poétique et tendre toujours, souriant quelquefois, nostalgique souvent amère parfois.
Son travail ici rappelle en écho son Elisir d’amore, l’un de ses premiers travaux à Munich, une autre comédie paysanne très réussie. Il excelle dans ce type de cadre, plus peut-être que dans des opéras « à enjeu » comme Die Gezeicheneten, voire Simon Boccanegra (tous deux donnés à Lyon). Sa mise en scène de référence reste néanmoins pour moi L’Orfeo de Monteverdi, monté pour Munich au Prinzregententheater (en 2014 et 2015).À cet univers esthétique, il faut ajouter le sourire, la discrète ironie, la tendresse qui inonde ce spectacle, sa dernière production munichoise donnée en décembre 2018 et reprise pour le Festival de juillet.
On connaît l’histoire : Hans aime Marie, que Kezal le marieur l’a fait promettre à Wenzel, le fils d’un deuxième lit du riche paysan du coin, Micha. Hans, qui a été abandonné à la mort de sa mère par son père soumis au diktat de sa deuxième épouse, accepte de recevoir de l’argent de Kezal, s’il reconnaît que Marie doit être mariée « au fils de Micha » ; scandale et tristesse de Marie, fiancée vendue ; mais on découvre à la fin que Hans est fils d’un premier lit de Micha, tout est bien qui finit bien.
Montagne de foin qui fume çà et là à cause de l’ensilage, ou plutôt tas de fumier en formation, tracteurs, pompe à bière, barbe à papa, vélos, dans son habituel univers gris, élément permanent des décors de Patrick Bannwart, voilà le cadre d’une paysannerie bon enfant, éloignée du monde des villes, où le seul personnage qui a intégré la modernité un peu cheap des réseaux, d’internet et de la com, c’est le marieur Kezal (vidéos agressives et pleine d'humour) qui pour une fois va rater son coup.

David Bösch installe une ambiance très « nature » sans vulgarité mais vaguement rabelaisienne, au milieu des éléments des travaux des champs, dans une campagne plus bavaroise que bohémienne, pour respecter la traduction allemande voulue par le chef Tomáš Hanus.
Bösch s’autorise donc quelques sourires, comme les jeux avec le souffleur, comme la queue des paysans imbus de bière aux toilettes (le « Klo ») lors de la fête, ou l’arrivée de Wenzel, l’autre fils d’un deuxième lit de Micha, avec Willi, le cochon (vivant) qui semble être son seul ami, il s’autorise aussi de refuser les ballets trop « folkloriques » en les remplaçant par des mouvements de chœur ou pantomimes, et surtout au troisième acte par une performance d’Esmeralda, devenue funambule.
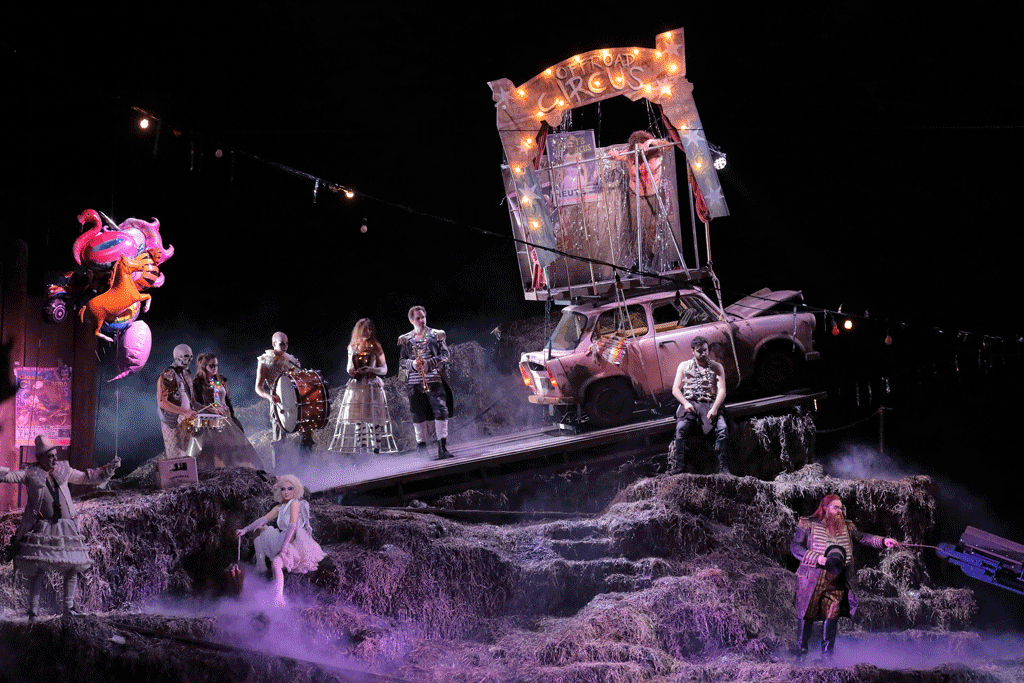
Il donne d’ailleurs une importance singulière à la troupe de cirque qui arrive à l’acte III avec cette Esmeralda danseuse, chanteuse et funambule, mettant en scène la versatilité de la jeune Anna El-Khashem et une machinerie spectaculaire (il y a même une Trabi) de fête foraine campagnarde. On sourit, on apprécie cette ambiance, qui marque l’opposition sociale entre Micha (de petite taille et maigre) et sa femme (un beau brin ‑Irmgard Vilsmaier- qui domine son mari de la tête et des épaules) et les parents de Marie, manipulés par Kezal, et qui marque aussi la tentative de placer à n'importe quel prix Wenzel, le fils un peu simplet. En somme une sorte de scène de genre, avec une volonté de clarté évidente et de lecture "à première vue" qui s’impose dans l’opéra bouffe.
Une clarté d’ailleurs qui évoque discrètement tout l’arrière-plan social induit par cette histoire de mariage. Le couple Micha-Agnès a besoin de placer le fils Wenzel, impossible à marier « naturellement », et Kezal trouve le couple Krushina et Kathinka dont l’alliance avec le riche Micha peut être intéressante socialement.
Le couple Marie-Hans est plutôt heureux au départ, bien accepté du village, même si Hans est un ouvrier agricole venu d’ailleurs, vif, débrouillard où, dans un milieu aussi fermé, être "d’ailleurs" peut être un obstacle. Hans sait d’où il vient : abandonné par son père plutôt riche à la mort de sa mère sous la pression de la nouvelle femme avec laquelle il a eu un fils, il a dû se gérer tout seul, d’où sa débrouillardise.
Pour ces raisons, le couple reste fragile, Marie est menacée d’être mariée à quelqu’un qu’elle ne veut pas, et Hans n’a pas apparemment les moyens de l’empêcher.
Dans le monde de l’opéra bouffe, ces éléments sociaux vont se résoudre, mais il reste que les questions ne sont pas a priori résolues.
Bösch s’intéresse fortement à Wenzel, le personnage un peu sacrifié de l’œuvre, qui est complètement instrumentalisé, vu qu’il n’a aucune initiative, complètement sous la coupe de sa mère. Et le livret de Karel Sabrina trouve une solution plutôt originale pour dénouer l’affaire : il invente une sorte d’étrange Deus-ex-machina, un cirque de campagne un peu cheap, dans cette production symbolisé par une Trabi (la Trabant d’Allemagne de l’Est) et son directeur, passant par-là, dont l’acteur qui joue l’ours s’est saoulé au village et personne n’a la corpulence pour le remplacer. C’est alors qu’il remarque Wenzel et lui propose le rôle, et s’il l’accepte, il pourra alors épouser la danseuse, Esmeralda.
Après quelques hésitations et quelques peurs inhérentes au personnage, Wenzel accepte, c’est l’occasion pour lui de se libérer de la mainmise maternelle et de vivre enfin en première personne.
David Bösch fait ainsi d’une pierre deux coups, il raconte l’émancipation de Wenzel, et le mariage de Hans et Marie, puisque Micha reconnaît en Hans son fils, qui peut ainsi justifier du contrat « de vente » signé avec Kezal, où Marie peut épouser « le fils de Micha » (sans dire lequel). Elle choisit Hans, Wenzel part avec le cirque, et les deux fils peuvent ainsi vivre leur destinée et s’émanciper d’une petite société un peu trop fermée
On ne s’étendra pas sur la question de la vente, il reste évidemment que Marie, même pour la bonne cause, a été considérée comme une marchandise qu’on négocie, aussi bien par ses parents que par son fiancé…mais #Metoo n’était pas passé par là.
On le voit, la trame lue par David Bösch a des complexités et des implications plus profondes qu’il n’y paraît aussi bien du point de vue social qu’affectif, mais la marque de ce travail est non d’insister, mais d’évoquer, sans jamais être lourd. Il y a toujours de la tendresse et du sourire, quelquefois aussi une cruauté induite, mais jamais de méchanceté ou de démonstration lourde. Il exploite les silences du livret notamment il retourne la manière dont est traité Wenzel à l’avantage de ce dernier, ridiculisé par sa mère dans les dernières répliques du livret, mais il s’en moque et sort grandi par une mise en scène qui le prend vraiment en compte et lui rend une « psychologie » qui évite le ridicule (il essaie de se pendre, médite sur son état etc…). C’est peut-être là l’une des originalités de ce travail que de rendre sa noblesse au personnage déglingué. Dans l’opéra-bouffe, tout le monde doit trouver son compte.
Le travail musical est à la hauteur des attentes.
Le chef Tomáš Hanus, élève de Jiři Bělohlávek, explique longuement le choix de la version allemande, là où désormais la plupart des théâtres choisissent la version originale tchèque. Il aborde la manière dont Smetana a été confisqué au nom d’une identité nationale, beaucoup plus évidente dans le cas de Dvořák ou Janáček, alors qu’il est profondément influencé par la culture et la musique allemandes et que la Bohème est une région de rencontre entre influence germanique et influence tchèque. Il souligne aussi les difficultés du livret original à se caler sur la musique, alors que la traduction allemande de Max Kalbeck (1893) s’y adapte beaucoup mieux dans une œuvre où l’esprit bavarois est si proche. Il est donc naturel et presque de droit qu’à Munich l’œuvre soit présentée dans sa traduction allemande (même si c'est aussi le cas dans la plupart des théâtres allemands).
Mais il reste que ce choix n’empêche évidemment pas Tomáš Hanus d’être par son origine, par sa culture, sa formation auprès de son maître Bělohlávek un des spécialistes de cette musique. La sienne est donc une interprétation profondément idiomatique. On peut être surpris qu’il aborde l’œuvre avec une vigueur, une vivacité presque primesautières, avec des tempi alertes, voire très rapides (trop rapides pour certains), exaltant la nature bouffe de l’œuvre, complétée par une symphonie de couleurs, déjà présente dans l’ouverture menée à un train d’enfer. Certes, les moments plus lyriques sont bien accompagnés, avec une vraie tendresse et le Bayerisches Staatsorchester fait merveille, avec des bois exceptionnels et un rythme marqué, sans jamais la moindre scorie, avec une vraie précision dans l’accompagnement des solistes et du chœur comme souvent excellent, dirigé par Sören Eckhoff.

La distribution réunie, de qualité, a l’homogénéité voulue, dominée par le Kezal particulièrement bien dessiné de Günther Groissböck, libéré pour un soir des répétitions de Bayreuth. Avec son costume de mâle blanc de village, complet blanc et chemise rouge ouverte, il joue les machos roublards avec une aisance réjouissante, sans jamais oublier la précision et la clarté du chant, émission parfaite, diction impeccable, expressivité et science de l’interprétation, il domine la distribution et remporte le succès qu’il mérite, d’autant qu’il n’est jamais une caricature totale : le mérite du travail de Bösch est de ne jamais détruire un personnage, mais de toujours lui donner sa part d’humanité.

Pavol Breslik, n’a pas une voix très volumineuse, mais par l’émission et la projection, par un art consommé du phrasé, il est toujours clair, toujours expressif, et affiche un chant particulièrement coloré, soigné, jamais en défaut. C’est toujours propre et jamais pâle. Il chante une musique qu’il connaît bien et qu’il pourrait chanter dans sa langue originale, mais il reste toujours très à l’aise, et vocalement et scéniquement, où il compose un Hans qui sait ce qu’il veut, débrouillard, vif, amoureux, très juvénile aussi, avec des moments de tendresse très marqués. C’est un rôle qui lui convient, à l’instar du Nemorino de L’Elisir d’amore, dans ce théâtre aussi mis en scène par Bösch, dont il est aussi l’interprète de référence.

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke est Wenzel. Ténor de caractère bien connu pour ses Mime, ou son Blaubart (Barbe-Bleue) à la Komische Oper de Berlin, voir son Hérode dans la très récente Salomé munichoise (voir notre compte rendu), il est ici l’interprète idéal d’un rôle dont David Bösch évacue les ridicules pour en faire un être conscient de ses faiblesses et de ses peurs, et en permanence mélancolique. C’est sans doute le personnage auquel Bösch s’intéresse le plus, victime de son entourage, et au départ sans initiative. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke sait rendre cette mélancolie, et cette solitude sans jamais forcer le trait. Il attire la pitié plus que le sarcasme. Sa voix, jamais forcée, toujours claire, toujours expressive rend bien cet univers aux limites (jamais passées) de la tragédie, et il s’affirme peu à peu, sans jamais être le ridicule que les autres voudraient y voir. Personnification très réussie parce que toujours sur le fil du rasoir.
Selene Zanetti était membre du studio de la Bayerische Staatsoper, elle est depuis septembre 2018 membre de la troupe et s’est trouvée deux mois avant la première remplaçante de Christiane Karg, initialement prévue, mais enceinte. Occasion rêvée pour cette jeune chanteuse de montrer son réel talent. Elle compose une Marie jeune et décidée, et pas du tout une jeune fille victime des volontés d’autrui (ses parents en l’occurrence). La voix est claire, bien projetée, elle sait colorer et montre un vrai sens de l’interprétation. Sans doute il faudrait travailler quelque peu l’aigu, à la limite, mais elle a des moments très affirmés et une voix homogène sur l’ensemble du spectre (avec de beaux graves), qui a réelle prise sur le public puis qu’elle remporte un vrai succès. Une jeune voix à suivre, qui a ainsi réussi son entrée « dans la cour des grands ».

Le reste de la distribution comme souvent à Munich est sans reproche avec les habituels comme Ulrich Reß en directeur de cirque un peu cheap ou Oğulcan Yılmaz, membre récent du Studio, mais la palme revient à l’Esmeralda danseuse chanteuse et funambule d’Anna El-Khashem qui livre là un vrai festival, y compris vocal avec un soprano puissant et expressif et une présence scénique vraiment marquée. À suivre.
Au total une production qui peut-être n’atteint pas l’éclatante réussite de L’Elisir d’amore, dont le succès ici ne se démentit pas, mais qui confirme David Bösch comme un des metteurs en scène les plus intéressants de sa génération, qui trompe ceux qui croient en un humour premier degré, mais qui raconte toujours quelque chose de plus cruel du monde d’aujourd’hui, un regard qui considère en permanence ce qu’il y a « derrière les yeux ».

