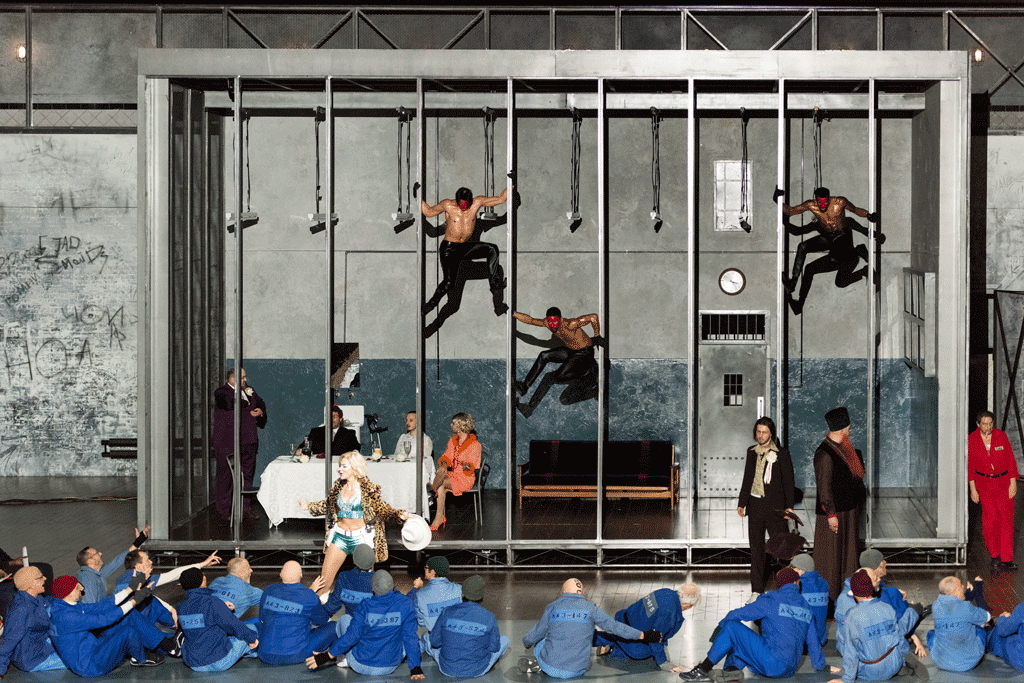Souvenirs

Se souvient-on qu’on a vu la production phare du festival de Salzbourg 1992 à Bastille en 2005, se souvient-on que cette production salzbourgeoise était dirigée en 1992 par Claudio Abbado, et se souvient-on que l’enregistrement exceptionnel de cette production existe au disque dans le coffret « 50 ans de Grosses Festspielhaus à Salzbourg » ?

Même si l’opéra de Leoš Janáček a bénéficié plus récemment de productions exceptionnelles qui ont semblé le remettre sous les feux de la rampe, à commencer par Chéreau-Boulez à Aix en 2007 (grâce à Stéphane Lissner, si décrié aujourd’hui par ceux qui l’adoraient), il est bon de souligner que les grands managers (Mortier…) avaient su repérer la force de cette œuvre singulière dans le paysage lyrique européen.Chéreau avait voulu exalter la puissance poétique du malheur fondamental des détenus, par des images inoubliables à la suffocante beauté, et Frank Castorf plus récemment (2018) a voulu à Munich développer l’idée donnée par le titre « Da la maison des morts », faisant du spectacle une allégorie des machines à mourir, Auschwitz en tête, une danse macabre somptueuse et souvent bouleversante.

Le parti pris de Warlikowski
Krzysztof Warlikowski a voulu sortir de l’esthétisme (Chéreau) et de la distanciation brechtienne (Castorf), pour proposer une vision d’un réalisme cru de ce que peut signifier aujourd’hui l’enfermement en prison, à l’heure, mais c’est un hasard sans doute, où les prisons françaises explosent et où l’enfermement semble être la seule solution, et où le danger des totalitarismes guette les vieilles démocraties.
Pour étayer son propos, Warlikowski en appelle à Michel Foucault, au discours lumineux sur la justice, qui ouvre le spectacle par une vidéo acérée ((on se reportera à Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, réédité dans la collection TEL, Gallimard 1993)). Comme souvent dans ses spectacles (on se souvient de L’année dernière à Marienbad qui ouvrait sa production de La femme sans ombre, ou d’Allemagne année Zéro qui ouvrait le troisième acte de son Parsifal parisien, sous les huées du public de fossiles qui peuple l’Opéra de Paris, et de bien d’autres exemples), Warlikowski inscrit la mise en scène sous les auspices d’images frappantes, Foucault secoue toujours le spectateur par ses analyses, et à cela s’ajoute l’interview déchirante d’un détenu, extraite de Gangster Backstage, documentaire sud-africain de Teboho Edkins qui ouvre les deuxième et troisième actes.
Foucault analyse la psychologie des juges et les raisons sociétales qui président à l’existence de la prison, où celui qui est enfermé compte moins que celui qui enferme, et les pensées d’un détenu, qui décrit en termes simples la vacuité de l’existence en milieu carcéral et la question de la mort, devenue la seule inconnue d’une vie qui a perdu son sens.
Quelques images, dont celle glaçante d’une chambre d’exécution létale avec ses sièges dans la cabine des spectateurs, et de quelques couloirs de prison, montrent l’aspect clinique des rituels d’enfermement et de mort aujourd’hui.

Et de fait, utilisant les décors de son habituelle décoratrice Małgorzata Szczęśniak avec ses refrains dont le lavabo, l’univers métallique alternant avec le béton et le carrelage, il construit un univers géométrique, sans âme, un univers clinique (renforcé par les éclairages de glace de Felice Ross), avec ses écrans et murs lisses, aussi lisses qu’anonymes : on pourrait être dans un gymnase avec son panier de basket, mais on est en prison, et ce sont ceux qui la peuplent qui la désignent : ce sont les hommes qui font la prison et non les espaces, gardiens comme prisonniers. Pas de laideur, pas de beauté, pas de caractère, ou plutôt le caractère disparate de l’humanité enfermée, dont la vision s’ouvre par l’entrée du prisonnier politique, riche, bourgeois, Alexandre Petrovitch Goriantchikov, et se clôt par sa libération, dont on déduit que l’expérience carcérale est devenue pour lui l’expérience d’une humanité dont il n’avait pas idée, une boue dans laquelle il y a de l’or comme dit la note d’intention de Christian Longchamp, reprenant une expression de Jean Genet.
« Chaque homme est une humanité, une histoire universelle » (Michelet)
Car c’est bien d’humanité qu’il est question. Et c’est bien à la fois le sujet de l’œuvre et l’axe porteur de la mise en scène, l’une des plus sensibles du metteur en scène polonais.
Et justement, faire de cet espace un espace d’aujourd’hui, c’est poser la question de l’humain face au totalitarisme d’aujourd’hui, réel ou rampant (et ça rampe beaucoup, en Europe et hors d’Europe), c’est poser la question de l’enfermement injuste, pour raisons politiques d’abord, mais aussi pour d’autres raisons (l’immigré clandestin, puni et enfermé parce qu’il est sans défense et sans pays : voilà un acte totalitaire habillé proprement puisqu’on enferme des innocents), c’est poser la question de la prison propre, de la mort propre, de la punition propre, c’est à dire de notre monde dont la novlangue transforme les réalités les plus sordides en périphrases neutres et clean.
Le sujet de l’œuvre, adossé au récit de Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts, est tout sauf narratif. C’est une succession d’apparitions de personnages qui racontent leur « être en prison », les motifs qui les y ont portés, leurs rêves, leurs souvenirs. Il n’y a de solution de continuité que dans la présence de Goriantchikov (Sir Willard White), discret fil rouge, dont on devine l’influence progressive sur le groupe, même s’il chante assez peu. Warlikowski sans insister mais jetant çà et là de petits signes, en fait celui qui met en scène les pantomimes centrales, outre à être celui qui apprend à lire au jeune Alieïa (Pascal Charbonneau, déchirant) et donc l’artisan d’un retour à l’humain.
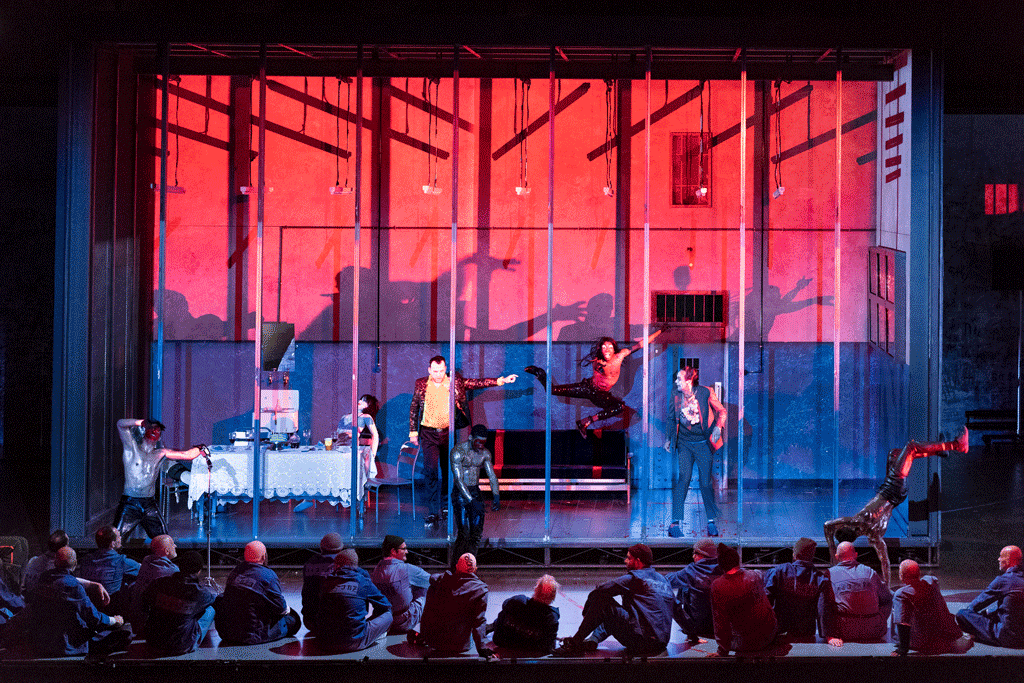
La pantomime est en effet non seulement le centre névralgique de l’opéra, mais aussi celle qui permet à Warlikowski de prendre la distance avec la souffrance, d’en faire un « objet d’art » transactionnel, cathartique, où la souffrance se sublime en art et en spectacle presque shakespearien. C’est ainsi qu’au-delà de la pantomime présentée : jeu de Kedril et de Don Juan puis la belle meunière, d’autres récits sont objets de pantomime, comme le récit final de Chichkov (magnifique Karoly Szemeredy) et de Louka/Filka (un Štefan Margita toujours aussi intense), où le sang coule toujours abondamment, mais sous forme de paillettes rouges…

La pantomime permet de tenir à distance l’émotion brute, et ainsi de faire accéder à l’universel ces récits si personnels, mais aussi de faire voir l’invisible dans ce monde d’hommes à savoir la femme. La seule femme présente, réelle, qu’on voit en chair et en image, sur l’écran TV au loin c’est la prostituée (Natasha Petrinsky). Dans ce monde des déchus, une autre figure de la déchéance, mais d’une déchéance faussement joyeuse.
Cependant la femme est omniprésente dans les récits, la mère ou la sœur (chez Alieïa) mais surtout la femme aimée, ou la femme adultère, souvent à l’origine du destin de ces hommes : elle est figurée comme un objet, une « presque » poupée gonflable, des mannequins désarticulés, comme dans la pantomime de Don Juan, c’est à dire une image chosifiée, déformée, lointaine, dégradée, comme un miroir de ces êtres dégradés dans cette existence recluse, que sont les prisonniers pour qui le monde extérieur n’est plus que fantasme, rêve ou cauchemar, qui a perdu toute réalité, voire tout sens.
Dans cet ensemble, l’idée de faire la « mascotte » des prisonniers, l’aigle, un jeune basketteur blessé ensuite au cours d’une rixe est sans doute l’élément le plus original de la mise en scène. Chez Chéreau c’était une sorte de jouet mécanique qu’on allait essayer de faire voler, chez Castorf, une femme oiseau tel l’Oiseau (Waldvogel) de sa mise en scène de Siegfried à Bayreuth. L’aigle est évidemment symbole de liberté, mais aussi de force : il est blessé comme Alieïa et d’autres avec toute la force symbolique qu’il porte ; il accompagne le groupe dans son fauteuil roulant alors qu’il ouvrait l’œuvre avec vivacité virevoltante, en dribblant et plaçant des paniers successifs.
On peut évidemment s’interroger sur ce symbole. Il est l’expression d’une liberté du corps dans un espace contraint, à l’intérieur de la contrainte, il y a toujours un espace pour la liberté, mais aussi d’un mouvement perpétuel qui se dissimule derrière le panier qu’on va marquer, et qui fermera l’œuvre, comme la reprise d’un quotidien éternel et d’une clôture sans fin.
La fin de l’œuvre, où les personnages retournent à leur vie sous la contrainte des gardes et où l’aigle « revole » peut être lue comme la promesse d’un futur sombre ou plus ouvert, selon les lectures. Warlikowski pencherait peut-être vers l’optimisme : la manière dont « l’aigle » se lève de son fauteuil roulant a quelque chose de la parabole du paralytique (« lève-toi et marche ») et tient du miracle christique.
La question de la compassion
Que la fin laisse l’espoir ou non, est-ce réellement l’enjeu de l’œuvre ? Ce que nous dit ce travail c’est d’abord une extraordinaire peinture des solitudes. Dans ce monde collectif, où tous sont sous les yeux de tous, ce qui émerge comme une évidence, c’est la concomitance des solitudes, et un dialogue par intermittence, comme seul élément faisant quelquefois (mais pas toujours) humanité, tant il peut se muer en violence, voire en meurtre. Quand un dialogue s’instaure comme entre Alieïa et Goriantchikov, c’est insupportable à d’autres solitudes et Alieïa est blessé.

Ce regard sur l’humanité est acéré, objectivé, mais en même temps compassionnel. C’est bien la compassion qui se lit dans tout ce travail de Warlikowski, d’où la parabole christique finale, d’où aussi le rôle discret, mais permanent d’un Goriantchikov qui du fait même qu’il n’est là que pour ses idées, qu’il n’a commis aucun crime, sinon pensé ou exprimé une opinion, peut à la fois agir sur le groupe de ces êtres déshérités, les regarder, les raconter, mais aussi et surtout vivre avec eux et donc souffrir avec eux : « durch Mitleid wissend » ((Parsifal : « Durch Mitleid wissend, der reine Tor »)), Mit-Leid, souffrir avec, cum-pati en latin, d’où la compassion. Ne peut agir et comprendre que celui qui souffre avec, qui éprouve au sens propre la Mit-Leid, c’est à dire la compassion, Compatir n’est pas une attitude charitable, c’est à la limite une attitude politique, pour compatir, il faut connaître la souffrance et donc la comprendre.
Ainsi ce récit est-il actuel et inactuel. La lecture de Dostoïevski est souvent pour les grands metteurs en scène une source d’inspiration et une clef pour la lecture du monde d’aujourd’hui, voir ce qu’en avait fait jadis Luca Ronconi et naguère Frank Castorf qui a mis sur le théâtre la plupart des grands romans. Il y a chez Dostoïevski une vision du monde sans concession dont la grille s’applique à chaque période de l’histoire récente : comment ne pas lier l’histoire de la Katorga tsariste (la « maison des morts ») celle du Goulag, des camps nazis, voire de Guantanamo ou des prisons irakiennes ou syriennes.
Le travail de Warlikowski exalte cette terrible modernité, en introduisant aussi dans cette prison ce qu’on appelle la diversité : les danseurs de Hip Hop, source de vie et de liberté des corps , tout comme l’aigle-basketteur, Goriantchikov sont noirs, issus de toutes classes sociales (Goriantchikov est de toute évidence de la classe des intellectuels – dans le livret d’origine c’est un noble). La prison est un creuset, un creuset de la mort disait Castorf dans sa production munichoise – de la mort des individus mais surtout de la mort de toute société qui génère ces lieux, ici c’est un creuset de l’attente collective d’âmes solitaires (chez Chéreau aussi d’ailleurs, mais dans un espace presque abstrait non dépourvu d’une certaine beauté, une attente sans objet, qui génère l’ennui, et donc le ressassement, le repli, et pour finir la mort de l’Esprit.
La musique d’un « électron libre »
L’œuvre de Leoš Janáček peut surprendre : elle surprend par sa structure, sans narration, une succession de monologues, de litanies des âmes perdues, une succession de récits, de bulles où entendre la parole est déterminante car c’est ce qui reste quand tout a disparu. Une fois de plus s’appliquent ici les théories wagnériennes développées par les successeurs (chez Berg, entre autres) où la partition suit le rythme de la parole, en suit la couleur, le son et les inflexions (Sprachmelodie disent les allemands). Évidemment, le spectateur qui ignore la langue tchèque ne peut apprécier totalement ce travail de ciselure verbale et musicale, et cette musique est faite de sauts et gambades qui vont de l’éclat rutilant des premières notes, aux phrases et mélodies pucciniennes et aux passages proches de l’atonalité, et tous ces moments sont appuyés sur les mots, tous valorisant l’expressivité, la clarté du dialogue, les variations des couleurs, donnant à l’ensemble une grande complexité musicale quelquefois proche du Lied.
Ce dernier opéra de Janáček est sans doute le plus complexe et le moins musicalement immédiat. Boulez décrivait cette musique comme « primitive au meilleur sens du terme », il la comparait à la manière d’un Fernand Léger : il y a quelque chose de rude, de rugueux qui évidemment colle avec le sujet, qui n’est pas sans faire penser aussi à l’ambiance et la couleur du Wozzeck de Berg dont Janáček se proclamait le défenseur au moment même où il composait son opéra.
Cela exige de la part des chanteurs un soin tout particulier à l’expression, à la diction, à la clarté des mots, et une lecture très analytique de la part du chef (comme on le ferait habituellement avec du Schönberg ou du Hindemith) , mais en gardant un œil à la mélodie (comme chez Puccini, et on sait l’influence de Puccini sur Janáček dans ses œuvres tardives) , ce qui rend la musique de Janáček très singulière, surprenante, « ailleurs » en quelque sorte, et qui fait de cet « électron libre » comme on a dit un des phares de la musique du XXe siècle.
Une distribution sans faiblesses
La distribution de l’Opéra de Lyon rend pleinement justice à l’œuvre. Il n’y a pas à proprement parler de rôle principal si l’on sent tient au poids relatif des interventions de chaque personnage. En ce sens, c’est un opéra choral (rappelons que Janáček est aussi l’auteur de la stupéfiante Messe Glagolitique antérieure de 2 ans environ) au sens où les interventions se succèdent, traçant une ambiance, une couleur et que chaque personnage est alors principal : aux chanteurs de dessiner la singularité de chacun tout en contribuant à construire une globalité.
C’est aussi un opéra difficile à distribuer à cause des très nombreux personnages et de leur importance relative. Il y a peu de personnages secondaires, et peut être des personnages principaux qui nous frappent plus par leur profil que par la longueur de leurs interventions. Saluons alors Ladislav Elgr au phrasé impeccable dans le doux Skouratov qui évoque son amour malheureux pour la jeune Luisa, Aleš Jenis puissant et plein de relief dans le Don Juan de la Pantomime. La forme de la pantomime permet aux personnalités de s’afficher, et la mise en scène, plaçant des barreaux devant la scène, montre l’ambiguïté du jeu théâtral et les limites de l’illusion. La question de la pantomime et de l’intermède, avec ses origines baroques, son utilisation dans certains opéras du XIXe (on pense à Tchaïkovski) montre en même temps comment Janáček utilise des formes du passé en les insérant de manière fluide dans une trame peu traditionnelle, en faisant même le pivot du deuxième acte. De la même manière, il faut citer John Graham-Hall dans Kedril, la valet de Don Juan, vif, expressif et Dmitry Golovnin en Chapkine bien planté, très expressif et à la voix puissante. Tous sont à rappeler d’ailleurs, Alexander Gelah, Grégoire Mour, Jeffrey Lloyd-Roberts,

Natascha Petrinsky, la seule femme, en prostituée proche de « valette » de cirque, qu’on croirait sortie de la « Menagerie » des premières mesures de la Lulu de Berg.
On remarque évidemment le commandant brutal et un peu lâche (dans ses « excuses » finales) d’Alexander Vassilev, le petit forçat d’Ivan Ludlow au beau phrasé qui blesse Alieïa, tous vraiment engagés. Une note particulière pour Graham Clark, le vieillard à la voix incroyablement claire et un peu tonitruante pour le rôle (on se souvient la sublime figure murmurante d’un Heinz Zednik bouleversant chez Chéreau en 2007), qu’on aimerait plus fatigué – et un peu plus juste- mais Graham Clark a laissé tellement de grands souvenirs à Bayreuth et ailleurs qu’on pardonne et on se réjouit de l’avoir revu.

Ce qui nous ont marqués sont d’abord Nicky Spence, le grand forçat qui va blesser l’aigle (le jeune basketteur), une figure à la présence scénique forte, un peu la brute épaisse à la voix de ténor bien posée, aiguisée, puissante.
Autre ténor, familier du rôle de Louka/Filka, Stefan Margita qui a porté le rôle sur toutes les scènes du monde, imposant personnage à double identité, violent, déchiré, inquiétant aussi avec un phrasé et une diction exemplaires – il est slovaque et cela aide, évidemment, pour donner couleur et poids à la parole. Comme toujours, une grande composition pour ce rôle de caractère.
L’abondance des voix de ténor (la moitié de la distribution) donne d’ailleurs une couleur particulière à cette colonie d’hommes à la voix claire, et parmi les ténors, le rôle le plus émouvant, le plus déchirant de l’ensemble, Alieïa qu’on confie quelquefois à un soprano (choix discutable que Warlikowski tranche en habillant son personnage d’une robe de mariée blanche, symbole de pureté un peu ambiguë (la question du genre est discrètement posée) que Pascal Charbonneau habite jusqu’à en faire une figure déchirante. Charbonneau est un habitué du répertoire baroque et on sent cette familiarité dans la manière de phraser, et de colorer avec attention chaque mot, mais le personnage de jeune animal blessé, tout en fragilité, une sorte d’ange perdu (son costume l’indique un peu) dans un monde de brutes, est vraiment bouleversant. Très grande interprétation.
Enfin Sir Willard White, en Goriantchikov à la fois discret, à part, distant, et terriblement humain dans sa manière de chanter, de moduler le texte en imposant une grande tendresse et une douceur presque structurelle montre aussi à quel degré de maîtrise est arrivé ce grand chanteur qu’on a vu dans tant de rôles (dont Wotan…). La voix légèrement voilée, un peu vieillie, qui a perdu son émail, mais qui s’impose par sa science de la projection, convient parfaitement au personnage, et la tenue en scène, jamais histrionique, jamais au premier plan, au regard toujours humain, est exemplaire.
Une direction raffinée, des masses exemplaires
Belle prestation du chœur de l’Opéra, toujours vigoureux, dirigé par Christoph Heil.
L’orchestre de l’Opéra de Lyon dirigé par Alejo Pérez, l’un des chefs qui retient l’attention aujourd’hui dans ce type de répertoire (il est directeur musical de L’Opéra des Flandres, succédant à Dmitry Jurowski) a presque réussi à arrondir le son plutôt sec de la fosse lyonnaise. Jamais tonitruant, moins rutilant qu’attendu surtout au début, Alejo Pérez propose une direction plutôt sombre, accompagnant les voix avec une précision rare, souvent discrète et ne couvrant jamais le plateau. Une direction claire, vive, nuancée, qui laisse entendre toute la complexité de la partition avec des moments particulièrement lyriques, notamment les interludes orchestraux et avec une grande fluidité, notamment dans les passages d’un style à l’autre, d’une couleur à l’autre, d’un mode à l’autre. Il arrive à donner une vraie cohérence dans une musique qui pourrait paraître quelquefois disparate, voire un peu rugueuse, on a ici une vision assez raffinée, avec un orchestre de l’Opéra de Lyon au sommet.
Encore une production exemplaire à l’actif de la plus stimulante des scènes françaises.