
Créé en 1840 à l’Opéra de Paris, pendant la période où y triomphait le Grand-Opéra, La Favorite s’insère dans l’histoire du genre. Il est clair que Donizetti se devait de servir ce qu’elle attendait à celle que Verdi appellerait la Grande Boutique. Somptuosité, chœurs impressionnants, long ballet, et arrière fond historique sont donc au rendez-vous.
Mais si le Grand-Opéra est un grand spectacle, il n’est pas dit qu’il soit musicalement la grosse machine bruyante qu’on imagine. Quand on considère la fin du Grand-Opéra, qui s’appelle à Paris Verdi (Les Vêpres Siciliennes ou Don Carlos), Gounod (Faust), ou Berlioz (Les Troyens), personne ne songerait à donner à ces musiques les qualificatifs de pesantes ou pompeuses, au contraire, on s’exalte à en relever tous les raffinements, les détails sublimes de partitions transparentes, ou, quand l’œuvre est moins réussie, des fulgurances qui lui font tenir son rang au répertoire d’aujourd’hui (Les Vêpres siciliennes par exemple ou le Faust de Gounod au destin d’ailleurs autrement fortuné).
Ces titres ne sont pas les exemples qui viennent quand on évoque le Grand-Opéra, ils en procèdent pourtant, avec tous les éléments du genre. .
Si l’on considère à rebours les débuts, que ce soit Auber (La Muette de Portici) ou surtout Rossini (Guillaume Tell, bien sûr, mais aussi Moïse et Pharaon), il ne viendrait à personne non plus de remettre en cause la qualité de ces musiques et leur transparence, même dans les scènes à grand spectacle.
Alors on attaque le Grand ‑Opéra par ce qu’on croiit être son point faible, Meyerbeer, même si on l’a joué sans discontinuer pendant un siècle à l’Opéra de Paris comme un must, et puis il a disparu et son œuvre a été injustement vilipendée comme musique de foire ou peu s’en faut, et sans génie, comme on l’entendait systématiquement dans les années 1970, même si les grands enregistrements de ses œuvres parisiennes principales sont sortis à cette époque. C’est depuis une ou deux décennies que ce répertoire retrouve la faveur des scènes, avec un certain succès, mais sans emporter les foules ni se réinstaller durablement au répertoire..
Donizetti écrit La Favorite à l’époque des triomphes de Meyerbeer (Robert le Diable est créé en 1831 Les Huguenots en 1836,) et Halévy (La Juive en 1835, année où Donizetti est invité à Paris par Rossini …et deux ans après le Benvenuto Cellini de Berlioz (un échec…).
Son second séjour, motivé par la dépression consécutive à la mort de sa femmes et des déceptions napolitaines, sera marqué par des productions en français qui vont pour certaines rester au répertoire, comme La Fille du régiment, ou La Favorite, moins Les Martyrs (resucée de Poliuto) et encore moins Dom Sebastien roi de Portugal seul véritable Grand-Opéra revendiqué, écrit par Eugène Scribe.
Évidemment très attentif à saisir les modes parisiennes, the place to be à l’époque, Donizetti compose La Favorite dans un style qui ressemble au Grand-Opéra, sans en avoir la qualification, mais quelques couleurs, avec cependant des rappels de style italien (récitatif, aria, cabalette). D’ailleurs, aux librettistes Alphonse Royer et Gustave Vaëz s’ajoute (entre crochets) le nom d’Eugène Scribe à lui seul une fabrique industrielle du Grand-Opéra. C’est bien qu’on tourne autour du genre…
Or aussi bien Donizetti que Meyerbeer sont des admirateurs éperdus de Rossini, toute la période italienne de Meyerbeer en témoigne, et les premières œuvres de Donizetti sont des calques rossiniens. Tous les deux savent parfaitement ce qu’est la manière de Rossini, son écriture musicale, sa science des rythmes, des crescendos, de l’orchestration. Et même lorsqu’ils écrivent de Grands Opéras ou qu’ils s’en rapprochent, ils se souviennent de l’exigence de transparence, de la manière de calculer les effets, c’est à dire qu’ils écrivent d’une main qui sans aucunement imiter Rossini, tient fermement compte de ce qu’il a donné à la musique et qu’on oublie quelquefois.
Cette transparence, cette élégance et cette capacité technique à écrire des musiques spectaculaires, en leur gardant une orchestration raffinée (on retrouvera ce trait chez Verdi), on ne les retrouve pas toujours dans ce qu’on a entendu à Bergamo, même si c’est l’exécution la plus complète possible (Ballet et cabalette du duo Leonor/Fernand) dans l’édition critique de Rebecca Harris-Warrick publiée chez Ricordi.
Certes, tout est carré, le son est charnu, et la prestation orchestrale sous la direction de Riccardo Frizza, directeur musical du Festival et Donizettien d’origine contrôlée est parfaitement en place.
Loin de nous l’idée de remettre en cause une exécution qui reste de très bonne facture, et attentive à rendre avec beaucoup de relief des musiques qu’on n'avait jamais entendues (le ballet…), ni des moments impressionnants, notamment les ensembles et concertati, avec un excellent chœur Donizetti Opera renforcé par celui de l’Accademia della Scala, préparé et dirigé par Salvo Sgrò.
Certains passages sont vraiment bien dominés (l’ouverture somptueuse et sombre), avec un soin particulier au rendu des couleurs. À d’autres moments en revanche, la tension dramatique se transforme en masse orchestrale un peu trop volumineuse.
Ce qui m’a semblé en effet problématique dans cette exécution, c’est de ne pas retrouver la transparence ni les raffinements attendus, comme si tirer vers le Grand-Opéra contraignait à grossir les effets et à trouver au rendez-vous de cette version originale complète un orchestre souvent trop fort, qui couvre parfois les solistes, notamment dans les ensembles, et qui reste assez opaque, dans la mesure où l’on n’entend pas ce qui fait la qualité de l’orchestration donizettienne ni son élégance, mais les caractères massifs et à mon avis erronés de ce qu’on croit être le Grand-Opéra (dont La Favorite n’a pas tous les caractères). Malgré de beaux moments, c’est alors lourd, c’est fort et ça finit par être étouffant.
Évidemment, une telle approche ne favorise pas les voix, qui doivent faire des efforts supplémentaires pour surmonter les vagues sonores de l’orchestre, pour surfer sur le son et ne pas s’y enfoncer. Il faut reconnaître qu’elles y arrivent pour l’essentiel avec pour quelques-uns un peu de gêne aux entournures. Pas pour le joli ténor de Edoardo Milletti, un Don Gasoar qui laisse espérer un futur intéressant. En revanche Caterina Di Tonno en Inès a de sérieuses difficultés à dominer la masse sonore, la voix est très légère et quelquefois à la limite de l’audible. Elle peine dans son air « Rayons dorés…» accompagnée du chœur

Le Balthazar de Evgeny Stavinsky souffre également quelque peu de cette situation, la voix est bien posée, la diction française satisfaisante, à l’instar de l’ensemble de la distribution, La voix est moins sombre qu’à l’accoutumée, la projection problématique souffre un peu du volume orchestral, mais l’ensemble de la prestation reste honorable.
Particulièrement bien profilé le personnage du Roi incarné par Floiran Sempey, dont la voix forte, pleine d’autorité, particulièrement large campe certes une sorte de « mâle blanc dominant » comme on dit aujourd’hui, mais qui laisse aussi entrevoir d’autres replis psychologiques moins caricaturaux. Inutile de souligner la diction parfaite et un phrasé qui sait parfaitement colorer et donner profondeur , comme dans l’exécution modèle de son air « Léonor, viens, j’abandonne » ponctué par une cabalette brillante.

On ne présente plus Javier Camarena, spécialiste de ce répertoire, qui a montré en Fernand une voix d’une douceur et d’un velouté rares, avec des aigus incroyablement clairs et brillants. c’est sans conteste L’aigu qui continue d’étonner, par la souplesse de la voix, sa facilité et ce timbre particulièrement lumineux. L’engagement du ténor tout au long de la très longue représentation (près de 4 heures), la tension inhérente à la partition et quelquefois, au volume orchestral causent un peu de fatigue notamment au dernier acte, avec des ombres pas très propres dans le registre central, malgré une exécution très émouvante de « Ange si pur ». Les menues difficultés n’effacent cependant pas la performance solaire de ce Fernand qui reste exceptionnel.

Enfin la Leonor d’Annalisa Stroppa pour qui c’est une prise de rôle frappe par une vraie présence scénique, souvent émouvante, toujours belle et au port particulièrement noble qui contraste avec l’image que la « maîtresse du roi » impose dans le livret . Stroppa sait toujours garder à son personnage une dignité affirmée. Vocalement, la voix est large, la diction française sinon parfaite, du moins acceptable, avec une belle respiration et une manière de chanter sur le souffle particulièrement séduisante. Son « Ô mon Fernand » à la couleur mélancolique est particulièrement bien soutenu et émouvant. L’assise de la voix et l’aigu large laisse imaginer une future Eboli. Une voix peut-être pas exceptionnelle, mais solide, large, expressive, qui respire l’intelligence. Très belle prestation.
Incontestablement, la représentation tient la route musicalement, sans néanmoins être la révélation totale escomptée, malgré une distribution valeureuse. Mais la direction musicale a sans doute péché par excès en confondant trop souvent sens dramatique et volume, sans toujours fouiller dans le sens du raffinement.

Raffinée, la mise en scène ne l’est pas vraiment non plus. Valentina Carrasco a voulu tenir une ligne cohérente, ce qui est louable, qui concentre le sens autour de la défaite des femmes et de leur objectivation, éléments qui ont un poids réel dans le livret, mais sans élargir le propos à d’autres considération sinon en les effleurant quelquefois. Au service du projet, un décor très démonstratif signé Carles Berga et Peter Van Praet (qui a créé également les éclairages assez réussis d’ailleurs).
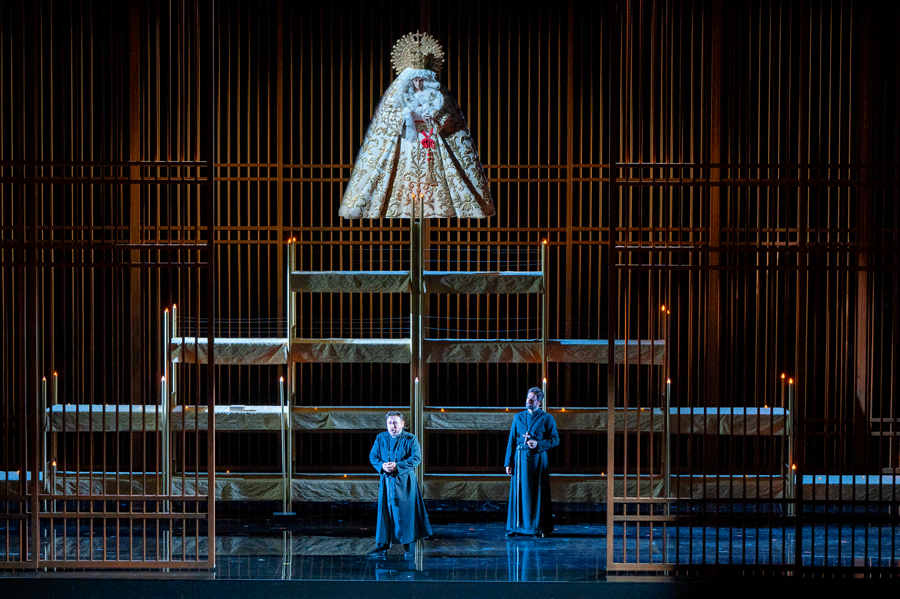
Décors démonstratifs signifie d’abord envahissants , tant le plateau est occupé par ces constructions de lits superposés, variation sur des lits gigogne, qui composent tantôt un amphithéâtre (le ballet) tantôt une pyramide (l’église) dominée par une Vierge monumentale à la manière des Madones baroques des églises ou des processions espagnoles ou siciliennes (dont l’origine est évidemment ibérique)
Exubérant aussi le dais surmonté d’une croix bien visible qui abrite au moment du mariage de Fernand et Leonor le lit nuptial, non dépourvu d’ironie d’ailleurs (c’est si rare dans la mise en scène qu’on le remarque).

Autres éléments démonstratifs, les grilles qui semblent enfermer les personnages dans leur destin, grilles qui figurent l’enfermement initial du monastère pour Fernand, mais aussi l’enfermement de Leonor : ce sont des grilles à la fois réelles et mentales…
Autre tableau, le palais royal de l’Alcazar, tout en voiles avec quelques palmiers, le tout surmonté d’un lustre monumental, figure luxe, mollesse, calme et un peu de volupté.
Ces décors réduisent l’espace scénique, empêchant les mouvements (le chœur est souvent fixe), et une certaine respiration. À l’étouffement qu’on ressent en écoutant quelquefois la musique correspond un étouffement scénique un peu lassant.
Ces décors de lits superposés, recouverts de draps puis découverts et laissant apparaitre des femmes vieillissantes prend son sens au moment du ballet.
Le ballet, construit comme une pantomime, est conçu comme illustration de l’idée dominante et quasiment unique de cette histoire : la femme consommée est ensuite laissée, entreposée, enfermée dans une sorte de harem-dortoir où on lui permet seulement de vieillir. La Pantomime est claire : les femmes sont vieillies, elles sont enfermées comme les ex-femmes d’un quelconque Barbe-Bleue, c’est le destin des favorites de finir dans cet entrepôt des ex-. Les lits superposés, comme restes piteux de leur champ de bataille favori, mais qui sert aussi bien à évoquer la communauté de l’île de Leon où Leonor rencontre Fernand, construit aussi le décor des églises, comme si l’Église au fond s’en accommodait, ou comme si elle construisait son pouvoir sur les faiblesses des rois. Tout cela n’est pas mal vu, et l’idée de transformer le ballet en une chorégraphie mimée par ces femmes (des femmes de la population de la ville de Bergame) est sans doute plus parlante qu’un ballet à tutus.
De cette communauté, la favorite en titre arbore un habit pourpre, presque sacral, qui est signe de son pouvoir éphémère, (costumes de Silvia Aymonino, assez indifférents et assez laids pour les hommes) on l’identifie comme celle qui vit, au milieu de ce harem de mortes en sursis, mais cela annonce en même temps son destin et la finitude de la gloire quand ses attributs se faneront.
Il y a comme un rituel sous-jacent installé par la mise en scène, qui est celui de bien des monarchies du passé (?) et que Fernand va traverser comme le chien du jeu de quilles ou l’éléphant du magasin de porcelaines. Dans un monde aussi régulé et normalisé (même si la normalité est déviance), Fernand tranche par sa rectitude et sa candeur. Novice, il tombe amoureux et quitte le noviciat en en avouant la cause à son supérieur, il va ensuite faire la guerre pour le roi (pour l’éloigner ?), puis revenir vainqueur et crouler sous les honneurs, dont celui d’épouser celle qu’il aime. Mais il est objet d’une manœuvre qui consiste à donner à la favorite en titre un statut, qui permet au roi d’échapper à l’excommunication : l’Église se contentera des apparences et chacun sauvera la face.

Fernand, risée de la Cour, devient cocu officiel du roi avant même de consommer son mariage, dont Balthazar intervenant au cœur de la cérémonie révèle la véritable nature. Fernand, héros romantique, plein de sens de l’honneur, renonce à ses titres, à l’épouse indigne, et retourne au couvent.
Ce qu’il ignore, c’est que Leonor a cherché à l’avertir de sa situation réelle et de la relation qu’elle entretient avec le roi, en dépit de son amour pour lui, et que son courrier-aveu a été intercepté.
On le voit, l’histoire est assez sordide et jette un regard sans complaisance sur les pratiques de cour et les pratiques monarchiques, ce qui dans la France postrévolutionnaire de la monarchie de Juillet pouvait passer, mais sans doute pas encore ailleurs, et sur une Église toute puissante dont le souci est de préserver son pouvoir sur les rois, ce qui dans cette même France pouvait aussi être accepté mais pas encore ailleurs.
Ces deux données se lisent à la fois dans le personnage peu sympathique et cynique d’Alphonse, et dans celui de Balthazar, messager d’un Pape soucieux de garder tout son pouvoir sur les monarques, et qui révèle à Fernand son ancien novice le déshonneur dont il est l’objet, confirmant ainsi sa prédiction lorsque Fernand avait quitté le noviciat. Des deux côtés, Fernand est l’objet des trames des puissants qui le dépassent.
Valentina Carrasco ne s’embarrasse pas trop de toutes ces subtilités, les personnages sont plutôt tout d’une pièce et elle ne cherche pas à leur donner une épaisseur qui aille au-delà de l’apparence. La seule pour laquelle ce serait possible, c’est Leonor parce que le personnage et le symbole qu’elle représente l’intéresse mais elle ne va pas au-delà de la superficie non plus, même si Annalisa Stroppa, par ses qualités individuelles d’actrice réussit quelquefois à émouvoir.
A ce titre, si les trois premiers actes entre ballet, scènes de foule et cérémonies occupent l’espace et masquent les vides, le quatrième acte, qui est essentiellement un long duo, n’est pas vraiment traité : il n’y a plus de mise en scène, les personnages sont livrés à eux-mêmes et on finit par s’ennuyer. Pourtant, un metteur en scène qui s’intéresse tant soit peu au texte aurait pu en révéler l’ironie, la distance, voire l’absurdité : un Fernand qui à l’arrivée de Leonor mourante lui jette au visage :
« Va-t-en d’ici ! De cet asile tu trouvlerais la pureté. Laisse la mort froide et tranquille faire son office en liberté »
ou plus simplement en toute charité chrétienne « Va‑t’en mourir ailleurs ! » .
dont la violence des paroles, après une romance « Ange si pur » où l’oubli n’ pas fait son œuvre, montre les déchirements et aussi le discours préfabriqué de celui qui vient de prononcer ses vœux.

Mais peu après avoir entendu la supplique de Leonor et sa voix implorante, il retrouve sa flamme enfouie dans les brqaises encore chaudes et cette fois, à l’inverse, lui propose de fuir ensemble (on croirait Manon et Des Grieux à Saint Sulpice) , jette sa croix, et alors qu’elle lui rappelle ses vœux , et qu’elle est mourante. Il y a dans le texte des éléments qu’un metteur en scène un peu affuté aurait sans doute exploité mais… rien ici que les platitudes d’une mise en scène ultra convenue.
Quant à la phrase finale de Balthazar, « La novice est mort », elle est là pour sauver les apparences (Leonor se fait passer pour un jeune novice mourant) tandis que celle de Fernand, « et vous prierez pour moi demain » annonce probablement un futur suicide pas plus prisé par l’Église qui résout assez commodément tous les drames qu’elle a provoqués.
Ces aspects anticléricaux, assez marqués dans l’œuvre signes d’une morale rigide et hypocrite qui n’est pas si éloignée d’ailleurs de la morale bourgeoise de l’époque plus laïque, mais pas moins hypocrite. Ces aspects-là sont oubliés, ou à peine effleurés, alors qu’ils sont à mon avis essentiels. Ainsi, la mise en scène à sens unique et sans grande subtilité ne rend que très partiellement justice à l’œuvre en évitant de rentrer dans tout ce qui pourrait ressembler à un peu plus de profondeur. C’est décevant, et un peu prétentieux.
C’était évidemment une excellente idée que d’ouvrir le Festival par un opéra connu dans sa version complète et une édition critique nouvelle. Malheureusement les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs. On aurait aimé plus d’épaisseur, moins de lourdeur et moins de démonstration fastueuse et un peu inutile, même si l’idée de faire du ballet (Chorégraphie de Massimiano Volpini)la clé de lecture de l’ensemble n’est pas si mauvaise ; elle est même la seule véritable idée du spectacle. Autrement plus stimulante et riche d’idées avait été en 2019 la mise en scène de Francesco Micheli de L’Ange de Nisida qui raconte la même histoire, avec déjà un magnifique Florian Sempey.
Malgré des chanteurs de grand talent c’est dans l’ensemble une petite déception musicale et une grosse déception scénique.

