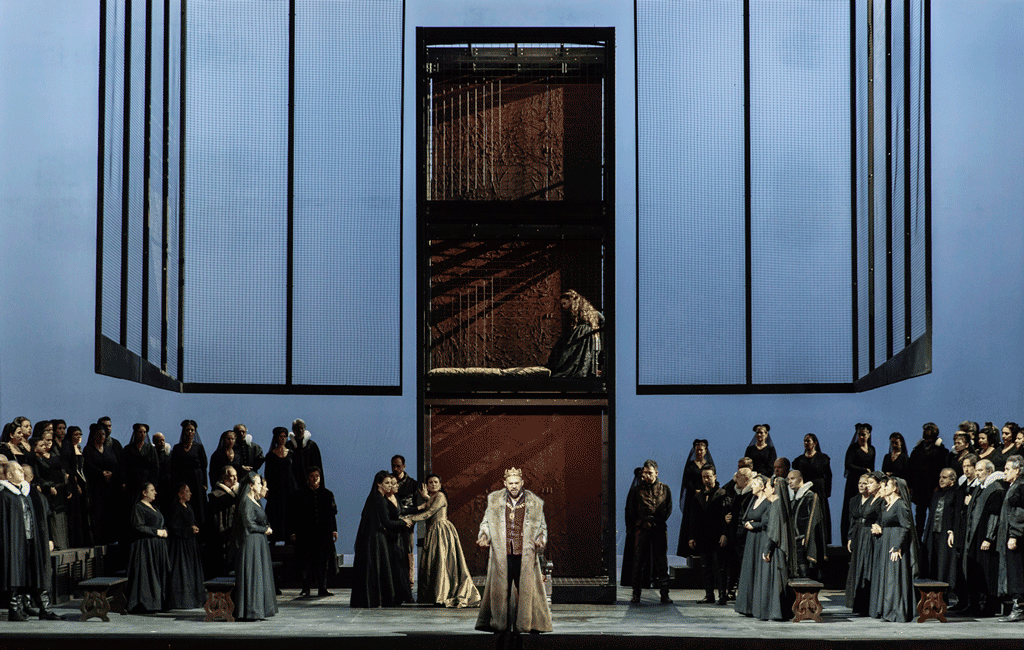Deux ans après Maria Stuarda, l’Opéra de Rome poursuit sa trilogie des Tudor avec Anna Bolena. Plongée dans la pénombre et l’austérité, loin des fastes du royaume d’Angleterre, la cour d’Henri VIII avec ses lumières blafardes signées Enrico Bagnoli et ses hautes parois grillagées prend rapidement les allures d’un cachot, le lit d’Anna Bolena se transformant en prison au moment où celle-ci est accusée d’adultère.

Enfermée dans la Tour de Londres, symbolisée ici par une cage à plusieurs niveaux dans laquelle elle attend son jugement et sa décapitation, la seconde épouse d’Henri VIII est ainsi réduite à néant, apprenant de la bouche de sa demoiselle d’honneur et rivale, la trahison de cette dernière, mais lui accordant dans un ultime sursaut son pardon et par là même sa grandeur d’âme.
Le spectacle, plutôt conventionnel, n’évite pas les facilités et traîne parfois en longueur, faute d’une proposition scénique suffisamment puissante. Comme pour Maria Stuarda, Andrea De Rosa insiste sur la froideur qui existe entre les personnages dont les relations qu'elles soient d’ordre politique, conflictuel, ou amoureux engendrent un certain statisme qui finit par émousser l'attention sur le long terme. Tapie dans l’ombre la présence des courtisans est plutôt bien gérée, mais les choses se gâtent à partir du second acte au cours duquel Bolena erre sans raison entre ses dames de compagnie et sa « cage-prison », pour s’y réfugier finalement et mourir sous les yeux du nouveau couple royal, assis comme au théâtre, aux premières loges, pour mieux suivre l’exécution. Était-il vraiment utile enfin de parer cette reine déchue et dépouillée de tous ses biens, d’une iconoclaste paire de gants rouges façon Gilda ? La réponse est non.
La présence en fosse de Riccardo Frizza n’arrange rien.. Incapable de soutenir un tempo sans bousculer la ligne ou distordre la mélodie, le chef donne le sentiment de diriger une œuvre au mieux banale, au pire sans intérêt, qui manque cruellement de souffle, de tension et ne ménage que de rares moments saillants.

Les interprètes ballotés, soumis à rude épreuve, ont du mérite pour garder la tête haute et ne pas se laisser submerger ; en premier lieu Carmela Remigio, déjà présente en 2017 en Elisabetta face à la Maria Stuarda de Marina Rebeka, qui incarne ici avec assurance Giovanna Seymour d’une voix de soprano qui convient davantage au rôle, que la traditionnelle mezzo gênée dans l’aigu. Sa prestation n’est pas électrisante mais l’interprète affronte avec une certaine conviction cette tessiture tendue ne se laissant impressionner ni par son futur mari, ni par sa rivale, notamment au deuxième acte dans le grand duo qui les réunit une dernière fois « Dio che mi vedi in core ».

Alex Esposito félin et séducteur, mais également brutal et dominateur, ne fait qu’une bouchée de cet ogre d’Enrico, sa belle voix de basse distillant avec la même facilité carnassière, les coups et les caresses. Virtuose impressionnant, à la voix fluide et racée, René Barbera s’avère un Percy de tout premier ordre, redorant le blason d’un personnage trop souvent décoratif. Dans le rôle-titre enfin, Maria Agresta déçoit par son approche privée de flamme et d’éclat. Cherchant son personnage, hésitant à lui donner chair et consistance, surtout à son entrée où elle compense son manque d’assurance en jouant les petites filles, la cantatrice s’économise pour parvenir sans encombres à la scène finale. Si toutes les notes sont là et les reprises habilement ornées, son interprétation manque de couleurs et d’émotion, sauf peut-être, mais si tard, dans l’étreignant « Cielo a miei lunghi spasimi » où la voix semble vouloir se libérer et prendre son envol. Martina Belli (Smeton), Andrii Ganchuk (Rochefort) et Nicola Pamio (Hervey), sont d’excellents comprimari, entourés par un chœur solide et compétent.
Rendez-vous dans deux ans avec Roberto Devereux ?…