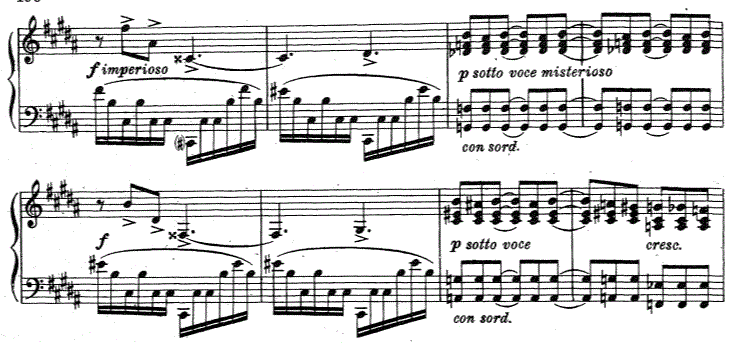Cette fin d’automne parisien est une bénédiction pour les pianophiles, en particulier s’ils sont de surcroît russophiles : outre nos deux nouvelles étoiles, se succèdent en trois semaines Leonskaja, Kholodenko, Geniusas, Sokolov, Andsnes et Koroliov, tous en récital. La Grande Sonate de Tchaikovsky fait partie des oeuvres que la première nommée a, en concert, profondément marquées de son empreinte – lors d’un inoubliable récital de mars 2013. L’approche de Kholodenko vient idéalement la compléter tant sur le plan de la conception, de la personnalité à l’oeuvre, que de la matière pianistique mobilisée. On ne sait jamais, au fond, ce qu’est une conception interprétative, à part quand elle est grossière et saillante par ses grossièretés. Mais il est aussi commode de se retirer derrière le miracle qui sortirait tout seul des doigts et de l’instrument, et ne se décrirait que comme un fait matériel, dépourvu d’enjeux esthétiques. Or, des enjeux esthétiques, il y en a dans cette œuvre essentielle, quoique tardive, du premier romantisme russe, et il y en avait dans cette interprétation magistrale. Il y en a un, surtout, qui est le conflit, objectivement présent dans la partition, entre l’aspiration à une grandeur formelle d’inspiration germanique, et les éléments du matériau mais aussi de la forme elle-même qui tirent l’œuvre vers un nationalisme esthétique. Le conflit, en somme, qui est la source même de la vitalité de la musique russe de cette génération, autant celle de Tchaikovsky « l’Occidental » que de ses contemporains. Il va sans dire que le défi suprême de l’interprète consiste à transcender l’opposition, stylistiquement et architecturalement. Et nombreuses sont les manières d’y parvenir, comme l’ont montré tour à tour Ginzburg, Richter, Pletnev, Leonskaja, Virsaladze et Berezovsky. Il n’est pas exagéré de dire que l’ambition de Kholodenko est d’aller plus loin, en des régions où cette musique n’a pas encore été menée. Sa tentative, par la recherche conjointe d’un creusement extrême du matériau, d’une sorte de cathédrale formelle et d’une exceptionnelle gravité dans le lyrisme, fait de la Grande Sonate la Hammerklavier russe, à la fois création du monde démiurge et syncrétiste, nourrie d’idiosyncrasies, et vaste méditation à la ferveur sacrée et à l’a l’intimité profane : plus précisément, la Hammerklavier selon Guilels. Encore fallait-il en avoir les moyens.
Parlons-en tout de suite, de ce piano de rêve, et cherchons à en situer les traits saillants, puisque toute la perception, y compris formelle, discursive, d’un tel récital part de ce choc persistant. Il a la clarté harmonique phénoménale d’un Andsnes, la puissance sans limites et toute de rondeur d’un Ohlsson ou d’un Rudenko : une combinaison de bronze et de format qui en fait une sorte de colosse de Rhodes du piano – comme l’est aussi Geniusas. Mais il y a, à même le son et la technique, des éléments qui lui sont plus propres, dans la mesure où ils se combinent avec les précédents. En particulier, une sophistication d’articulation mise à contribution pour tendre ou détendre le phrasé, donner une directionnalité plus ou moins grande à la modulation et, seulement à partir de là, à la phrase : de ce point de vue, Kholodenko peut faire songer, par instants et bien que la parenté soit plus lointaine, à l’un ou l’autre des deux autres géants russes précités. Pianiste d’une densité sonore fabuleuse, il n’est pas pour autant massif, mais étonnamment mobile dès que le rythme harmonique l’exige. Sa pente générale est de prendre des tempos plus lents que la moyenne, et c’est le cas tout au long de cette sonate. Mais cette lenteur ne vise qu’occasionnellement à une exacerbation de premier degré de la tension, ou à une décantation inattendue de la forme (en ce sens, il est profondément différent de Sokolov) : elle a davantage en vue le temps de l’aération, de la douce mise en lumière du chant, ou de la diction, bref, de l’éloquence. Bien que présentant des traits interprétatifs et sonores plus extrêmes que Geniusas, Kholodenko se situe, comme lui, à la confluence des héritages – des idéaux esthétiques – de Guilels et de Richter. On ne court pas grand risque à s’autoriser cette gourmandise : cette Grande Sonate ressemble beaucoup à celle que Guilels n’a pas donnée.
Il est permis de trouver dans cet éblouissement intellectuel et sonore des motifs de frustration, qui n’en seraient pas si le piano ne promettait pas en permanence la lune. L’exposition du premier mouvement promet tellement qu’il est difficile ensuite de ne pas manquer de ceci ou de cela. La dimension de martèlement du premier thème est évacuée sans ménagements. Tout ici n’est que lyrisme orchestral, legato harmonique. Signature des plus grands, des grandes oreilles : ce qu’on entend de façon obsédante n’est pas l’ostinato immobile de la voix haute, mais l’ostinato mobile de la basse, qui donne à l’idée musicale son relief et sa tension intérieure. Ce qui ne fonctionne que dans la mesure où l’un ne recouvre pas l’autre, mais où une parfaite égalité polyphonique met en exergue le conflit entre la stabilité de surface et l’aspiration à la descente. L’échelle dynamique dans lequel cela se passe semble, elle, définie par Gurnemanz : son espace s'accroît avec le temps. Le riche matériau qui suit est traité avec un soin d’orfèvre et un art de la transition qui impressionne d’autant que la grande retenue, le souci de ciseler le détail, font obstacle à la nécessaire fluidité. Mais l’obstacle est surmonté par la formidable épaisseur, la concentration du discours. Le grand thème rhapsodique mineur frappe lui aussi par sa retenue, qui est d’abord expressive, tirant sa quasi-grandiloquence vers l’introspection. Le troisième thème passerait presque pour un groupe thématique autonome, une sonate dans la sonate – avec ses fausses variations avortées, ce merveilleux pas de côté tranquillo joué avec le poids de signification, et en même temps le tour informel d’une bagatelle de Beethoven ou d’un feuillet d’album schumannien. L’idée ultime (ce duetto opératique qui est le sommet dramatique du mouvement, son épiphanie) paraît si développée et suffisante à elle-même qu’on est comme étonné de la voir ramenant la marche initiale. La richesse d’éclairages, de changements délicats d’aspects qu’impose Kholodenko sur ce vagabondage mélancolique lui donnent cette noblesse formelle, en un sens presque sculptural. En un sens, dans ce mouvement, tout est si intégré qu’une partie est presque désintégrée. Mais cela tient. Le développement, monstre de force ébrouée, somptueux d’équilibre choral, fait tenir l’édifice écrasant, comme un mur porteur de son
On pourrait en dire autant, bien que le problème discursif soit différent, pour le mouvement lent. Sur le plan de la pure beauté instrumentale, ce qu’on a entendu est inouï. Et l’on est bien loin de la plastique creuse que d’aucuns proposent dans ce répertoire ou ailleurs. La tenue rythmique, suprêmement austère, donne sens et consistance à la langueur et à l’accumulation. Les moyens sonores permettent même de retenir, de façon crédible, la battue là où c’est le plus improbable, comme dans la cadence d’accords de la récapitulation. La section médiane roule sur du velours, quand la coda se dissout dans une immatérialité qui ne cède rien à la clarté et à la persistance d’une pulsation. Pourquoi gardera-t-on sans doute, néanmoins, un souvenir plus impérissable encore de Leonskaja dans ces deux mêmes passages ? Parce que la quête d’un absolu aussi formel que physique ne peut ici qu’être accomplie au détriment de l’immédiateté, et en un sens de l’efficacité expressive. Oui, c’est presque trop beau. C’est grand aussi, mais ça le serait plus encore en étant un peu moins parfaitement beau. L’onirisme final de ce mouvement, dans son opposition subtile à son commencement, devrait faire se sentir plus libre, plutôt que plus écrasé.

Les deux derniers mouvements hypnotisent par leur fini joaillier. Kholodenko y refuse encore et toujours les lieux communs interprétatifs, et en même temps les magnifie, comme en tournant autour. Son scherzo est si précis et détaillé qu’on en perd paradoxalement le caractère populaire, le trait gouailleur de l’appogiature. Le trio se refuse au phrasé lancé, exubérant, pour prendre une facture étonnamment classique, appuyée sur des arpèges d’une rondeur incroyable. Dans la même veine, d’une incarnation sous-tendue, le finale accomplit une démonstration de force pianistique si absorbantes qu’elle détourne presque l’attention de la réception émotionnelle, qui pourtant devrait être inoubliable (mais après tout, il suffira sans doute de s’habituer à ce piano pour se concentrer sur l’essentiel). On manque de mots pour qualifier l’élasticité des accords portés du thème mineur ou l’éloquence de clarinettes des arpèges initiaux. Il y a de l’insolence dans la façon, encore, de retenir, puis de retenir encore plus et puis plus encore, la dynamique et l’intensité d’élocution de la coda, comme un rejet dans le prosaïsme de tout ce qu’on a l’habitude d’y entendre. Et puis il y a l’incroyable partie centrale, dont le chant hymnique varié passe tout, si l’on veut, dans la partition et dans cette interprétation. Quelque chose est trouble dans la manière qu’a Kholodenko de… retenir, évidemment, la tension dans l’ultime progression du passage, avec sa modulation qui paraît infinie, où le thème prend cent fois son élan, et où l’on nous fait tout, tout entendre, quand le crescendo ne semble jamais finir, quand les trois registres chantent, s’éveillent, se meuvent dans un grouillement aussi sauvage et religieux que l’éveil du printemps dans Anna Karénine. C’est exagéré, cela manque de naturel, de nécessaire naïveté, c’est trop magistral, pas assez sentimental, oui, mais ça pue le grand style.
La partie post-romantique du programme est en un sens encore plus irréprochable tout en se montrant, si c’était possible, encore plus personnelle. La sélection de préludes de Rachmaninov continue d’offrir un luxe indécent de sensations et de détails. En quelques occasions, la proximité avec Geniusas (dont on a entendu plusieurs fois les vingt-quatre, au disque et en salle) s’impose par-delà la seule qualité instrumentale et d’oreille. Le prélude en ut dièse mineur, celui en si bémol majeur ou celui en sol mineur semblent globalement faits du même métal. Une matière opulente, une virtuosité au service entier de l’intelligibilité et de la clarté de direction des lignes, une force immense domestiquée tranquillement, sans rien de militaire, et avec une élégance qui relève l’académisme, conjugue chic et grandiose. Et dans ces trois préludes les sections médianes sont éblouissantes, gorgées de chant, cela va de soi, mais surtout libres de tout appui ou soufflet agogiques : elles sont jouées d’une phrase. Dans les opus 23 n°2 et 5, on a pu connaître des sensations plus fortes dans les grands soirs de Berezovsky, où une prise de risque plus grande pouvait mettre en présence d’une folie, d’un trait torrentiel, qui loin de faire obstacle au chant en démultipliait la générosité. Mais dans cette perspective d’abord habitée de hauteur et de grandeur, on ne peut faire mieux. On peut faire aussi bien, et chance incroyable, nous avons les deux pianistes pour le faire. Ce que je remarque en mentionnant Berezovsky était encore plus présent à l’esprit dans l’élégie du prélude en ré majeur, dont il avait montré comme personne l’effusivité et l’urgence lyrique. Kholodenko, plus encore que Geniusas, se situe à l’exact opposé, et à titre personnel, c’est une approche de ce chef d’œuvre que je n’ai jamais comprise, même avec Richter. Cette majesté immobile et sérieuse, cette sentimentalité mâle un peu artificielle, et surtout cette lenteur sépulcrale me paraissent décidément relever d’un propos en marge du texte, comme surimposée à l’élan improvisé qui se dégage presque visuellement de lui. Même si ce propos, sans doute, ne peut être mieux que tenu qu’ici. De menues réserves, aussi, me semblent applicables à l’opus 23 n°6, si délayé, épandu, certes avec grâce et un admirable souci de cisèlement, mais si dématérialisé qu’il finit par ne plus vraiment prendre la parole. Dans la vibration plus abstraite du 23 n°8, ce parti pris de liquidité quasi-ravélienne trouve davantage son objet. Enfin, le grand prélude en ut mineur, joué en dernier, cumule les émerveillements et frustrations de tous les autres. Comme Geniusas, mais à un degré plus poussé encore (c’est en fait à la 24e étude de Chopin par ce dernier que l’on songe), Kholodenko part d’un frôlement dans le néant et construit un gigantesque gonflement de masse mouvante, aboutissant à un tonnerre d’orchestre. Pourquoi, au terme d’une coda dantesque, cataracte où toute la tension stockée semblait libérée, reprendre soudain ce qui avait été donné en retenant, freinant, verrouillant presque l’avancée de l’ultime série d’accords ? On pourrait y sentir une pointe d'orgueil : le refus trop affirmé d’une facilité qui n’en est pas une.
Dans Scriabine, Kholodenko est, de sa propre affirmation, chez lui. La perspective qu’il y offre est riche, précisément, de relief et de dimensions. En un sens c’est sa propre tradition qu’il crée dans cette musique, ou celle d’un Scriabin guilelsien (qui n’a jamais existé que parcimonieusement). Il n’a pas le ton faisant bondir comme des diables les voix de la texture, qui signait les manières, par ailleurs bien distinctes, de Sofronitsky et Horowitz hier, Berezovsky aujourd’hui. Il n’a pas non plus la décantation de l’intérieur de la texture que propose Pletnev dans son suprême raffinement. Et il n’a rien, non plus, de la surcharge mystique, de l’accent de transe qui s’ajoute volontiers à l’épaisseur de perplexité déjà contenue dans les textes. S’il y a une parenté audible, en partie, dans sa 5e Sonate (enchaînée directement après un Poème satanique tournant l’ironie demandée au second degré), c’est celle avec Richter, pour ce qui est de la relation entre harmonie et matière sonore. Kholodenko, lui aussi, veut faire tout entendre, et lui aussi en refusant l’effet de masse et la seule luxuriance : donc, en faisant lui aussi entrer la polyphonie dans une sorte de fusion de timbre, muant le gazeux en solide, le liquide en solide, le feu en roche volcanique, mais sans que rien ne se perde. Il en a les moyens lui aussi et le résultat, à cet égard, est une splendeur dorée. Là où sa singularité s’impose, c’est qu’il reprend à son compte cette manière en l’intégrant dans un geste beaucoup plus vaste, qui laisse la musique respirer amplement, supprime toute la dimension électrique que l’on retrouve chez tous les pianistes cités, notamment dans le thème syncopé, où prévaut le ressassement du chant, nourri d’un accent altier qui traverse toute la sonate. Mais quand Kholodenko décide de timbrer et jouer en-dehors, cela frappe d’autant plus : dans l’alternance thématique de la récapitulation, l’imperioso de la main droite sonne comme huit cors mahleriens pavillons en l’air. Sa coda n’appartient qu’à lui, sinon, peut-être, à ce que Scriabin avait réellement en vue : les six dernières mesures, retenues à l’extrême, sont re-composées en un unique mouvement harmonique, unifié dans la pédale. Comme le surdoué de Kiev fait partie des rares spécimen capables de tout faire entendre en maintenant la forte enfoncée, et pendant longtemps, la superposition des quartes et tierces passées de registre en registre crée une sorte d’hyper-consonance inattendue, par prolifération d’harmonies locales qui paraissent habituellement disjointes. Au lieu de l’accord mystique, on entend une sorte d’accord de la terre, de résolution supérieure. Ciel : que seront alors ses Busoni et Hindemith ?
Deux offrandes supplémentaires : de l’extrême liquidité (Ravel, Noctuelles), et du marbre délicatement taillé (l’Alla coda des Mélodies oubliées de Medter : réminiscence de réminiscence).