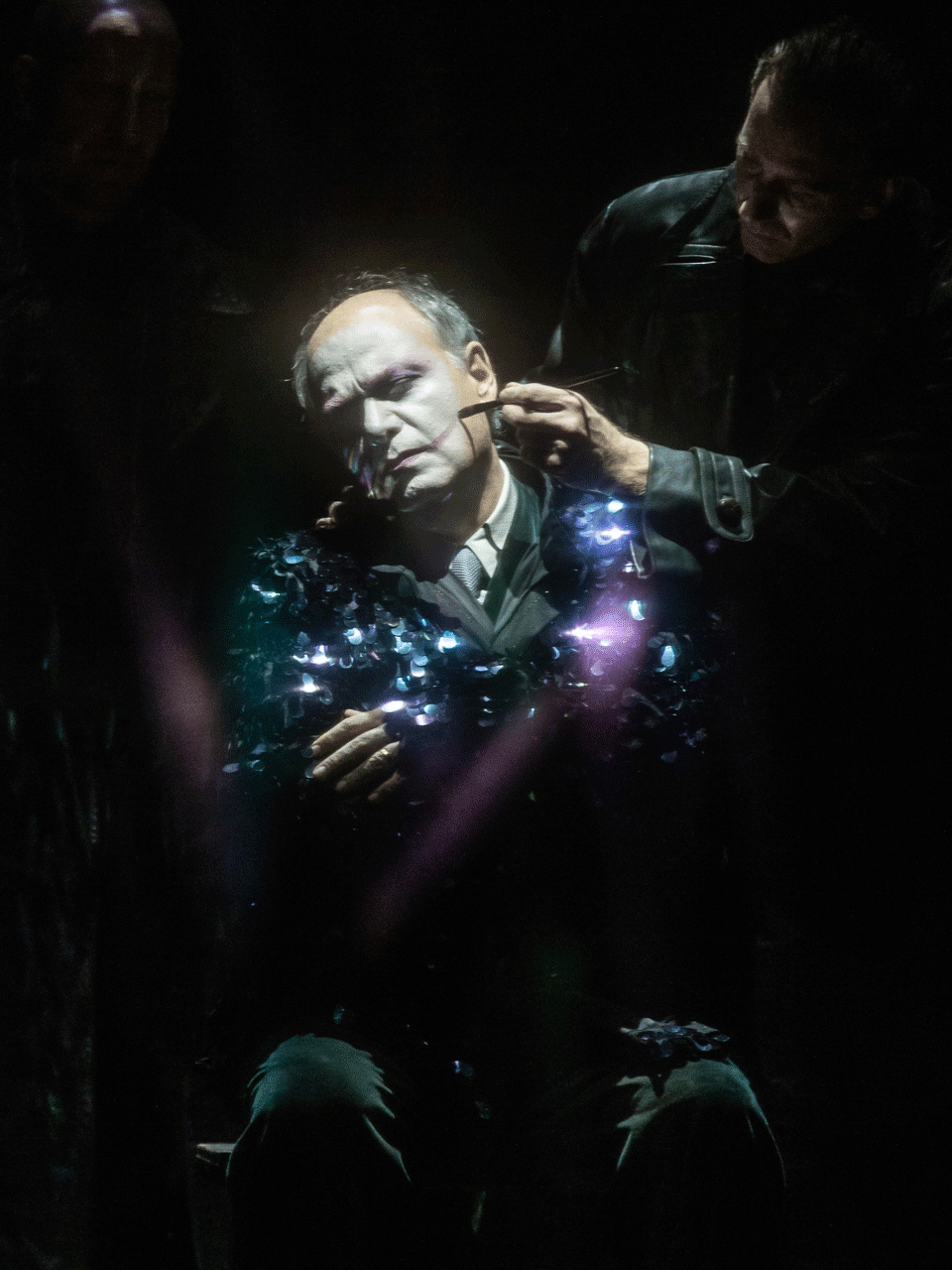Un Rigoletto autre
Ce qui fait l’originalité de ce Rigoletto, plus que la mise en scène de Daniele Abbado digne et visiblement travaillée avec le chef, mais qui hésite entre une vision noire de thriller et un regard plus traditionnel (à la fin notamment), plus qu’un trio de chanteurs exemplaires qui se plient aux indications du chef et autocensurent tout ce qui est effet, ce qui est histrionisme, ce qui est tradition au sens routinier du terme, ce qui fait l’originalité de cette production, c’est une musique qu’on n’a jamais entendue faite ainsi, qui constitue un retour à la partition de Verdi avec ses surprises et sa radicalité.
Daniele Gatti a expliqué avoir relu la partition à l'aune de l’édition critique de la Chicago University Press et découvert avec surprise que bien des aigus pratiqués n’étaient pas écrits, que les tempi étaient souvent bien plus lents qu’on ne les entend habituellement et que ces choix de Verdi lui-même déterminaient une dramaturgie musicale toute différente avec des scènes qui changent complètement de rythme. Deux exemples au début, l’air « Questa o quella per me pari sono » pris à un tempo bien plus ralenti devient non plus l’air d’un duc superficiel et sans scrupule, la signature initiale, mais plutôt un programme raisonné de libertinage, une « explication » donnée à Borsa et non un air brillant chanté à la cantonade. Autre exemple, la première apparition de Sparafucile, à un tempo ralenti, et un orchestre en sourdine (avec des contrebasses et des violoncelles magnifiques) devient spectrale et à la limite du réel.
On oublie souvent que si Verdi s’inspire du Roi s’amuse de Hugo, violente charge contre la monarchie et la noblesse qui vaudra les foudres de la censure, son librettiste Francesco Maria Piave place l’intrigue à Mantoue, que Verdi connaît bien, puisqu’il habite à quelques dizaines de kilomètres : il connaît ces climats humides de la plaine du Pô, traversés de brumes épaisses glaciales et inquiétantes. Verdi et Piave font de Rigoletto une œuvre nocturne, traversée par les petits matins blêmes ou les tempêtes. Et l’apparition de Sparafucile est une ombre émergée de la brume, qui passe comme un fantôme. Mantoue, c’est d’abord cette brume, et il serait bien étrange que Verdi en écrivant Rigoletto ne s’en souvînt pas.
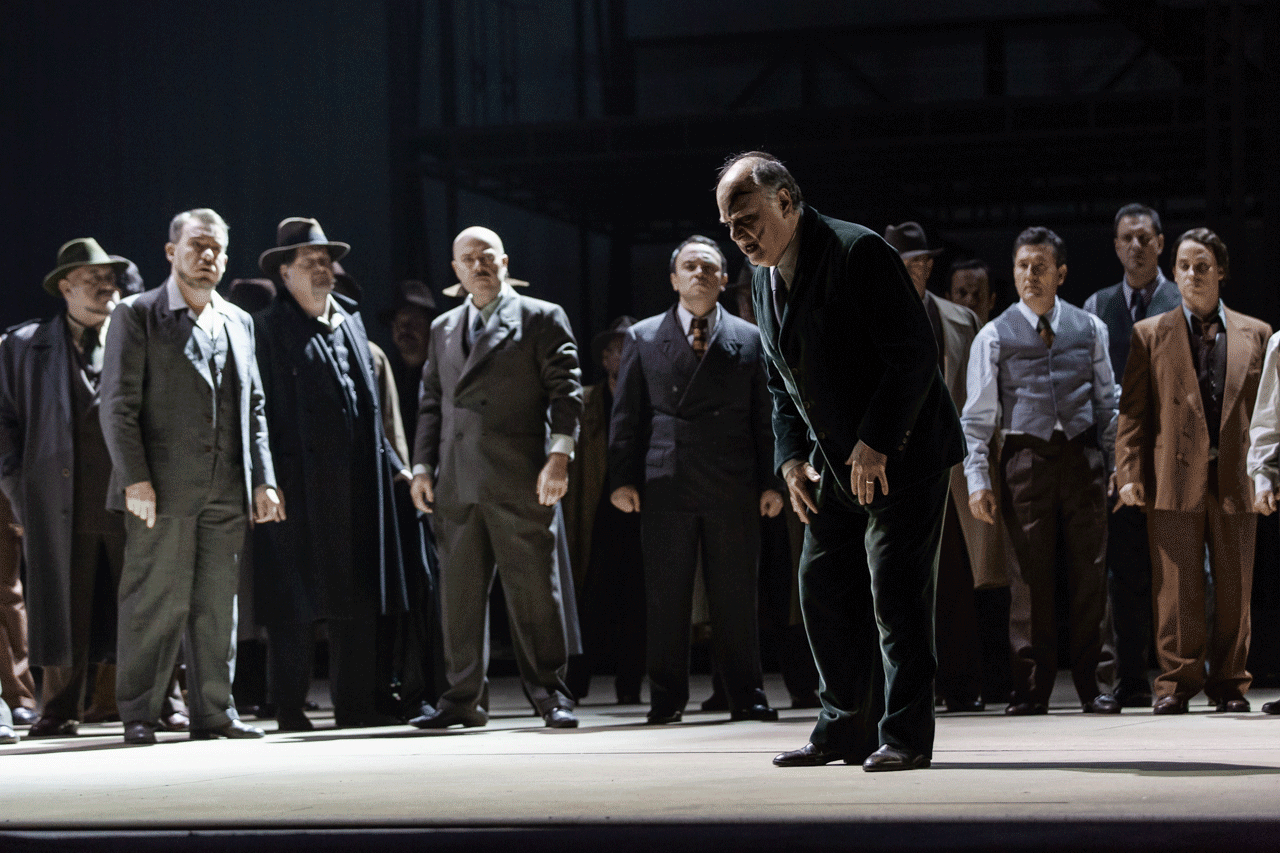
Une lecture musicale fascinante par sa profondeur et sa nouveauté
Pour cette raison l’impression qui ressort de cette lecture musicale est l’évacuation de tout brillant, au service d’une couleur sombre , d’ambiances obscures, et de personnages jamais caricaturaux, que ce soit le duc ou Rigoletto. On voit souvent des Rigoletto roulant des yeux exorbités, et des ducs tout aussi caricaturaux dans leur superficialité insignifiante. Ce n'est pas le cas ici.
Gatti impose ici à l’équipe de chanteurs, de chanter autrement, de manière plus concentrée, en évitant les projections de décibels en folie.
Prenons l’exemple des aigus. Les aigus non écrits par Verdi ne sont pas faits (c’était déjà un credo de Riccardo Muti dans ses années florentines, par exemple l’aigu de « Di quella pira » de Trovatore). Dans sa manière de diriger, dans sa manière d’imposer aux chanteurs un style et un tempo, Daniele Gatti rend d'ailleurs l’aigu totalement inutile : on n'en sent plus la nécessité. Ce travail de retour à la partition, de concentration, montre que l’écriture-même de Verdi ne demande l’aigu seulement quand il nécessaire, et non pour faire briller un chanteur, et du coup, la couleur générale est totalement différente, faisant de Rigoletto non plus l’œuvre brillante de la trilogie populaire, mais un thriller noir, sinistre, brumeux .
Un exemple : l'acte I
Ce début d’acte I impose d’ailleurs un cadre qu’on ne perçoit pas toujours ; entrons dans le détail pour comprendre en quoi consiste le travail de dépoussiérage : d’abord c’est la fin de la soirée – Hugo lui-même le dit dans Le roi s’amuse ((dans la didascalie initiale de l’acte I, sc.I « La fête tire à sa fin ; l’aube blanchit les vitraux. »)) et les gens commencent à partir (la comtesse Ceprano), la fête ne bat plus son plein, et il est donc inutile en fin de soirée d’être brillant (d’où un « Questa o quella » plutôt retenu), ensuite, le jeu sonore des orchestres en scène (un à vue et l’autre en fond) avec l’orchestre de fosse qui intervient par moments, en alternance, renvoie évidemment au final du premier acte de Don Giovanni de Mozart (c’est très visible lors du moment où part la Ceprano accompagnée des flatteries du duc!) rarement on a pu entendre une telle clarté dans les différents niveaux d’orchestre, scène et fosse, et aussi un tel raffinement. Jamais le volume n’est envahissant, avec des rythmes presque rossiniens dans leur délicatesse. La mise en scène met à vue l’un des deux orchestres en scène, l’autre étant dissimulé en coulisse : et la vue des musiciens change l’audition, on prend attention directe au jeu sur les plans sonores, sur le sens des interventions de fosse, sur le son imposé par ces orchestres sur le plateau. La scène devient tout à coup plus élégante, plus élaborée, plus construite : telle est la partition de Verdi, qui refuse les facilités qu’on a cru y voir.
Un Rigoletto tendu et foisonnant de couleurs
Et il en va ainsi de toute la soirée : nous avons-là un Rigoletto plus précis, au son plus analytique, avec des émergences instrumentales surprenantes (les bois, et notamment le hautbois qui accompagne « Tutte le feste al tempio » de Gilda au II) ou la flûte, en phase totale avec les voix), un Rigoletto à la tension dramatique très forte, avec des crescendos superbement maîtrisés ( de la part d’un rossinien comme Gatti !) mais aussi un Rigoletto qui nous dit autre chose de ce que nous connaissions de l’œuvre,, un Rigoletto qui peut être grinçant, en tous cas qui montre une palette nouvelle, un large spectre de couleurs qui va du grotesque et du comique au pathétique et au tragique, un Rigoletto noir, mais pas seulement, et qui donne aux personnages eux-mêmes une autre valence ou un autre poids. Ainsi, c’est le retour à la dramaturgie verdienne d’origine qui détermine dans la mise en scène et le traitement des personnages une vision nouvelle : un seul exemple, le duc, souvent vu comme un être superficiel et sans aucun scrupule, acquiert un poids différent, moins brillant, au libertinage assumé certes, mais un poil moins cynique.
Rigoletto devient aussi non pas une sorte de personnage biface aux vies séparées, bouffon et père : il est plus cohérent, plus uniforme, plus digne aussi, y compris dans les bouffonneries. Il en résulte alors un chant plus raffiné, moins « histrion » que ce à quoi nous ont habitués les grands interprètes du rôle.
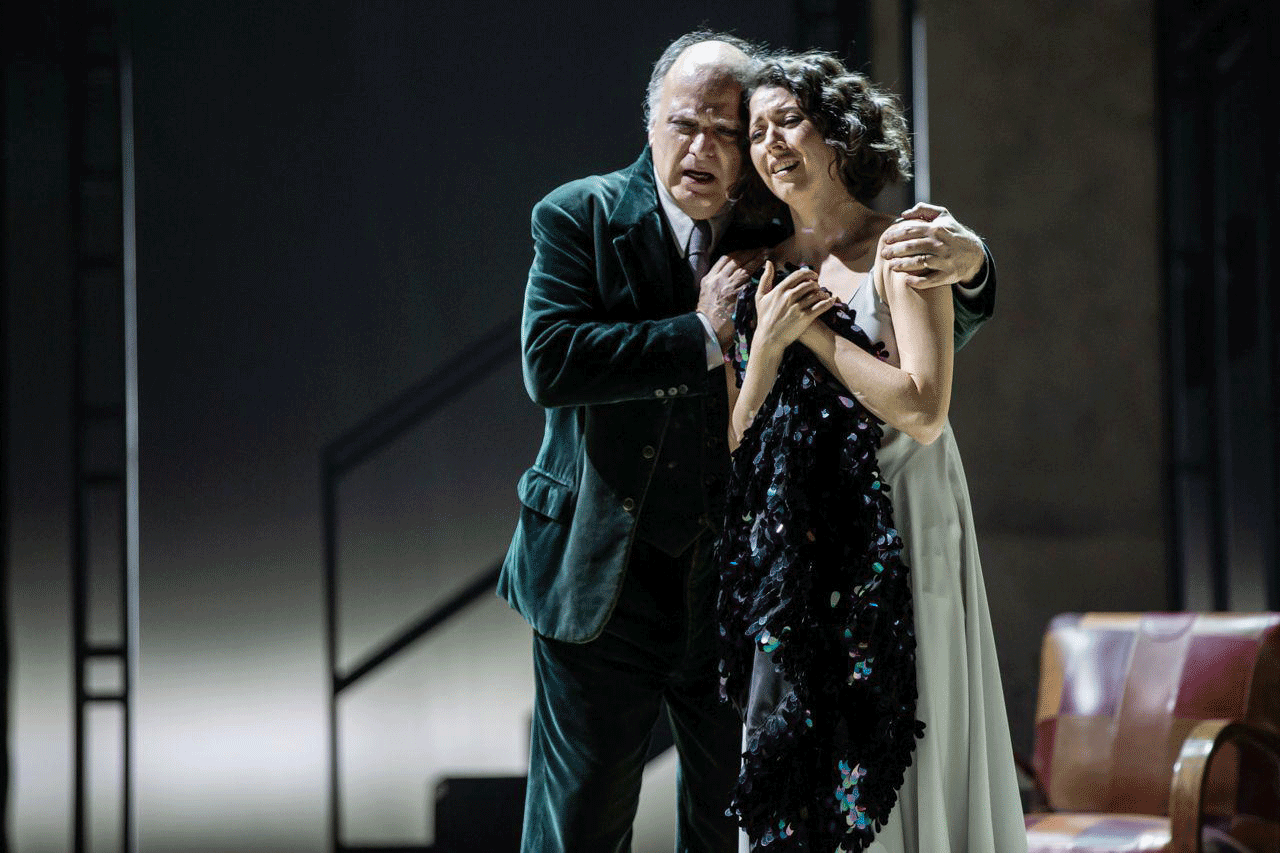
Une palette vocale exemplaire
Sur le plateau, le choeur dirigé par Roberto Gabbiani offre une prestation exemplaire, claire, puissante, très contrôlée aussi à cause du ton voulu, et ne couvre lui non plus jamais les chanteurs, qui constitue un plateau exemplaire.
Lisette Oropesa est en train de devenir l’une des références parmi les sopranos, elle a triomphé à Paris dans Les Huguenots, puis dans L'Elisir d'amore, elle fut avec Gatti Nanetta dans le Falstaff d’Amsterdam. On pourrait croire en une voix légère, mais il n’en est rien, la voix a un vrai corps, avec des aigus et suraigus très maîtrisés et très contrôlés. Elle est une Gilda très fraîche, jeune, mais aussi décidée et mûre. Elle n’a rien d’un rossignol, notamment dans le célèbre « Caro nome » débarrassé des cadences et fioritures inutiles, tout au contraire : la ligne de chant et les passages sont impeccables, la diction sans aucun accroc, avec un vrai sens de la couleur, elle sait notamment faire émerger le drame, les hésitations, tout autant que la joie : la manière dont à son entrée en scène elle se précipite vers son père pour essayer de lui raconter son amour naissant (sans y réussir d’ailleurs) avec une couleur juvénile et dans la sincérité immédiate de la joie, tranche avec un « Caro nome » certes plein d’amour, mais déjà sérieux, presque mélancolique qui est un chef d’œuvre de retenue et d’émotion notamment dans le « e fin l’ultimo mio sospir,
caro nome, tuo sarà. » si prémonitoire.
Elle sait aussi à la fin du second acte, avoir des accents dramatiques marqués. La voix est d’une rare sûreté, d'une grande homogénéité et l’engagement est total. Une très grande Gilda, sans doute la meilleure aujourd’hui, qui sait parfaitement doser l’engagement entre la jeunesse, l’amour, le drame, avec une grande présence scénique et vocale : elle est bouleversante dans la scène finale (« Ah, ch’io taccia ! A me, a lui perdonate. ») où comme au final du II, elle demande au père de pardonner (« Perdonate : a noi pure una voce di perdono dal cielo verrà. »), une fois de plus prémonitoire, puisque la mise en scène la fait mourir debout, telle l’ange qu’elle deviendra au ciel…

Face à cette Gilda rayonnante et sensible à la fois, le duc d’Ismael Jordi est volontairement moins rayonnant , dans une mise en scène où ses frasques sont moins lumineuses et presque plus sombres : les choix de la direction musicale, limitant au maximum les effets, pour s’intéresser à la couleur à l’ambiance et montrant que Verdi n’a peut-être pas voulu à l’origine un duc histrion, une sorte de bijou en toc à la voix claire et brillante, mais un duc « simplement » libertin, et peut être (acte II) sincèrement amoureux (« ella mi fu rapita !… »). Ismael Jordi est un authentique belcantiste, à la voix contrôlée, au timbre clair qui peut rappeler un Giacomo Aragall. Il compose un duc très différent de l’habitude, très contrôlé, presque plus intérieur : les démonstrations ténoriles habituelles (cadences, suraigus etc…) ne cadreraient pas avec ce duc-là. C’est peut-être dans le trio de protagonistes le plus surprenant des trois, car l’approche du chef (et de la mise en scène) lui imposent une certaine retenue, en donnant au personnage une certaine ambiguïté et lui enlevant en tous cas bonne part de ce qu’il peut avoir d’odieux dans la vision habituelle. Certes le personnage n’est pas vraiment recommandable, mais on sent dans cette production quelque chose de plus profond. Ismael Jordi sait rendre cette quasi tendresse du Duc en modulant un chant qu’il sait colorer, sachant adoucir quand il faut, sans jamais être vulgaire ni jamais exagérer. Son « Questa o quella » initial au tempo ralenti est plus explicatif que démonstratif, une déclaration à la Don Juan « non v’è amor se non v’è libertà. ». Grande réussite de cette composition presque en clair obscur d’un duc jamais brillant gratuitement.
Roberto Frontali est Rigoletto, la mise en scène essaie d’effacer la séparation bouffon/père en unifiant le personnage, notamment par les costumes de Francesca Livia Sartori e Elisabetta Antico, vêtu d’une veste noire avec quelques paillettes quand il est bouffon, qu’il ôte facilement pour redevenir celui que le duc décrit comme « misterioso un uom v’entra ogni notte » dès la cinquième réplique. C’est d’abord cette globalité qui frappe, l’unité d’un personnage qui sous la lumière noire juge l’humanité aristocratique qu’il déteste et qui dans la nuit redevient « l’homme mystérieux ». Frontali évite tous les borborigmes et les simagrées de Rigoletto, et justement affiche dans son chant une très grande humanité, avec lui aussi une science des couleurs consommée, et un raffinement dans le chant qui rend son interprétation fascinante. Ce Rigoletto est foncièrement juste, plus intérieur, tragique et frappé dès le début par la malédiction. Dans la scène initiale avec Sparafucile, il finit presque méditatif, ciselant son « pari siamo » dans une rage intérieure qui rend le personnage désespéré et son « Cortigiani » de l'acte II est quasi un monologue intérieur . Rigoletto rendu à la tragédie. Frontali (classe 1958) est complètement bouleversant, sans avoir besoin de forcer sa voix : il lui suffit de dire le texte. La ligne de chant, les aigus (et même le la bémol de « vendetta », seul aigu rescapé) la couleur, la diction, tout est sûr, tout est parfaitement dans le ton. C’est un Rigoletto digne d’un univers à la Edvard Munch : l’expressionisme à la Verdi. Magnifique.

Et les protagonistes sont bien entourés : d’abord le Sparafucile de Riccardo Zanellato lui aussi insinuant et sinistre dans la scène du I avec Rigoletto, mais au III, il est tout aussi retenu avec un grave profond, une voix ronde, et une magnifique diction, expressive, claire, jouant des couleurs et donnant du personnage une allure presque irréelle.
La Maddalena d’Alisa Kolosova bien plantée, démontre une voix sûre, juste, puissante.
Et tout le reste de la distribution est sans reproche (notamment la jeune Irida Dragoti dans Giovanna et aussi le Monterone de Carlo Cigni).
Mais c’est d’abord l’œuvre du chef d’avoir réussi à changer les « mauvaises » habitudes et d’avoir rendu ce Rigoletto par les choix musicaux à la vérité des personnages et à une ambiance sombre, contrastée, frémissante plus que vibrante.
En commençant par les principes que Gatti impose à la direction de l’œuvre, on arrive très vite à la mise en scène de Daniele Abbado, qui a été travaillée en relation avec les idées du chef où Abbado (qui a de qui tenir) soumet son travail au rythme dramaturgique de la musique de Verdi avec sur certaines scènes un résultat très convaincant .
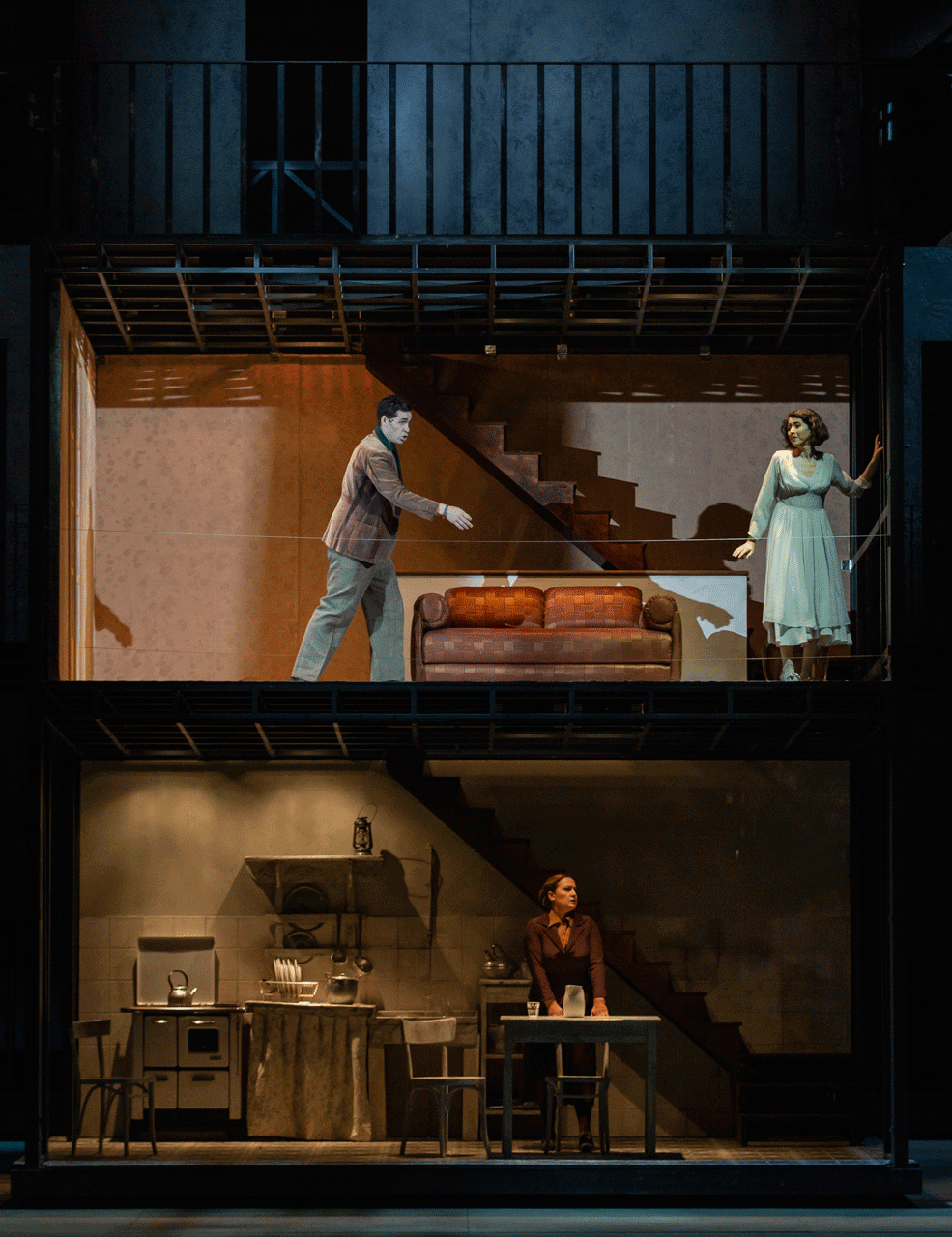
La mise en scène colle donc à ce contexte avec bonheur, sans être en elle-même trop riche d’idées, mais digne dans l’ensemble . Comme il a été dit, chef et metteur en scène ont travaillé ensemble à faire de Rigoletto ce thriller expressionniste, où tout brillant est effacé. Daniele Abbado place l’intrigue dans les années 40, dans une Italie dominée par le fascisme, d’où l’ambiance sombre des décors de Gianni Carluccio, assez légers pour se mouvoir sans étouffer l’espace, froids et métalliques, se disposant sur plusieurs niveaux, évoquant un temps où les enlèvements les complots, et bien sûr les coups tordus des Sparafucile du moment étaient monnaie courante.
Mais la question historique n’a pas tant d’importance, sinon de nous dire que le pouvoir est toujours louche et abusif. Plus intéressantes sont les ambiances uniformément nocturnes comme on l’a dit, et dans les brumes inquiétantes d’une Mantoue mortifère.
La plus réussie est la scène de la première rencontre de Sparfucile et de Rigoletto, où tout va se décider, et où Sparafucile une sorte de spectre qui passe à travers les brumes, murmurant à Rigoletto sa proposition sans vraiment insister, sans qu’on sache si cette apparition est réelle ou non, laissant planer ce côté irrationnel de l’œuvre déjà marqué par la malédiction de Monterone. En revanche la scène finale où Gilda meurt debout, comme transfigurée, est un topos des grandes morts verdiennes, comme celle de Traviata. Il y a ici un certain manque d'inspiration, mais cela ne nuit pas à un travail d'ensemble qui ne méritait pas les huées reçues paraît-il à la première.
Sans l’ombre d’un doute, l’absolu protagoniste de la représentation est Daniele Gatti, qui donne à ce Rigoletto une couleur neuve d'une intensité rare et d'une rare imagination, provoquant chez les chanteurs une attitude moins superficielle, un regard plus profond et sensible sur leurs rôles, et déterminant aussi les seuls moments vraiment réussis d’une mise en scène digne mais sans grande nouveauté. Après les détestables aventures de l’été, revoir sur le podium un Gatti transcendé par la musique de Verdi et acclamé si chaleureusement par le public romain, désormais son public, avait quelque chose de fort émouvant.