
Une longue entrée en fonction
Enfin ! Quatre ans après son élection, Kirill Petrenko entre en fonctions : il a donné avec sa future formation quelques rares concerts et il a produit un CD, La Pathétique de Tchaïkovski. Certains vont émettre leurs oukases, évidemment définitives jusqu’au prochain concert, décrétant devant l’éternité que Petrenko était le meilleur choix possible, ou qu’au contraire les Berliner ont fait une cruelle erreur. Il en va de la musique comme du foot. Les penseurs sont au café du commerce ou sur Twitter.
Nous suivons Kirill Petrenko depuis 2006, depuis ce temps lointain où il dirigea jusqu’à 2010 de mémorables Tchaïkovski à Lyon, régulièrement, et essentiellement à l’opéra. Nous nous sommes réjouis de son élection à Berlin. Mais le plus difficile reste à faire, car autant la rencontre d’un chef et de l’orchestre d’un soir ou d’une semaine est quelquefois un coup de foudre, mais brève comme les coups de foudre, ou mieux, comme la saveur de l’ouzo bu sur un port grec, infiniment plus douce que le goût du même ouzo bu chez soi.
C’est qu’installer une relation avec un tel orchestre sur la durée, c’est une entreprise ardue, parce que les Berliner ont leur tradition, leur histoire centenaire, voire leur répertoire qu'il va falloir repenser. Il va falloir ouvrir sur de nouveaux projets, casser peut-être des habitudes : tout est ouvert et au-delà des deux splendides concerts qui marquent le début de cette nouvelle ère, il va falloir aller peut-être contre des murs, résister à la pression médiatique et aux coups bas qui ne manqueront pas. Sans doute Petrenko devra-t-il sur la durée vaincre sa timidité ou sa réserve.
On a vu, quand Abbado est arrivé après Karajan (une succession autrement difficile et symbolique) les doctes papillons noirs annoncer la fin de l’orchestre, la fin d’un son, la fin d’un ordre immuable du monde musical. On a vu aussi les mêmes ou leurs cousins dire la même chose ou peu s’en faut à l’arrivée de Rattle ; les doctes papillons noirs ne manqueront pas dans les prochains mois, ils sont déjà sur les starting blocks.
Le début est prometteur, voire fulgurant. Et même audacieux. Aucun Chefdirigent des Berliner n’a osé inaugurer sa charge par une Neuvième de Beethoven, une œuvre qu’un Abbado a abordée au-delà de la cinquantaine, et qu’il n’a dirigée avec les Berliner qu’au printemps 1996, soit sept années après son élection et cinq ans après son entrée en fonction. Car diriger une Neuvième d’emblée, et avec pareil orchestre qui en a des centaines dans sa longue histoire, c’est d’abord s’exposer aux mémoires du public, mais aussi des musiciens, dont Beethoven est un des morceaux d’ADN. Mais Petrenko s’intéresse peu au « Qu’en dira-t-on », il suit son chemin et plonge dans ses partitions. Cette année, Beethoven a été à l’honneur à Munich avec Fidelio et la Missa Solemnis, à Turin avec l’Eroica et à Rome avec, justement la Neuvième. Il n’y a pas de hasard, Petrenko le travailleur travaillait son Beethoven, et il continuera puisque Fidelio est programmé pour Pâques à Baden-Baden en une année 2020 qui marque le deux-cent cinquantième anniversaire du compositeur.
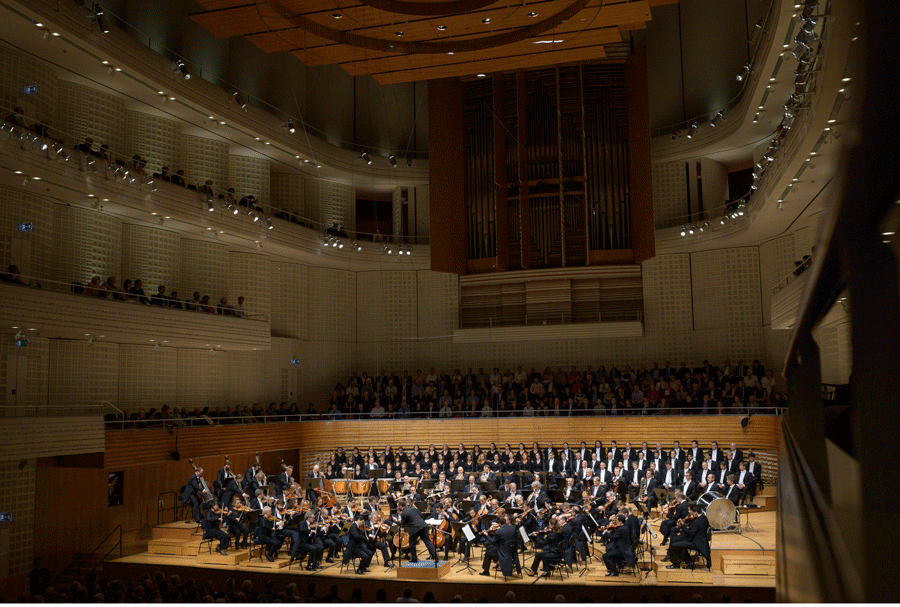
Un choix de programme emblématique
Il aurait pu commencer par un compositeur post-romantique, sa période de prédilection pour le moment, et d’ailleurs, il n’a pas résisté à reprogrammer dans sa tournée pour le deuxième concert le programme inauguré avec les berlinois ce printemps (Schönberg/Tchaïkovski) et joué aussi à Baden-Baden cette année. Mais les doctes papillons noirs auraient exulté : ce chef n’a pas de « grand répertoire » germanique à son actif. Alors, il fallait affronter d’emblée le symbole Beethoven, pour honorer l'anniversaire, pour honorer l'orchestre, et pour marquer le territoire.
On oublie souvent toute la formation musicale supérieure de Petrenko en Autriche, à Feldkirch puis Vienne : on peut y supposer qu’il a baigné le répertoire germanique et notamment beethovénien.
Ceux qui continuent de penser que c’est le perdreau musical de l’année en sont pour leurs frais ou ne mesurent pas ce qu'un choix de Chefdirigent pour un orchestre tel que les Berliner suppose de professionnalisme .
Mais le symbole va bien au-delà des goûts ou spécialités musicales de Kirill Petrenko : jouer une Neuvième pour inaugurer une « ère nouvelle », c’est placer son mandat dans l’optimisme de la liberté et de la fraternité, – la période s’y prête peu pourtant- c’est aussi un signe politique que de la jouer en plein air à la porte de Brandebourg qui rappelle l’autre 9ème celle de Bernstein jouée au pied du mur en décembre 1989, trente ans avant, c’est enfin célébrer Berlin, son histoire, ses blessures et ses joies, avec son orchestre symbole.
Mais c’est surtout entrer en fonction avec le compositeur sur lequel le son de cet orchestre s’est forgé, avec Furtwängler, avec Karajan aussi, et avec Abbado et Rattle à qui on a reproché d’avoir fait perdre sa spécificité sonore. En tous cas, Beethoven est sans cesse dans les programmes. Quand on étudie par exemple les programmes d’Abbado avec Berlin depuis son élection, on remarque qu’il dirige Beethoven régulièrement, une ou deux symphonies, quelques pièces singulières très aimées, comme la Fantaisie chorale op.80, et les concertos. C’est régulier jusqu’à la parution de la première intégrale à la fin des années 90 et jusqu’à l’intégrale de 2001, avec des concerts mémorables à Rome, puis à Vienne, et même à Salzbourg (15 avril 2001, la plus belle VIIe de mon existence).
Pourquoi ces prémisses, pourquoi ne pas rentrer in medias res dans ce concert ? Simplement pour prévenir les jugements à l’emporte-pièce, parce qu’on ne peut juger cette relation nouvelle avec les Berliner par les quatre ou cinq malheureux programmes qu’il a dirigés depuis 2015, simplement aussi parce qu’on ne peut aborder une ère nouvelle sans perspective historique, qui est aussi perspective d’une évolution, parce que l’Orchestre Philharmonique de Berlin, c’est un pan fondamental de l’histoire de la musique et de la diffusion musicale. Une nouvelle histoire commence, à petit pas, avec un nouveau chef, le moins médiatique, le plus discret, qui n’aime ni les disques ni la presse. S'ils l'ont malgré tout élu en 2015, c'est que tout simplement qu’après trois concerts, ils ont senti qu’avec lui, ils faisaient de la musique.
Lulu Suite
Ce fut donc un de ces concerts où les pupitres les plus célèbres étaient là, et notamment les bois, Pahud, Ottensamer, Mayer, Quandt, Schweigert, avec quelques petits nouveaux comme Benjamin Forster aux timbales. Mais c’est surtout un concert au programme emblématique de ce chef qui place en première partie la Lulu Suite, avec en soliste sa Lulu et sa Salomé munichoise, Marlis Petersen.
Petrenko n’oublie jamais la seconde école de Vienne, et le lendemain ce sera le tour de Schönberg. Mettre en regard le chant à la fois érotique et mortifère de Lulu et l’optimisme transcendant de Beethoven est aussi une audace, qui contraint le public jamais spontanément amoureux de Berg à entrer dans cette musique, et la direction de Petrenko claire, tendue, lyrique aussi, est une invite à l’exploration de l’intérieur, même si l’œuvre dans sa forme reste un « Essay » (dédié à son maître Schönberg) destiné à présenter son nouvel opéra encore inachevé dans les salles de concerts.
Petrenko est un extraordinaire révélateur moins d’architectures orchestrales que de couleurs : aucun détail ne lui échappe, la partition est un ensemble de tesselles d’une mosaïque dont on apprécie peu à peu la forme. Et cette Lulu Suite convient très bien aux Berliner, parce qu’elle sollicite, au-delà des tutti, chaque pupitre, chaque ensemble d‘instruments solistes, parce qu’elle oblige à se concentrer sur les déclinaisons des instruments, les reflets, les éclairs, les obscurités. La vertu de ces pièces de la seconde école de Vienne, c’est que leur lisibilité ne vient pas de la mélodie d’abord, mais de leur agencement, contraignant l’auditeur (et c’est un bonheur) à se concentrer sur des phrases, sur des sons, sur leur organisation. C’est une invitation non pas à la transcendance et à la respiration, mais à la rentrée en soi. Mettant en regard ces pièces avec le monde de la grande symphonie, Petrenko nous invite aux deux exercices opposés, la concentration et la rentrée en soi, et l’exaltation, la respiration vers l’univers et vers les autres.
Évidemment, un orchestre pareil se prête à ce type de musique, qui s’appuie beaucoup sur les bois qui à Berlin sont à eux seuls un ensemble presque compact fait de magnifiques solistes (pas un seul orchestre n’a un ensemble de bois pareils et on l’entendra aussi dans l’adagio de la Neuvième) et ces pièces conviennent à un chef dont on loue la clarté, le souci du détail (aucun détail ne lui échappe) la précision, et qui est un révélateur, par le détail, d’une totalité (à laquelle il manque cependant les mots de Geschwitz, laissés ici à la musique seule).
Ainsi cette Lulu Suite est-t-elle d’emblée une mer aux mille reflets (on se souvient de sa Lulu munichoise en 2015) du pessimisme le plus noir à l’énergie et à la chatoyance de l’ostinato à laquelle s’ajoute l’intervention de Marlis Petersen, profondément ressentie, sensible et tragique. L’intelligence du texte, le sens du phrasé et des mots, tout donne le frisson dans la courte pièce qui à elle seul colore l’ensemble du morceau. C’est peut-être dans Berg (et Schönberg aussi) que Petrenko est le plus lyrique et le plus engagé. Il y met de la tension, et moins d’énergie que de la tendresse désespérée. En plus, programmant Berg et Beethoven, il donne comme les limites actuelles de son répertoire de prédilection, du début du XIXe au XXe (il a dirigé et avec quel brio Die Soldaten.) Peu d’incursions dans le XVIIIe (il faudra bien pourtant) et quelques terres encore un peu en friche (Brahms). Prenons donc le programme du concert comme un concert-signe, où se construit une manière de sémiologie de Petrenko… Car connaître un chef, c’est aussi apprendre de ses programmes : suivre Abbado pendant trente ans fut une belle université à cet égard.
La Lulu Suite, qui forcément n’a pas déchaîné les enthousiasmes d’un public venu pour la 9ème et subissant avec un digne stoïcisme les reflets argentés d’un Berg diffracté et incroyablement coloré qui rendait déjà le moment exceptionnel, avec des cordes (les pizzicati!) à se pâmer (et le hautbois ! et la clarinette!). Et au total applaudissements chaleureux.
La Neuvième
On venait pour la Neuvième, un moment d’exception en soi, indépendamment du lieu, de l’orchestre et du chef. A fortiori avec cet orchestre et son Chefdirigent, tout frais qui a déclaré au préalable pour justifier son choix : "Je me suis toujours imaginé que si on envoyait un message aux planètes lointaines en voulant y incorporer toute notre humanité en tant qu'individus et en tant que société – la société avec tous ses aspects positifs et négatifs, aussi bien avec ses fantastiques espaces de culture qu’avec les choses les plus horribles que nous avons faites dans le passé, si on voulait tout décrire, on ne trouverait pas meilleure description que la Neuvième Symphonie de Beethoven."
Il s’agit donc bien d’une volonté d’exprimer d’abord notre humanité contrastée et déchirée, mais merveilleuse aussi, nos drames et nos espérances, cette humanité qu’un Beethoven si marqué par les Lumières a toujours voulu exprimer.

Petrenko a déjà cette année (en avril) dirigé la Neuvième avec l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia (voir le lien vers notre compte rendu ci-dessous), avec les mêmes présupposés : il y a chez Beethoven, comme chez bien des artistes et intellectuels de sa génération une profonde marque illuministe. Tous ont vécu bonne partie de leur vie au XVIIIe. On associe Beethoven au XIXe mais il naît en 1770 (comme Hegel qui meurt en 1831), Goethe né en 1749 meurt en 1832, et Schiller né en 1759 meurt en 1805. Ce sont tous d’abord des hommes issus des débats, de la culture et du monde intellectuel du XVIIIe siècle. Si Hegel ne parle jamais de Beethoven, en revanche on a souvent tissé des liens profonds dans les visions respectives des deux hommes.
Du côté français, un romancier comme Stendhal, né en 1783, est profondément marqué par le monde des Lumières et la Révolution, presque un successeur de Rousseau. Tous ces éléments ne dépendent pas d’une chronologie étroite, mais plutôt d’un ensemble de constructions culturelles que nos catégories scolaires trop cloisonnées éludent souvent.
Ainsi, cette Neuvième, avec le texte de Schiller qui la conclut, et qui obséda Beethoven, grand admirateur de Schiller et des valeurs qu’il représentait, procède d’un esprit illuministe, d’une sorte d’énergie vitale prérévolutionnaire (l’Ode de Schiller date de 1785, et Beethoven l’a connue en 1792). On a souvent tendance à regarder la suite des événements et jamais les origines, on ne dirigera évidemment pas l’œuvre de la même façon à l’éclairage du symphonisme romantique du XIXe ou en considérant ses sources illuministes.
Kirill Petrenko prend une direction résolument révolutionnaire au sens historique du terme : cette interprétation pleine d’énergie, si vive voire dramatique au départ, assez rêche même, va vers la lumière finale de l’Ode schillérienne, en passant par des états différents, drame, tension, apaisement, nostalgie, en une vision globalisante, presque cosmique, avec un tempo très soutenu, souvent rapide qui tranche avec beaucoup de visions d’autres chefs. Et ce qui est précieux c’est la cohérence de vision, l’homogénéité sonore du début à la fin, qui donne un ton unique développant diverses modalités.
Il n’y a pas dans l’approche de Petrenko une relation si forte à une histoire de l’interprétation, une intertextualité, sinon peut-être ce regard un plus appuyé vers le baroque que vers le romantisme : le résultat est livré tel que, brut, en une lecture de la partition qui privilégie des valeurs développées au siècle précédent, sans en adopter vraiment les formes. Il joue avec un effectif normal (pas aussi réduit que l’Abbado dernière manière), le son produit ne tient pas compte des évolutions de l’interprétation (Abbado avait beaucoup étudié le travail d’Harnoncourt, un Rattle était bien plus marqué par le XVIIIe dont il est un bel interprète) Petrenko va son chemin avec son Beethoven, qui n’a pas les ivresses sonores d’un Karajan, qui n’a pas les délicatesses d’un Abbado, qui n’a pas la valeur prophétique d’un Furtwängler ni le classicisme d’un Thielemann, mais qui a un sens profond pour les temps troublés que nous traversons et affirmer cela Porte de Brandebourg est essentiel, avec un orchestre composé de 28 nationalités, et un chef juif russe, qui a affirmé nettement ses intentions de servir le grand répertoire de la tradition allemande et autrichienne, non pas comme répertoire d’une identité nationale étroite, mais au contraire un répertoire qui appartient de droit à l’humanité dans son ensemble.
Il n’y a pas pour l’instant de style Petrenko, il nous livre une lecture, en la travaillant avec un instrument aux mille feux appelé Berliner Philharmoniker, il s’agit d’une lecture à l’image de son propre personnage directe, simple, sans fioritures ni concessions et sans maniérismes : un Beethoven étonnamment jeune, qui respire le désir d’avenir, qui respire l’espace, qui respire aussi les contradictions. En 1824, à la création, le monde est à peine sorti des guerres napoléoniennes, le congrès de Vienne a redessiné une Europe de la paix, mais c’est une Europe de la Realpolitik et non plus des idéaux, l’art de Beethoven consiste à retourner vers la/les Lumière(s).
C’est un caractère fréquent du travail de Petrenko de n’être relié à aucun autre, même s’il peut rappeler par certains aspects Carlos Kleiber, mais justement, Kleiber était un de ces chefs irréductibles à un style, en permanence dans l’hic et nunc. Petrenko a déclaré que si l’orchestre a à chaque fois gagné en profondeur et en vision avec chaque nouveau chef, il a le désir « de créer son propre son, son propre monde philharmonique » et donc lui aussi de laisser sa marque et d'assumer pleinement son rôle.
Ainsi les deux premiers mouvements, sont-ils les plus tendus et les plus « durs », au sens où il n’y a aucune concession vers le tendre, le joli, le décoratif : nous sommes au centre du débat et même quelquefois au bord de la rupture. Et l’enjeu symbolique est énorme. Il y a donc l’énergie, la force, mais aussi la clarté de l’exécution qui laisse comme toujours rêveur. Le geste de Petrenko est net, sans bavure, et très démonstratif : lui qu’on dit si timide a sur le podium une force évocatoire par son corps assez étonnante, il s’arrête quelquefois et écoute l’orchestre sans un geste, à d’autres moments il danse, donnant un étonnant spectacle qui n’est pas du tout fait pour la galerie, mais qui est un langage global du corps pour que toutes les intentions passent. Un travail rythmé dans le scherzo par la timbale très forte, presque d’apocalypse, si forte qu’on n’a pas toujours l’occasion de l’entendre ainsi (mais on sait combien Petrenko met souvent les timbales en valeur et en position particulièrement spectaculaire). Mais ce sont les solistes regroupés, cor (Stefan Dohr, une légende), clarinette (Andreas Ottensamer), hautbois (Albrecht Mayer), flûte (Emmanuel Pahud), cor anglais (Dominik Wollenweber )et le magnifique basson (Stefan Schweigert) qui comme souvent ont le plus stupéfié à l'audition.
Cet ensemble exceptionnel va dans l’adagio donner encore une preuve supplémentaire de sa cohésion : Petrenko les a placés comme s’ils composaient à eux seuls un ensemble, un îlot, de chambre, en écho les violons d’une rare légèreté donnaient une suavité rare, mais malgré sa légèreté et sa douceur, le son est toujours resté clair, net presque affirmé où l’on entendait chaque niveau (cor stupéfiant de Stefan Dohr). Ce dialogue entre cordes et bois d’une rare fluidité, d’un rare naturel rappelle la Pastorale, dans un mouvement dont la douceur, voire la tendresse, prépare en contraste au dernier moment et à son entrée spectaculaire. C’est sans doute le moment « suspendu » le plus émouvant avec des instants à pleurer.
Le dernier mouvement est caractéristique du travail sur les volumes souvent effectué par Kirill Petrenko, qui réalise l’exploit d’accumuler une incroyable énergie sans jamais faire jouer trop fort, on l’avait remarqué dans sa Huitième de Mahler à Bregenz : il y a un art de la maîtrise des volumes qui laisse toujours l’auditeur étonné car le son n’écrase jamais, n’envahit jamais totalement l’espace à en devenir trop envahissant. Mais il montre aussi un art des contrastes assez consommé. Le début du dernier mouvement, scandé par les cordes (les violoncelles…) et les percussions, est impressionnant, mais scandé aussi par des silences entre les différents moments, des silences marqués que Petrenko ménage souvent, autre caractère de ses approches symphoniques. Le rôle du silence est théâtral, parfaitement dramaturgique,. Singulière aussi la retenue des cordes graves (violoncelles et contrebasses stupéfiantes) puis leur crescendo dans la première émission du thème, reprise par un entrelacs improbable de cordes et de bois, pour finir en un tutti jamais écrasant. Tout est presque dansant et rythmé, toujours fluide sans jamais être lisse, avec une couleur évidemment plus optimiste (flûte…).
L’attaque de la basse (Kwangchul Youn) n’a pas été aussi parfaite qu’on aurait pu attendre, et le chanteur semblait un peu fatigué : il est vrai que cette attaque à froid est très difficile, mais la voix manquait de la souplesse voulue. Les parties solistes de la Neuvième sont souvent courtes, mais très tendues et difficiles (L'écriture vocale de Beethoven est toujours problématique). Benjamin Bruns a fait entendre sa voix claire et contrôlée de ténor au phrasé parfait. On a eu plaisir à retrouver la trop rare Elisabeth Kulman, au grave si velouté et à la magnifique musicalité et Marlis Petersen, qui sera artiste en résidence en cette saison 2019–2020 à Berlin, faisait entendre un aigu tendu flirtant avec les anges, et qui s’alliait parfaitement avec les autres voix d’un quatuor où Petrenko a voulu (comme à Rome d’ailleurs) des voix moins lourdes (presque mozartiennes) que celles que l’on peut entendre quelquefois , plus souples qui s’allient par leur fluidité à celles de l’orchestre.
Le Rundfunkchor Berlin, préparé par Gijs Leenars, un des très grands chœurs allemands, doué d’un incroyable phrasé, d’un engagement sans failles, a fait montre d’une profonde concentration et d'une présence urgente, même si on aurait aimé peut-être plus de chaleur encore. Mais quelle démonstration !
Ce fut en effet une démonstration d’un niveau d’exécution rare, et d’une vision nouvelle, appelée sans doute à évoluer, au fur et à mesure que Petrenko reviendra avec son orchestre sur l’œuvre et à mesure que "le couple" se connaîtra mieux. À ce concert stupéfiant et mémorable manquait en effet peut-être seulement un peu de « laisser aller », un peu de cette chaleur que nous avions ressentie à Rome. Le chœur de Santa Cecilia avait fait montre d’un engagement qui avait totalement tourneboulé la salle, et l’orchestre avait joué – sans la technicité consommée des Berliner peut-être – comme dédié, complètement livré aux mains du chef et cela avait offert un concert où la chaleur humaine, fraternelle se sentait peut-être plus (le coup de foudre dont on parlait au début de ce texte): Petrenko avait d’ailleurs serré dans ses bras le premier violon, ce qu'il fait très rarement. Nous avons eu une fête de l’esprit humain à Lucerne, et à Rome celle du cœur humain. Mais c’était la fête des deux côtés. Une belle aventure commence. À suivre.

