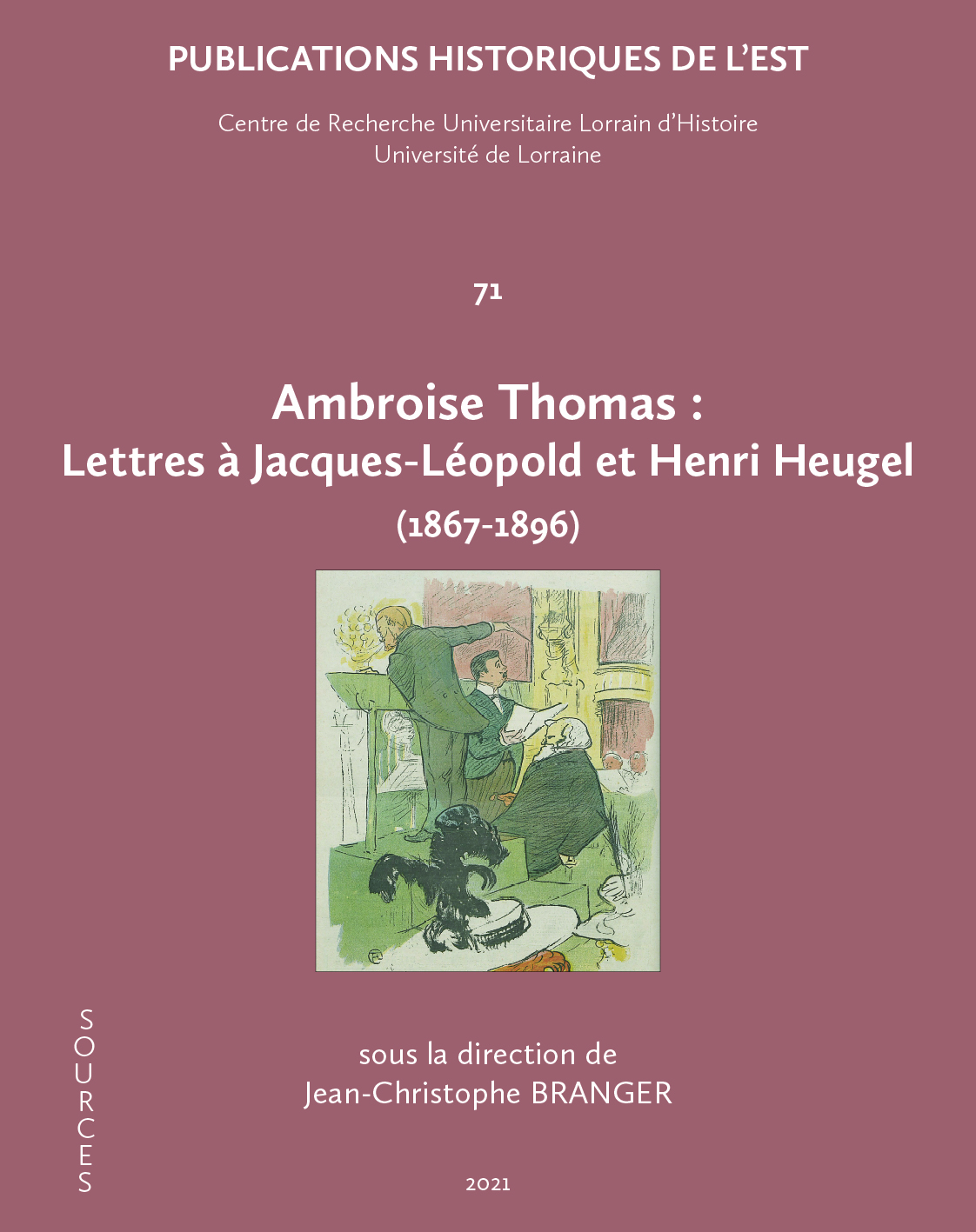
Longtemps voué aux gémonies, ou tout simplement à l’oubli, Ambroise Thomas connaît depuis quelque temps un retour en force, grâce à son Hamlet (1868) qui offre aux barytons un superbe rôle de premier plan et aux sopranos coloratures une scène de folie encore plus développée que celle des héroïnes donizettiennes. Pour Mignon (1856), en revanche, le combat ne fait que commencer, alors que cet opéra-comique remporta en son temps un triomphe planétaire qui rendit partout célèbre le nom d’Ambroise Thomas. A ces deux titres de gloire s’ajoutait jadis une poignée d’autres œuvres scéniques à succès, dont Le Caïd et Le Songe d’une nuit d’été ; la pandémie nous a privés par deux fois de la résurrection de Psyché, prévue par le Palazzetto Bru Zane une première fois en concert en juin 2020, repoussée à l’automne et à nouveau annulée sans même que l’enregistrement prévu ait pu être réalisé.
Au terme d’une carrière chargée d’honneurs (directeur du Conservatoire, auteur d’un arrangement de La Marseillaise qui fut joué jusqu’en 1974), Thomas conçut un ultime grand opéra. Après Shakespeare et Goethe, c’est Dante qui fut mis à contribution, et Françoise de Rimini, sans doute achevé dès 1879, fut finalement créé en avril 1882 à l’Opéra de Paris. Après l’échec de cet ultime opus lyrique, il ne composa plus guère que le ballet La Tempête – retour à Shakespeare – donné en 1889. A sa mort en 1896, Ambroise Thomas pouvait certes se targuer d’avoir à son actif deux des opéras français les plus populaires au monde, mais les signes d’une désaffection durable commençaient déjà à se manifester.
S’il fut le premier à user généreusement du saxophone à l’opéra, s’il maîtrisait avec finesse l’art de l’orchestration, Thomas n’avait rien d’un novateur, et on le classerait aujourd’hui parmi les talents plutôt que parmi les génies. Néanmoins, sa place dans l’histoire de l’art lyrique français mérite au moins que l’on se penche sur son cas, et la maigreur de la bibliographie récente à son sujet rend d’autant plus intéressant le volume qui vient de faire paraître le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (Thomas était né à Metz en 1811). Professeur à l’université Lyon II, spécialiste de Massenet, Jean-Christophe Branger a dirigé ce volume et signé une introduction faisant le point sur le personnage. Bien que son titre mette en avant la correspondance acquise en 2011 par la BnF, le volume se divise en deux parties inégales par la longueur : les 60 premières pages sont en effet consacrées aux lettres adressées par Ambroise Thomas à ses éditeurs, les Heugel père et fils, entre 1867 et 1896, une forte majorité desdits messages ayant été échangés entre 1878 et 1883, autrement pendant la genèse de Françoise de Rimini. Les 125 pages suivantes, soit les deux tiers de l’ouvrage, prennent la forme d’un dossier de presse concernant cette ultime création lyrique.
Les lettres, d’abord, qui sont au nombre de 94, donc un certain nombre de messages très brefs. Dans cette correspondance scrupuleusement annotée pour identifier tous les individus mentionnés, on découvre évidemment tout un tas de détails triviaux qui faisaient le quotidien d’un compositeur vieillissant, les menues indispositions de Madame Thomas ou du maître en personne. « Je vous renvoie votre parapluie », écrit-il à un Heugel non identifié, un dimanche matin de mai ou juin 1883. « Vous aurez votre baignoire » (à l’opéra), confirme-t-il à une date non précisée. A son éditeur il envoie « Quelques petits chœurs, romances, chansonnettes, pouvant servir pour une séance donnée dans un pensionnat de jeunes filles, devant un auditoire choisi ». Déjà plus palpitant, les innombrables rendez-vous accordé à des artistes afin de les auditionner et de déterminer s’ils seront aptes à tenir un rôle dans une des œuvres d’Ambroise Thomas. En 1888, « nous n’avons vraiment pas de chance avec nos Ophélies ! » s’exclame le compositeur, qui n’a pas toujours l’avantage d’être défendu par mesdames Nilsson ou Calvé. On le voit en 1885 préparer une nouvelle version du Songe d’une nuit d’été, où Falstaff doit être repris par Victor Maurel, qui n’a évidemment pas encore créé celui de Verdi. Surtout, cette correspondance inclut aussi des courriers émanant de Barbier, le librettiste de Françoise de Rimini, qui ne manque pas une occasion de débiner son défunt collaborateur Carré : « il semblait en venir vers la fin de sa vie à ne plus se douter de ce que c’était une action dramatique. […] Quand il n’était pas tenu en bride par un collaborateur entêté et convaincu comme moi, il se laissait aller volontiers à cet art facile qui ne coûtait aucun effort à son imagination ». Et Thomas a bien du mal à trouver les interprètes adéquats pour ce qui aurait dû être son ultime chef‑d’œuvre : Vaucorbeil, alors directeur de l’Opéra de Paris, semblait disposé à faire un pont d’or à Christine Nilsson pour qu’elle incarne Françoise, et le ténor espagnol Julián Gayarre, créateur d’Enzo dans La Gioconda fut un moment pressenti pour Paolo (curieusement, dans le livret de Barbier, tous les personnages masculins ont gardé leur prénom italien, seule l’héroïne étant francisée). Peut-être de guerre lasse, c’est à une relative débutante que fut confié le rôle-titre, Caroline Salla, partie faire carrière en Russie après être apparue en 1877 lors de la création du Timbre d’argent de Saint-Saëns. Autour d’elle seront réunis le ténor Henri Sellier, premier Radamès français et le baryton Jean Lassalle, qui avait déjà derrière lui une belle liste de créations (Le Roi de Lahore, Polyeucte, Le Tribut de Zamora…).
On passe ensuite au « dossier de presse parisienne », qui réunit une trentaine d’articles – la transcription par les étudiants en musicologie messins n’est hélas pas toujours exempte de coquilles –, dont plusieurs dus à d’autres compositeurs qui exerçaient aussi le métier de critique musical : … Evidemment, ceux de ces messieurs qui avaient été les élèves d’Ambroise Thomas se montrent beaucoup plus enthousiastes et élogieux que d’autres. Néanmoins, tous ou presque s’en prennent au livret, pour des raisons diverses : pour tirer des 70 vers de Dante un opéra en quatre actes, un épilogue et un prologue, Barbier a forcément dû délayer, concocter une « sauce aux cornichons » pour diluer Dante, là où il n’y avait guère qu’un sujet de cantate, « et l’admirable labeur d’un maître tel que M. Thomas ne pouvait jamais tendre qu’à l’application de chairs vives sur un maigre squelette » (Le Voltaire, 16 avril 1882). Sur ce livret jugé artificiel et mal ficeler, Thomas n’aura pu que composer une musique hétérogène, faire du remplissage en « tournant à tous les vents », donnant un peu dans le style moderne pour le prologue (le passage généralement le plus admiré, qui fut donné plusieurs fois en concert), revenant au Verdi du Trouvère dans le reste de cet opéra à numéros séparés, « nous ramenant même au-delà des Huguenots et de Guillaume Tell » (La Renaissance Musicale, 23 avril 1882). Françoise de Rimini a été remonté à Metz en 2011, mais cette reprise est restée sans lendemain, ce qui rend d’autant plus difficile de contester le verdict selon lequel Ambroise Thomas ne faisait « que de la petite musique en grand » (Le Gaulois, 17 avril 1882). Puisse ce volume stimuler la curiosité qu’il peut légitimement inspirer aujourd’hui.
