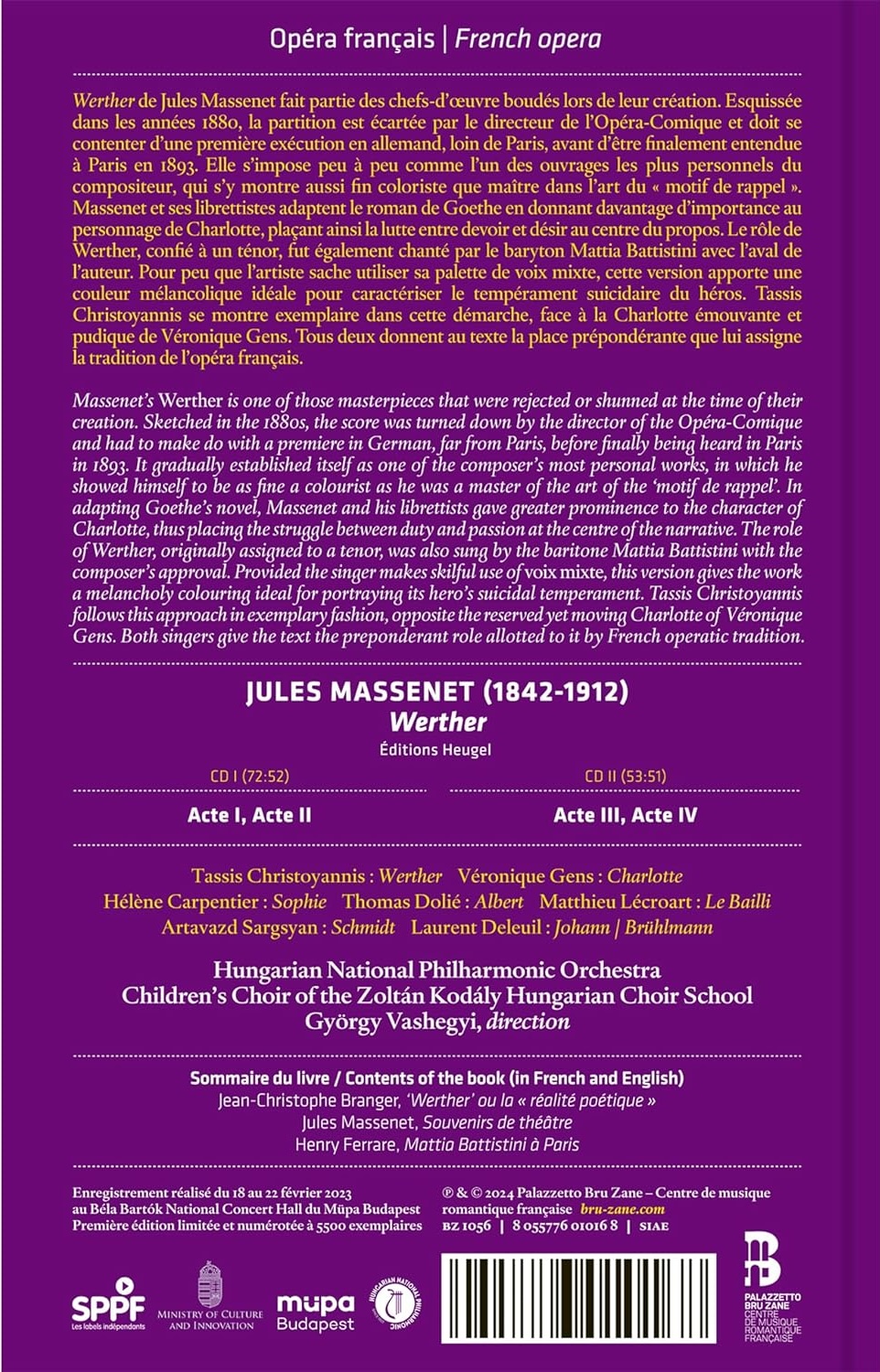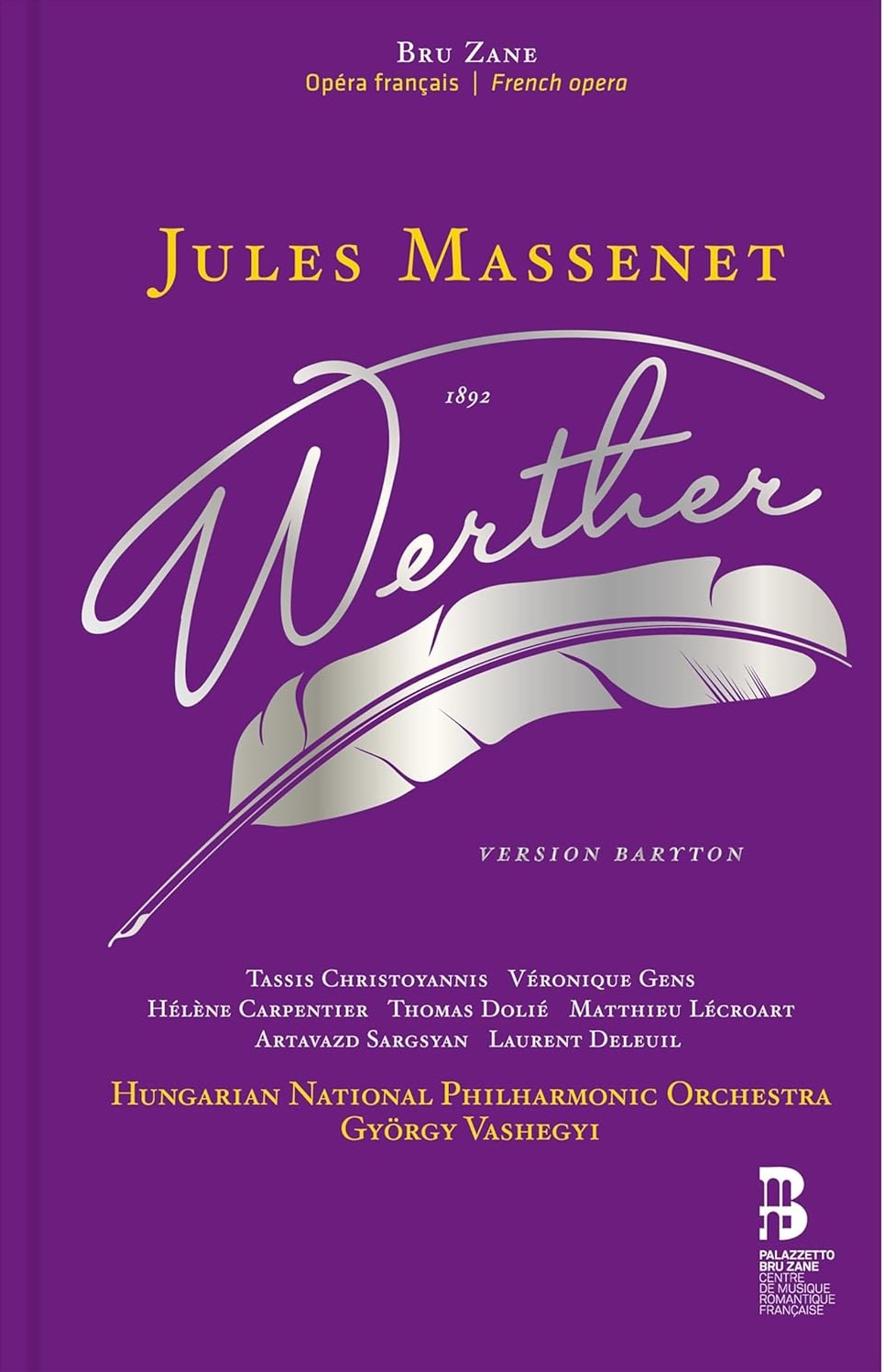 Des personnages d’opéra dont la couleur de voix change entre la première idée du compositeur et la première représentation, on en connaît, et non des moindres. L’exemple classique reste bien sûr Pelléas, pour lequel Debussy semble avoir plutôt songé à un ténor, mais dont la création fut confiée en 1902 à Jean Périer, qui serait une dizaine d’années plus tard le Muletier dans L’Heure espagnole ou Marouf dans l’opéra-comique de Rabaud. Notre époque férue de versions alternatives nous en a récemment révélé plusieurs autres. A l’été 2022, John Osborn chanta à Montpellier Hamlet dans sa version première, pour ténor, Ambroise Thomas ayant ensuite modifié la tessiture pour l’adapter à la voix du baryton Faure. A la Komische Oper de Berlin, Barrie Kosky monta en 2015 une production des Contes d’Hoffmann qui, se fondant sur les nombreux brouillons laissés par Offenbach à sa mort, confiait le personnage principal à un baryton pour le prologue et le premier acte, à un ténor pour la suite.
Des personnages d’opéra dont la couleur de voix change entre la première idée du compositeur et la première représentation, on en connaît, et non des moindres. L’exemple classique reste bien sûr Pelléas, pour lequel Debussy semble avoir plutôt songé à un ténor, mais dont la création fut confiée en 1902 à Jean Périer, qui serait une dizaine d’années plus tard le Muletier dans L’Heure espagnole ou Marouf dans l’opéra-comique de Rabaud. Notre époque férue de versions alternatives nous en a récemment révélé plusieurs autres. A l’été 2022, John Osborn chanta à Montpellier Hamlet dans sa version première, pour ténor, Ambroise Thomas ayant ensuite modifié la tessiture pour l’adapter à la voix du baryton Faure. A la Komische Oper de Berlin, Barrie Kosky monta en 2015 une production des Contes d’Hoffmann qui, se fondant sur les nombreux brouillons laissés par Offenbach à sa mort, confiait le personnage principal à un baryton pour le prologue et le premier acte, à un ténor pour la suite.
Depuis un peu plus longtemps maintenant, on croyait savoir que Massenet avait arrangé une version de Werther pour baryton, à l’intention de Mattia Battistini. Tout comme il avait fallu jadis des stars du calibre de Joan Sutherland ou de Frederica Von Stade pour redonner vie à Esclarmonde ou à Chérubin, il fallut un Thomas Hampson pour que l’on redonne, au moins en concert, ce Werther différent. Une captation réalisée au Châtelet en 2004 en témoignait, sans que la tentative ait véritablement suscité un nouvel engouement pour cette version sans ténors.
Le Palazzetto Bru Zane ayant décidé, avec raison, de changer tout cela, un premier enregistrement au disque paraît donc ce 25 mai (seul un DVD du concert Hampson avait été commercialisé). Et l’on apprend que ce n’est pas pour Battistini, mais pour Victor Maurel que Massenet avait adapté sa partition. Quoi, Maurel, le premier Falstaff de Verdi ? Comment réconcilier le pancione pour qui « tutto nel mondo è burla » et le poète romantique suicidaire ? Magie du théâtre bien sûr, qui permet au même interprète d’aborder les personnages les plus radicalement opposés, et l’on se souviendra d’une photographie de Maurel en Iago, rôle pour lequel il dut manifestement se raser la barbe – le sacrifice n’avait rien d’évident dans les années 1890 – et où on le voit aussi élancé qu’il apparaît (faussement) ventru sur les images datant de la première de Falstaff. Et à l’écoute de cette nouvelle intégrale de Werther, que tant d’autres ont précédée, confiées aux plus prestigieux artistes du circuit international, on commence à comprendre que l’option peut être valide, dès lors que le jeune héros n’est plus un Don Giovanni qui roule des mécaniques, mais un baryton qui nous fait croire dès ses premiers mots à la fragilité du personnage.
Excellent choix, en effet, que celui de Tassis Christoyannis pour incarner ce Werther baryton. Lui qui vient justement d’incarner Falstaff dans une belle production à l’Opéra de Lille, lui qui a déjà eu l’occasion de prouver à de nombreuses reprises sa familiarité avec le répertoire français du XIXe siècle, grâce aux divers rôles qui lui ont été confiés dans les résurrections menées par le Palazzetto Bru Zane, le voilà qui se révèle un Werther étonnamment juvénile, grâce à ses aigus lumineux et à son interprétation frémissante du héros de Goethe. La voix qu’on entend ici n’est ni celle d’un père verdien, ni celle d’un méchant donizettien, mais bien le personnage tel que Massenet et ses librettistes ont pu l’imaginer. Et même ces airs modifiés, qui paraissaient si étrangement rapetassés lorsque Thomas Hampson les chantait, Tassis Christoyannis a l’art de nous les faire accepter comme s’ils étaient venus tels quels, au lieu de résulter d’une manipulation a posteriori.
Face à ce Werther, une Charlotte tout aussi inattendue, puisque Véronique Gens n’avait, sauf erreur, pas encore abordé le rôle. Mais pour elle non plus, ce n’est pas la première fois que le PBZ lui confie des personnages auxquels elle n’aurait sans doute jamais songé (Marguerite du Faust de Gounod, notamment), et il se trouve que Charlotte convient bien à la couleur sombre de sa voix et à une certaine pudeur dans l’incarnation. L’air des Lettres, puis celui des Larmes, trouvent en elle une interprète sur mesure.
Outre ce couple qui rompt avec les pratiques ordinaires des théâtres (si Werther n’est plus ténor, Charlotte n’est plus mezzo), la distribution s’autorise un choix aussi déconcertant a priori en ce qui concerne Sophie. Hélène Carpentier nous transporte à cent lieues des sopranos coloratures, de ces voix ultra-légères auxquelles échoit d’ordinaire ce rôle un peu tête-à-claques. La petite sœur acquiert une maturité inhabituelle qui ne lui va pas mal du tout, et se situe ainsi plus près de Charlotte que du reste de la tribu des enfants du bailli. On serait curieux de connaître la version où Albert serait devenu ténor, pour des raisons d’équilibre vocal et d’ « emplois » dans les théâtres, mais on s’en console avec un Albert aussi somptueux que Thomas Dolié.
Loin des seconds couteaux auxquels le spectateur est parfois condamné, Artavazd Sargsyan et Laurent Deleuil confèrent à Schmidt et Johann une réelle tenue (au baryton canadien revient le « Klopstock » de Brühlmann, mais rien ne précise qui lui donne, en Kätchen, l’unique réplique « Divin Klopstock »), et Matthieu Lécroart est un bailli totalement crédible – quel dommage qu’il ne revienne pas après le premier acte. Evidemment, les enfants ont un petit accent hongrois, puisque l’on n’a pas poussé le luxe jusqu’à faire venir de France une maîtrise pour leur chant de Noël. Mais ce n’est qu’un détail, alors que la direction de Györgyi Vashegyi trouve, comme dans la tragédie lyrique, un juste équilibre entre les versions qui accentuent par trop le romantisme de certains moments, l’ouverture notamment, et celles qui s’assoupissent dans d’interminables langueurs, en particulier au dernier tableau. Un enregistrement qui est donc mieux qu’une simple curiosité, puisqu’il prouve la validité d’une version qui pourrait tenter plus d’un théâtre, les ténors étant toujours rares (et chers).