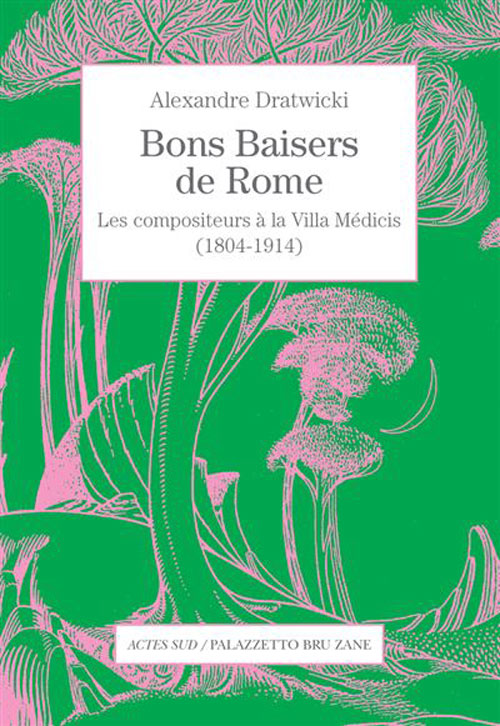
Bons baisers de Rome, qui vient de paraître, comble ce qui pouvait apparaître comme une lacune, en décrivant l’activité (ou l’inactivité) des heureux lauréats accueillis par la Villa Médicis, après leur accès au premier rang du podium, et avant leur retour au pays natal. Curieusement, en effet, très peu d’études sérieuses ont été consacrées au quotidien des pensionnaires romains, et à peu près aucune ne se focalisait jusqu’ici sur les compositeurs. Le contenu du livre ne se limite d’ailleurs pas à ce seul aspect et, comme on pouvait s’y attendre, il s’attarde aussi sur des questions plus strictement artistiques, s’appuyant sur la correspondance des pensionnaires et sur leurs mémoires, ainsi que sur les abondantes archives conservées tant à Rome qu’à Paris. Et cette fois, Alexandre Dratwicki est seul maître à bord, et le directeur artistique du Palazzetto Bru Zane est l’auteur des 600 et quelques pages que compte ce nouveau livre.
Les bornes temporelles retenues sont différentes, et cela s’explique aisément. Certes, c’est en 1803 que le concours du Prix de Rome s’ouvrit à une discipline supplémentaire, la musique (ledit concours existait pourtant depuis 1666). Il y eut un seul candidat, il fut récompensé, et il fallut alors improviser comment il serait reçu en Italie. Et c’est seulement en 1804 qu’Albert-Auguste Androt arriva à Rome. Ne vous étonnez pas si vous n’avez jamais entendu le nom de ce personnage : le lauréat ne put tenir aucune de ses promesses car il trépassa dès le mois d’août de la même année, d’avoir bu l’eau du Tibre. Malgré ce possible suicide dû à des peines de cœur, Androt fut inhumé à Saint-Louis-des-Français, paroisse naturelle des envoyés de l’Académie. Quant à l’année 1914, elle marque une rupture non seulement dans l’histoire mondiale, mais aussi dans celle de la Villa Médicis, qui fut fermée, le concours étant annulé de 1915 à 1918 ; « Règlements administratifs et préoccupations artistiques sont à ce point remis en cause dans les années 1920 qu’il serait difficile d’interroger avec pertinence l’avant et l’après 1914 selon les mêmes problématiques », explique Alexandre Dratwicki.
Le séjour à Rome devait d’abord se mériter, par un voyage souvent pénible avant l’arrivée du chemin de fer : plusieurs pensionnaires se souviendront ainsi de leur trajet depuis Marseille en voiturin, véhicule qui ne sert donc pas qu’à transporter les phynances du père Ubu. Un bizutage les attendait aussi aux abords de la ville éternelle et dès leurs premiers pas sur le Pincio. On savourera le sous-chapitre délicieusement intitulé « Les pensionnaires et la vertu », occasion d’évoquer la longue absence – officielle, du moins – de femmes à la Villa Médicis, en dehors de l’épouse et des filles éventuelles du directeur (celle d’Horace Vernet, directeur de 1829 à 1834, semble en avoir fasciné plus d’un). Alors que la musique à Rome se réduit aux castrats de la chapelle Sixtine et à un opéra en pleine dégénérescence, les salons mondains servent de bouée de sauvetage, à commencer par celui du directeur, du moins lorsqu’il aime la musique : il est intéressant que Gounod, parlant d’Ingres, directeur de 1834 à 1841, nous dise que Don Giovanni était « sa passion dominante », formule qui rappelle furieusement « sua passion predominante » dans l’air du Catalogue… Heureusement, une bibliothèque peu à peu enrichie par des dons permettait aux pensionnaires de compléter leur éducation, en étudiant tantôt les illustres anciens qu’on ne jouait plus guère, Lully ou Rameau, dont ils sont encouragés à réaliser des transcriptions modernisées à titre d’exercice, ou les illustres contemporains qu’on leur offre comme modèle, Saint-Saëns par exemple ; les partitions les plus empruntées à la fin du XIXe siècle sont celles de Wagner, dont l’Académie, dans ses rapports, ne cesse pourtant de dénoncer l’influence néfaste sur les compositions des jeunes exilés.
Car ce n’est pas au pays de cocagne qu’on envoie les lauréats : les règlements successifs – on en dénombre une dizaine de versions durant la période qu’embrasse le volume – stipulent très précisément le nombre et la nature des travaux que l’on attendus, ces « envois de Rome » qui se révélaient souvent bien problématiques. Un seul compositeur semble avoir respecté scrupuleusement les exigences dans ce domaine, un certain Auguste Blondeau, Premier Prix en 1808. Alors que l’accent était initialement mis sur la seule musique vocale, qu’elle soit profane ou sacrée, française ou italienne, les envois de Rome s’ouvrirent bientôt à la musique symphonique, et très tard (en 1894) à la musique de chambre. C’est seulement dans le dernier quart du XIXe siècle que l’Académie décida de donner à entendre ces morceaux, acheminés jusqu’à Paris non sans difficultés, et qui faisaient l’objet de rapports aussi sévères qu’ambigus : il ne fallait pas copier les classiques, mais trop de modernité était inacceptable, la « vérité » était jugée préférable à la tradition, et l’individualité à la facilité.
Evidemment, sur un peu plus d’un siècle, diverses modes musicales eurent le temps d’influencer les jeunes lauréats : le style néo-palestrinien à partir des années 1840, le wagnérisme dans le dernier tiers du siècle. Florent Schmitt fut voué aux gémonies pour son Psaume XLVII beaucoup trop audacieux, et l’on comprend que plusieurs pensionnaires aient préféré démissionner, comme ce fut le cas d’André Caplet. Quant aux genres pratiqués pour les envois de Rome, les messes eurent d’abord la préférence, remplacées à partir de 1870 par l’oratorio, bien que l’Académie n’ait jamais vraiment défini ce « style religieux » qu’elle attendait des pensionnaires. Autre formule des plus vagues, un orchestre « sobre et clair » était exigé. Dans les tentatives d’opéra, le soin de la prosodie était particulièrement apprécié, mais plus d’un jeune compositeur se vit reprocher, au début du XXe siècle, d’abandonner le lyrisme mélodique au profit d’une austère déclamation. Primé en 1871, Gaston Serpette aura du mal à faire accepter par l’Institut son goût pour l’opérette.
De leur séjour en Italie, plusieurs pensionnaires rapportent des œuvres pittoresques, musiques à programme évoquant la lumière et les fêtes de la péninsule. Le séjour romain était néanmoins parfois perçu comme une coupure gênante, qui privait les jeunes compositeurs des contacts qu’ils avaient déjà pu nouer à Paris, qui les envoyait dans une ville fort peu musicale, contrairement à Venise ou Naples, où ils furent beaucoup à s’ennuyer et qu’ils tentèrent souvent de fuir, alors que tout retour à Paris leur était censément interdit. De fait, dès 1903, pour le centenaire du Prix de Rome musical, des voix s’étaient élevées pour en contester l’organisation, d’autant que plus d’un lauréat peinait ensuite à faire jouer ses œuvres, l’Etat n’ayant jamais mis en place de politique de commande à même de les soutenir.
Voilà tout ce que nous fait découvrir Alexandre Dratwicki dans ce volume richement illustré de savoureuses caricatures réalisées par les pensionnaires eux-mêmes et de photographies d’époque. Plusieurs annexes complètent le texte (liste des musiciens pensionnaires, liste de leurs envois, relevé de leurs emprunts à la bibliothèque de la Villa Médicis et programme des concerts donnés lors des séances publiques de l’Académie des beaux-arts), ainsi qu’une bibliographie et un index. De quoi faire de ce volume une référence.

