C’est que le Poche impose en principe ses conditions à l’action et à la conception, limitant le mouvement, sa vitesse comme son amplitude, le nombre, l’engagement dans une certaine mesure. Mais en optant pour une version entièrement théâtrale, mobile, où les personnages interagissent, Stéphan Druet réussit un pari risqué – au risque, donc, de la saturation visuelle et, aussi, du surinvestissement du texte parlé et musical. On a entendu des interprétations convaincantes de l’Histoire du Soldat qui, le plus souvent, se limitent à une récitation, éventuellement polyphonique, mais statique, tirant vers l’oratorio avec narration. La dimension bouffe, et de théâtre ambulant est ici rendue, et rendue en entier, en accord avec la lettre du texte et la tradition la plus ancienne, remontant aux premières exécutions (il ne manque pour cela que la doublure dansante du Diable, qui est cependant presque assurée par le jeu de Licinio Da Silva). Pour cela, l’imagination ne lésine pas, sans donner le décalage gratuit : l’orchestre entre en uniforme, chef compris, au pas cadencé, et se place en rang avant de commencer à jouer. Un membre en sort, c’est le Soldat, avec son petit violon. Il est sorti de l'orchestre, il est sorti de la vie, qui se déroulera en se jouant de lui. La troupe musicale continuera avec parcimonie d’être sollicitée (ici, le chef, là, la percussionniste) pour s’intégrer à ce merveilleux “théâtre de pauvreté” – qui ne saurait être du pauvre pour autant – dont parlait Boulez. A l’opposé de la scène par rapport au chef, le lecteur est assis à un secrétaire et se révèle être aussi, en fait, l’auteur du conte, ou une sorte de matérialisation de narrateur omniscient, qui peut occasionnellement incarner physiquement sa participation au récit (beau morceau de bravoure que la mise en scène à trois de la partie de carte).
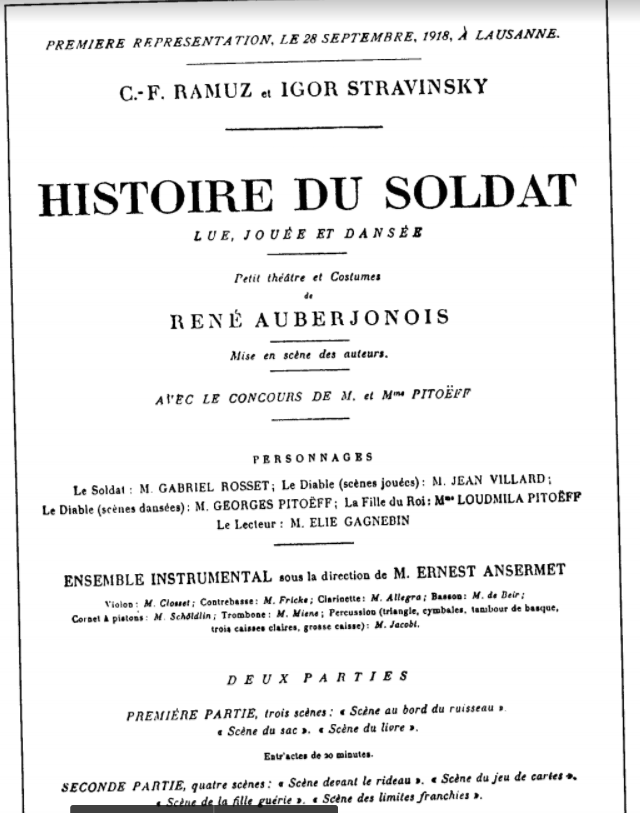
Dans l’espace imaginaire ouvert entre direction musicale et littéraire, le Soldat et le Diable joue un pantomime parfaitement réglée, avec les ressources inépuisables d’un théâtre burlesque de tradition, qui ne verse dans aucune complaisance triviale avec le public. On joue à la guignol, mais sans faire rire gratuitement. On en reste au niveau de la symbolisation et c’est heureux : de la sorte le trait presque entièrement grotesquese frotte au drame universel qui nous est raconté, sans en compromettre la gravité. Son désavantage, par rapport à une récitation plus austère, réside moins dans l’abaissement du message que dans la diminution de son potentiel émotionnel, qui est grand. Ainsi, le climat bouffe amène-t-il logiquement Julien Alluguette (qui succède à Fabian Wolfrom) à camper un soldat parfaitement benêt, bellâtre au regard ahuri et au sourire bovin (ou l’inverse), ce qu’il fait très bien. Mais pour cette raison, son hésitation, et le troc forcé de son petit violon manquent de crédibilité, du moins en tant que métaphore de la vente de l’âme au diable, qui n'a rien ici d'un déchirement. En revanche, à l’autre bout du récit, sa relation à la princesse est intéressante : pâtiné par les désillusions et décillements successifs, le soldat est devenu un être ambigu, sous la façade avenante duquel perce une pointe de manipulation, du moins de veulerie, ou de damnation d’une fuite éternelle faite de dérivatifs variés à une richesse infinie et insaisissable.

Le Diable campé avec métier par Licinio Da Silva est un pur Lucifer de guignolade, assez éloigné, forcément, de la grave figure méphistophélique. Le besoin de cohérence du projet scénique interdit certainement de procéder autrement, mais on y perd sans doute une dimension démiurgique, celle qui justifie l’emprise impitoyable sur l’âme corrompue, et la détention du pouvoir absolu : celui sur le Temps. Pour rendre la gravité particulière de l’adaptation par Ramuz du conte d’Afanassiev, il faut donc s’en remettre au Lecteur, qui est, de toute façon, toujours l’âme d’une exécution réussie de l’oeuvre. Et là, il n’y a strictement rien à redire. La prestation de Claude Aufaure est royale. Elle fixe un certain idéal du “rôle”, fil rouge d’une narration élevée scéniquement à la fonction symbolique, avec l’action se déployant sous l’effet de sa parole. Ce lecteur, et c’est bien vu, est en fait aussi auteur, chroniqueur, passeur d’un conte qui, du coup, est rendu à sa vocation universelle, allégorique. Pour cela il faut une grande voix d’acteur, et Aufaure met la sienne, typée, burinée, épicée, et sa science consommée de l'inflexion à contribution. Grand problème de L’Histoire, l’interprétation prosodique est ici assez littérale et stricte rythmiquement (A marché, a beaucoup marché, etc.), ce qui, en dépit de la liberté grande de certaines figures tutélaires (comme Cocteau), me paraît être l’option donnant le plus de force poétique au texte. Les quelques passages de la fin de l’oeuvre (marche royale, danse du diable) où l’équilibre avec l’orchestre est délicat sont surmontés, parfois avec astuce, le Lecteur déambulant parmi le public. Les échanges ou duplications de répliques avec le Soldat sont remarquablement agencés, avec un jeu subtil et constant sur le contraste expressif, la variation de degré du sens. Dans une rétrospection qui est presque d’outre-tombe dès le commencement, Aufaure ménage la place nécessaire pour une forme de candeur à demi-vraie, et d’émerveillement enfantin face aux prodiges. Le ton le plus présent est celui d'une subtile ironie de patriarche, incarnation d'une distance qui est autant celle d'un narrateur au fait du destin tragique de l'action que celle d'un aïeul bieveillant (remarquablement de justesse sur On va venir, on se sent fort, on a été tiré de la mort…). L’énumération finale des grandes maximes (Un bonheur, c’est tout le bonheur, etc.) parvient à une réelle émotion, douce-amère, aussi cruelle que pleine d’humanité.
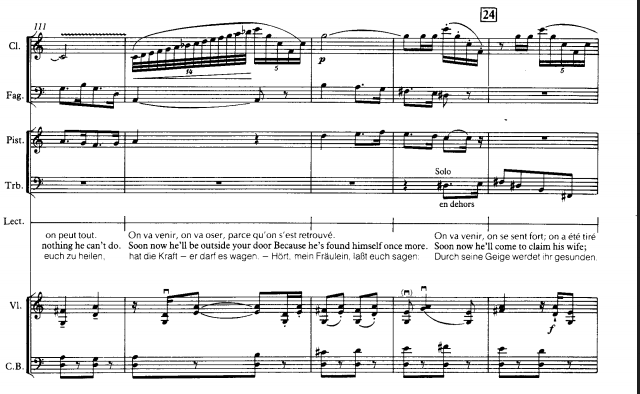
Sur le plan musical, cette réalisation se place à un niveaud’exigence relativement modeste pour ce qui concerne la précision générale, qu’il s’agisse d’acuité rythmique ou d’équilibres de timbres. Mais dans ce contexte, qui n’est ni une exécution de concert, ni ne ressortit à la relation ordinaire de l’orchestre au théâtre puisque les musiciens sont part intégrante de la mise en scène, on ne saurait trop en faire le reproche. L’essentiel, à savoir un jeu professionnel et une certaine gourmandise perceptible par le public, est garanti par l’équipe d'Ostinato (tournante), même si l'exiguïté du lieu demande sans doute encore plus de tranchant rythmique pour compenser la proximité dynamique . Il faut certes un violon offrant un peu mieux que du simple professionnalisme, notamment pour le morceau de bravoure Tango-Valse-Ragtime, et la jeune Cécile Subirana s’acquitte ici avec les honneurs de sa mission. On regrette que ni le Soldat ni le Diable ne fasse jamais l’effort de coups d’archet crédibles de leur côté. Clarinette et cornet offrent aussi une belle prestation d’ensemble, dans la Pastorale et dans le Petit Concert. On regrette seulement que les deux chorals finaux manquent de poésie de timbre et de lyrisme, mais cela doit varier d’un soir et de musiciens à d’autres. La contrebasse est très discrète, les conditions acoustiques ne lui étant certes pas favorable et demandant à l’évidence de jouer des dynamiques très supérieures aux réelles. De façon générale, la matité de la salle est ingrate pour les cordes. Rien de rédhibitoire en tout cas, qui empêcherait de joindre notre voix concert de louanges méritées accompagnant ce spectacle depuis sa création. Pour faire mieux connaître une oeuvre qui n’a jamais été assez jouée, il faut espérer que la production, en conformité avec son esprit, puisse devenir ambulante au cours des mois et des années prochains.

