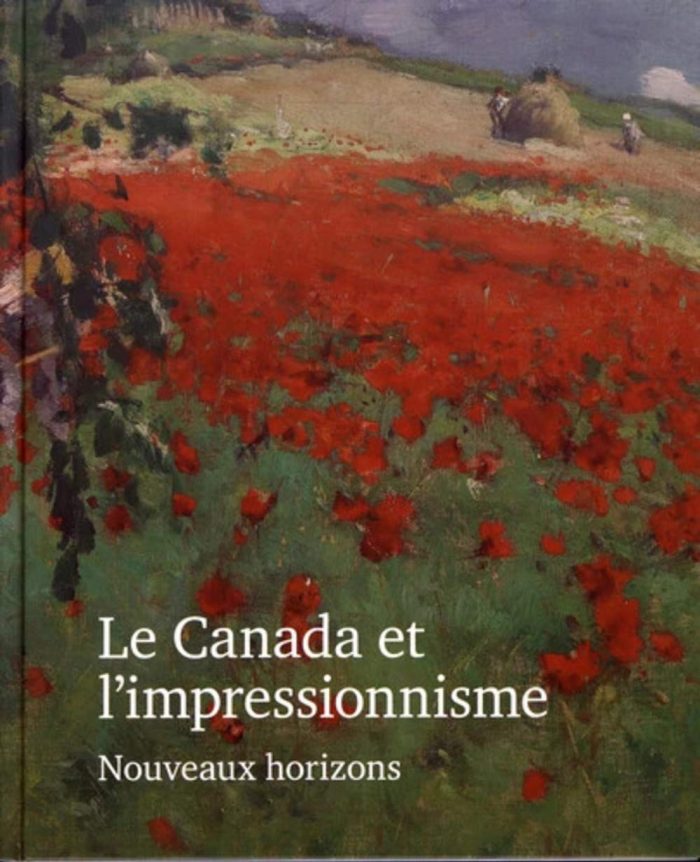On prétend que les Inuit possèdent plusieurs dizaines de mots pour désigner la neige sous ses différentes formes. Il est donc permis de supposer que les peintres canadiens disposent, eux, de plusieurs techniques pour représenter les flocons blancs, qu’ils soient encore en suspension dans l’air ou déjà amoncelés au sol. L’exposition actuellement proposée par le Musée Fabre de Montpellier permet, entre autres choses, d’en faire la vérification, car elle se penche sur les artistes originaires du Canada qui, entre 1880 et 1920, se sont donné pour mission de fixer sur leurs toiles les effets de la lumière sur des paysages souvent neigeux.
Après la Kunsthalle de Munich à l’été 2019, puis la Fondation de l’Hermitage à Lausanne au printemps dernier, Montpellier est la seule étape française de cette manifestation itinérante qu’a organisée le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. Un titre comme « Le Canada et l’impressionnisme » évite de se prononcer sur l’existence d’une version locale du mouvement officiellement né en France en 1874, qui se prolongera plusieurs décennies, la flamme étant entretenue pour divers peintres alors que les audaces impressionnistes n’effrayaient plus personne.
Le grand intérêt de cette exposition est évidemment de faire découvrir toute une série de peintres aujourd’hui à peu près totalement ignorés en France (alors qu’ils y firent leurs armes et y exposèrent, alors que leurs œuvres furent parfois acquises par l’Etat). Et comme le parcours de visite opte pour un cheminement thématique (Paris, la campagne, l’exotisme, les portraits d’enfants, les scènes de neige, etc.) qui ne se raccroche finalement à la chronologie (création de deux groupes d’avant-garde en 1920), nous tâcherons ici de rétablir l’ordre dans lequel s’est déroulée l’offensive artistique canadienne en France.
Peu après la constitution de la Confédération du Canada en 1867, plusieurs aspirants artistes vivant dans les différentes colonies britanniques ainsi réunies décidèrent assez logiquement de tourner leurs regards vers la vieille Europe, et surtout vers Paris, centre consacré de l’avant-garde depuis plusieurs décennies. En 1876, deux ans après que Monet est devenu bien malgré lui chef de file de l’Impressionnisme, William Brymner (1855–1925) arrive à Paris et devient bientôt l’élève de Bouguereau à l’Académie Julian. Revenu dans son pays adoptif à défaut d’être natal – ses parents, écossais, ont quitté Glasgow deux ans après sa naissance – Brymner sera de 1886 à 1921 professeur à l’Art Association de Montréal, mandat qui lui laissera le temps de former de nombreux élèves. En 1881, c’est au tour de Paul Peel (1860–1892) qui, à Paris, est l’élève de Gérôme à l’Ecole des Beaux-Arts. On se doute bien qu’auprès de leurs maîtres « pompiers », ces jeunes Canadiens n’ont pas appris un art d’avant-garde : certaines des œuvres de Peel présentées dans l’exposition ont d’ailleurs un côté un peu mièvre, s’écartant à peine de l’académisme après un séjour à Pont-Aven et optant pour une voie moyenne à la Bastien-Lepage. En 1881 aussi, William Blair Bruce (1859–1906) est lui aussi élève de Bouguereau, mais s’affranchit très vite. S’il s’installe à Barbizon, puis à Giverny, ce n’est pas un hasard ; ses toiles reflètent on ne peut plus clairement l’influence de Monet.

Enfin paraît celui dont la stature domine de très haut cette exposition : James Wilson Morrice (1865–1924). Lui aussi inscrit à l’Académie Julian, de 1892 à 1897, il montre clairement l’influence de l’Américain Whistler qui, après avoir parisien dans les années 1860, et devenu londonien.

Paris et Venise, peintes par Morrice, sont presque aussi brumeuses que Londres transfigurée par Whistler (voir son Quai des Grands Augustins acquis par l’Etat dès 1904 et aujourd’hui dans les collections du Musée d’Orsay) ; de tous les peintres réunis pour l’exposition montpelliéraine, Morrice est celui qui poussera le plus loin la simplification des formes, parfois sur le modèle des estampes japonaises (voir son Effet de neige, acheté en 1906 par le Musée des beaux-arts de Lyon). Sa manière de peindre les paysages est proche de Bonnard ou de l’Américain Maurice Prendergast, et Ses toiles réalisées aux Antilles montrent qu’il a retenu la leçon de Matisse, dont il partage le studio à Tanger en 1911-12. Morrice passa en fait presque toute sa vie en France ; aujourd’hui méconnu dans notre pays, il avait fait l’objet d’une exposition monographique au Musée du Jeu de Paume en 1927 et à Bordeaux en 1968.
Il faut aussi mentionner Maurice Cullen (1866–1934), premier Canadien à être élu membre de la Société nationale des beaux-arts en 1895, l’année où la France achète une de ses œuvres, la première d’un artiste canadien à rejoindre les collections nationales. Particulièrement habile à rendre les effets de la lumière sur le paysage, estival ou hivernal, diurne ou nocturne, Cullen maîtrise aussi l’art de la composition, comme en témoigne sa Cathédrale Saint-Jacques perdue sous la neige, devant laquelle se déroule comme une frise naïve de traîneaux et de chevaux vus de profil. Dans l’art du paysage excelle aussi Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté (1869–1937), où l’épaisseur même de la matière picturale est mise au service de l’évocation de l’épais manteau blanc étendu sur le sol.
On change de génération avec Lawren Harris (1885–1970). Ce n’est pas à Paris, mais à Berlin qu’il va faire ses études : est-ce d’Allemagne qu’il rapporte les nuages à la Hodler qui surplombent certains de ses paysages de neige au cadrage frappant ? Il est en tout cas le maitre à penser du « Groupe des 7 » officiellement créé à Toronto en 1920.

Et le parcours se termine avec une trop brève évocation de l’étonnante modernité de David Milne (1882–1953), dont La Cueillette des fleurs (1912) évoque le tout dernier Monet, par sa décomposition du motif, à la limite de l’abstraction : signe des temps, c’est à New York qu’il ira apprendre son métier, et qu’il deviendra sans doute l’un des artistes canadiens les plus fascinants du XXe siècle.
Ce n’est pas non plus en France, mais en Angleterre que l’une des nombreuses femmes dont les œuvres sont présentes dans l’exposition était allée apprendre l’art de peindre : d’abord élève de Brymner à Montréal, Helen McNicoll (1879–1915) choisit ensuite la fameuse Slade School de Londres, puis s’établit à Saint Ives, en Cornouailles, site de plusieurs colonies d’artistes. Disciple du pointilliste anglais Steer, elle pratique une peinture de plein air où l’on retrouve les sujets et parfois jusqu’à la facture de ses consœurs impressionnistes, Mary Cassatt ou Berthe Morisot. Emily Carr (1871–1945) s’est bien rendue à Paris, mais pour étudier auprès de Fergusson, coloriste écossais, et pour apprendre le fauvisme. Citons enfin Kathleen Morris (1893–1986), proche du groupe de Beaver Hall, dont l’éducation artistique s’est entièrement faite au Canada et dont la peinture en aplats et aux épais contours n’a déjà plus grand rapport avec l’Impressionnisme…
Catalogue :
Français
256 pages
Éditions 5 Continents
39 €
- Dimensions : 23,5 x 28,6 x 2,9 cm
Musée : Musée d'Orsay
EAN : 9788874398669
Référence : MX637036