
Situé en pleine campagne catalane, Peralada voit affluer chaque été un public d’amateurs assurés d’assister à un festival pluridisciplinaire (danse, musique, variété, poésie, théâtre…) au programme recherché. Cette année comme tous les ans, une large place était faite à l’art lyrique avec deux représentations scéniques de Die Zauberflöte mises en scène par Oriol Broggi, trois opéras donnés en version de concert, Rinaldo (version 1731), Thaïs défendue par Ermonela Jaho présente l’an dernière avec Madama Butterfly et Placido Domingo un habitué du festival où il revient depuis un fameux Otello de 1991 et Acis and Galatea présentée au Cloître, pour clore l’édition 2018, le 8 août. Ouvert un mois avant avec le Requiem de Verdi, le Festival a également fêté le 25ème anniversaire des débuts in loco du ténor Josep Bros ; mais le point d’orgue de la manifestation a eu lieu du 27 au 29 juillet.

Tout auréolé de son triomphe au MET de New York cette saison dans le rôle d’Idreno de Semiramide, le ténor mexicain Javier Camarena applaudi par le public barcelonais dans une récente Fille du Régiment (avec Sabina Puertolas, en 2017) donnait son premier récital dans l’Eglise du Carme le 27 juillet. Retransmis en direct par la RTVE, le programme uniquement consacré à des airs d’opéras a permis de découvrir toute la palette de ce chanteur aux moyens impressionnants. Dans une première partie dédiée au talentueux Manuel Garcia (1775–1832) père et impresario de ses deux filles Maria Malibran et Pauline Viardot (qui sert d’ailleurs de thème à son premier album à paraître chez Decca « Contrabandista » sous la houlette de Cecilia Bartoli), mais également ténor et compositeur, Javier Camarena a fait assaut d’une grande discipline technique et montré sa maîtrise vocale et sa connaissance des règles belcantistes aussi bien dans le premier air de Ferrando (Cosi fan tutte) « Tradito schernito » parfaitement restitué, que dans celui de Ramiro (Cenenrentola) « Si ritrovarla lo giuro » d’une impeccable virtuosité, deux titres abordés par Garcia. Si l’aria « Pur dubitar » extrait de Giulietta e Romeo de Niccolo Antonio Zingarelli (1752–1837 ) ressuscité pour l’occasion, ne nous a pas transportés, les trois raretés signées de la main de Garcia, en français et en espagnol, nous ont intéressé en particulier celle extraite d’El gitano por amor datant de 1829, se singularisant des autres par une cabalette d’une extrême difficulté, dans laquelle Camarena a montré toute sa bravoure, son dialogue avec l’excellent pianiste Angel Rodriguez ne faisant qu’aviver nos sensations. Bellini, Rossini et Donizetti étaient à l’honneur dans un second temps. Si « A te o cara » (I Puritani) donné en souvenir de la fondatrice du festival, Carmen Mateu, décédée en début d’année a été très apprécié par sa couleur mélancolique et son legato parfait, le ténor s’est montré inoubliable dans le finale de Lucia di Lammermoor, où les larmes, la sincérité des émotions et la traduction de la douleur ressentie par le personnage d’Edgardo ont serré le cœur comme rarement. Apprécié pour ses roulades et la facilité de son registre aigu, Camarena a bien entendu triomphé dans l’air de Lindoro « Languir per una bella » et mis l’auditoire en transe après le fameux air de Tonio de La fille du régiment, couronné de 9 contre ut exaltants. Revenu à six reprises le chanteur a comblé le public s’adressant à lui avec gentillesse et simplicité, le faisant reprendre en chœur la très populaire Ranchera de José Alfredo Jimenez « El Rey » et ses célèbres« Llorar, llorar »((« Pleurer, pleurer »)), sans oublier de le gratifier d’une étourdissante « Danza » rossinienne et d’une langoureuse chanson d’amour de Maria Riber, « Te quiero mucho ». Nous aussi !
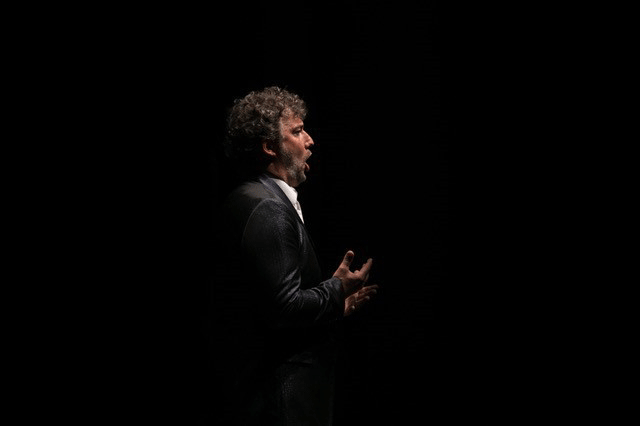
Le lendemain, cette fois-ci en plein air dans le Parc du château, avait lieu le concert de Jonas Kaufmann. Accompagné comme en 2014 par Johan Rieder, piètre chef pourtant fort apprécié par le ténor munichois, le programme faisait la part belle à l’opéra avec des pages françaises du XIXe et allemandes, toutes de la main de Wagner. La « Bacchanale » de Samson et Dalila jouée dans la plus totale confusion par l’orchestre du Teatro Real de Madrid aurait pu signifier que l’on retrouve Kaufmann dans l’air de « La Meule » qu’il a dit-on travaillé ; celui-ci a préféré débuter avec celui de Roméo « Ah lève-toi soleil » chanté avec une douceur et une pureté d’émission admirables, des aigus filés et une messa di voce sur la dernière note du meilleur effet, surtout quand elle est émise par un instrument aussi sombre et d’essence si dramatique. Enchaînée avec « La fleur » de Carmen, son air signature, toujours aussi contrôlé et conduit sur le souffle, la première partie réservait une surprise, le chanteur ayant choisi d’interpréter le périlleux air de Eléazar « Rachel quand du seigneur » extrait de La Juive. Plus concentré encore que dans l’album « L’Opéra » (Sony), plus décanté dans sa manière de faire progresser le récit vers le désespoir, Kaufmann s’est montré ici sans rival, sa diction parfaite et son légendaire legato venant accroitre notre plaisir, prolongé par un triomphal air du Cid « O souverain, ô juge, au père ». Le retour en terre wagnérienne s’est avéré plus éblouissant encore. Reprenant comme en 2014 le « Monologue de l’épée » de Die Walküre, à la langue acérée et au chant vigoureusement engagé, Kaufmann a prouvé s’il en était besoin, combien ce personnage de Siegmund correspondait à sa nature et à son tempérament. Moins grave et solennel, l’air du jeune Walther « Morgenlicht leuchtend » (Meistersinger) merveilleusement fluide et caressant, servait de transition pour passer lentement vers Lohengrin. Dans une forme vocale éblouissante, le ténor s’est emparé du récit du Graal avec une maitrise confondante du verbe et de la ligne. Porté par cette partition céleste, Kaufmann comme tombé du ciel a murmuré « In fernem Land » sans pour autant que sa voix ne perde en substance ou en projection. Dans cette version complète en deux strophes que Wagner supprima avant la première et que l’on peut retrouver dans l’album consacré au compositeur paru en 2013 (Decca), le chanteur s’est montré souverain, son art de la demi-teinte et de la progression dramatique touchant au sublime. Refusant de prendre congé après une telle prestation, ce dernier est revenu à trois reprises d’abord avec un Werther anthologique, « Pourquoi me réveiller », un « Winterstürme » chanté comme un lied avec une ineffable poésie, avant de conclure avec un « Traüme » des Wesendonck-Lieder (en écho à son précédent concert) en hommage, comme son confrère Camarena, à la mémoire de Carmen Mateu fondatrice bien-aimée du Festival.

Le lendemain avait lieu une version concertante de Thaïs proposée quelques jours avant au Teatro Real de Madrid : en tête de distribution, l’inaltérable Placido Domingo en Athanaël, Ermonela Jaho dans le rôle-titre, une nouvelle étoile fidèle à Peralada où elle interprétait Madama Butterfly l’an dernier. Retrouver Domingo, véritable légende vivante, même âgé et converti en baryton, est toujours un plaisir doublé d’un privilège. Qui peut en effet prétendre à son âge tenir ce rythme effréné qui le porte inlassablement de projet en projet, d’un point à l’autre de la planète ? Personne sinon lui, arrivé la veille pour assister à la première partie du concert de Kaufmann, avant de filer à Bayreuth le lundi aux aurores, pour assurer la première de Die Walküre cette fois en tant que chef d’orchestre, le premier espagnol de l’histoire invité sur la colline verte. Dans une condition physique et vocale optimales, le chanteur malgré une diction française confuse (un de ses pêchers mignons) s’est emparé de ce nouveau personnage avec la vigueur insolente d’un jeune premier. Se jetant dans la partition tel un combattant, il a restitué toutes les facettes de ce prêcheur aux convictions douteuses et aux pratiques brutales, amoureux fou de Thaïs, hétaïre au grand cœur qui acceptera de le suivre avant de mourir. Virulent, machiavélique et finalement bouleversé, Domingo n’a pas hésité à donner de sa personne, son timbre éternellement juvénile et l’urgence de son chant laissant l’auditoire submergé par l’émotion. Galvanisée par la présence d’un tel artiste, Ermonela Jaho malgré de réels efforts, a montré ses limites. Le rôle faussement aisé n’est pas écrit dans ses meilleures notes et la soprano albanaise pourtant adroite et fine musicienne, ne répond qu’à moitié aux critères attendus. Misant tout sur son registre aigu et ses notes filées à tout moment pour mettre le public dans sa poche, sa voix ondulante peine dans le bas medium, très sollicité, ce qui nuit à la pertinence de ses échanges « musclés » face au pervers Athanaël ; la pulpe, la chair et le gras d’une Fleming font ici défaut. Dans les rôles de Palémon et de Nicias, Jean Teitgen et Michele Angelini se distinguent par leur musicalité et leur interprétation étudiée tandis que leurs comparses féminines exécutent très correctement leur personnage, sous la direction bienveillante et extrêmement convaincante de Patrick Fournilllier, chef discret et d’une grande compétence, surtout dans le répertoire français.
