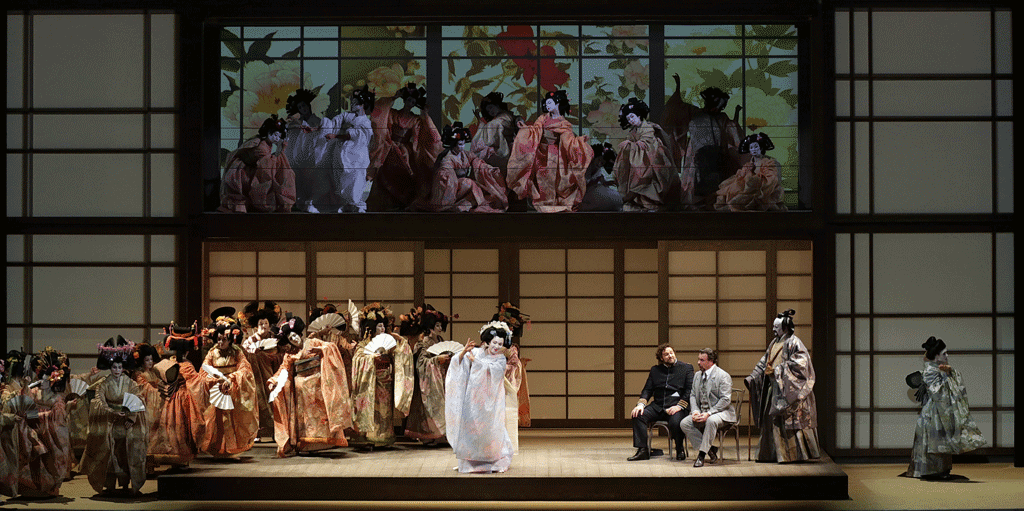 La production d’ouverture de saison de la Scala doit manifester aux yeux du public et de la presse l’état du théâtre : le spectacle inaugural est témoignage de la perfection d‘une des grandes institutions mythiques de l’Italie. De plus, avec Madama Butterfly qui y fut créé, s’affiche le répertoire traditionnel de la maison, une garantie pour un public friand d’italianità.
La production d’ouverture de saison de la Scala doit manifester aux yeux du public et de la presse l’état du théâtre : le spectacle inaugural est témoignage de la perfection d‘une des grandes institutions mythiques de l’Italie. De plus, avec Madama Butterfly qui y fut créé, s’affiche le répertoire traditionnel de la maison, une garantie pour un public friand d’italianità.
Le 17 février 1904, la première fut un échec, et Puccini revit la partition, qui fut reproposée en mai de la même année dans une version modifiée pour faire la carrière que l’on sait.
C’est pourtant la version princeps que Riccardo Chailly a décidé de diriger, dans une mise en scène fastueuse et photogénique d’Alvis Hermanis : une entreprise philologique qui prend son sens dans le projet Puccini, l’un des axes forts de sa politique musicale.
On a donc découvert cette version peu connue, plus longue de 25 bonnes minutes, avec des airs légèrement modifiés, une partie symphonique très développée entre le deuxième et le troisième acte, Kate Pinkerton qui chante quelques répliques et quelques autres menues modifications.
On peut oser dire que Puccini a bien fait de dégraisser un peu son œuvre, de changer çà et là une ou deux notes qui en fait changent tout, et de rendre plus nerveux et plus musclé ce qui semble ici un peu longuet, maladroit, et pas toujours musicalement stimulant.
Il était cependant intéressant d’entendre une version qui permet ensuite de comprendre comment on passe d’un travail respectable au chef d’œuvre, par le retrait de quelques moments inutiles et de quelques phrases : dramaturgiquement tout y gagne, et notamment l’efficacité théâtrale de cette « tragedia giapponese » qui est sans doute la plus cruelle des œuvres de Puccini.
Pour l’occasion, Alexander Pereira a appelé Alvis Hermanis, qui propose une « Nipponeria » selon l’expression même de Pinkerton, c'est-à-dire un Japon plus vrai que nature, un Japon mis en scène qui est la projection de ce que les occidentaux veulent voir du Japon, surchargé de costumes, de fleurs, de paysages qui font image à défaut de faire sens. Cependant, au-delà du pittoresque, ce Japon-là est fait d’êtres inférieurs assujettis au dieu dollar dont Pinkerton se fait une joie d’inonder les uns et les autres.
D’où des ambiguïtés : ce choix satisfait sans doute le public touristique heureux de trouver une Madama Butterfly au premier degré photographique, belles images, belles couleurs et Japon à tous les étages. En réalité, c’est au second degré qu’il faut lire ce travail, mais c’est si peu évident que cela ne semble pas effleurer le public présent, occupé à ses selfies, fredonnant Un bel di vedremo ou s’esbaudissant devant les beaux costumes de Kristīne Jurjane. Cette ambiguïté conforte une certaine vision de l’Orient par l’Occident, qui était celle de l’époque de Puccini, mais dont Madama Butterfly est une dénonciation : cela devrait peut-être occasionner une vision du XXIème siècle qui prenne plus de distance par rapport à la cruauté de la situation et affirme une position plus nette par rapport à l’exploitation des populations locales par l’Occident.
Suffisamment caricaturale pour sembler second degré, et suffisamment spectaculaire pour sembler premier degré, c’est une production consensuelle, qui a satisfait les exigences de la retransmission TV : c’est là son principal défaut.
 Il faut vraiment entrer dans le spectacle pour en voir les véritables intentions. C’est un jeu dangereux parce que ces intentions sont relativement cachées. Les images générales sont en effet autant de photographies dignes d’une opérette, avec ces immenses estampes qui apparaissent et disparaissent en coulissant (au Japon « tout est lisse et coulisse »), car le décor d’Alvis Hermanis et Leila Fteita est une maison japonaise à étages qui barre tout horizon, sinon celui figé des estampes, où apparaît tantôt un ballet de geishas, tantôt le terrible Zio Bonzo, et tantôt Kate Pinkerton autre silhouette fatale. Ce dispositif concentre toute l’action au premier plan où s’accumule le chœur qui n’a pas de respiration spatiale, et les personnages sont contraints d’évoluer sur une surface très réduite et toujours latéralement.
Il faut vraiment entrer dans le spectacle pour en voir les véritables intentions. C’est un jeu dangereux parce que ces intentions sont relativement cachées. Les images générales sont en effet autant de photographies dignes d’une opérette, avec ces immenses estampes qui apparaissent et disparaissent en coulissant (au Japon « tout est lisse et coulisse »), car le décor d’Alvis Hermanis et Leila Fteita est une maison japonaise à étages qui barre tout horizon, sinon celui figé des estampes, où apparaît tantôt un ballet de geishas, tantôt le terrible Zio Bonzo, et tantôt Kate Pinkerton autre silhouette fatale. Ce dispositif concentre toute l’action au premier plan où s’accumule le chœur qui n’a pas de respiration spatiale, et les personnages sont contraints d’évoluer sur une surface très réduite et toujours latéralement.
Appuyé sur un travail assez attentif autour du Kabuki, et essayant d’inculquer aux chanteurs l’art délicat du geste théâtral japonais, Hermanis propose une chorégraphie où Maria José Siri a un peu de mal à être crédible par la maladresse de ses gestes nipponisants. Seule à tirer son épingle du jeu, la Suzuki d’Annalisa Stroppa réussit à fondre ces gestes dans une expressivité notable du visage et un sens dramatique aigu.
On peut penser louable qu’Alvis Hermanis se soit appuyé sur la tradition du Kabuki pour étudier avec une très grande précision gestes et mouvements du plateau et des personnages, il reste que le jeu inhérent au Kabuki n’est jamais mieux servi que par des acteurs japonais, et que chœur et chanteurs scaligères ne peuvent qu’imiter des mouvements d’un jeu qui leur est étranger. A ce titre, dans ce même théâtre, la fameuse production de Keita Asari était sans doute plus authentique. Ce Japon reste donc artificiel et surjoué, ce qui décrédibilise l’entreprise si elle est philologique, et qui lui donne valeur si elle est ironique. Face à ce Japon excessif, les deux occidentaux forment contraste y compris entre eux.

L’élégance discrète de Carlos Alvarez est remarquable : cette retenue donne immédiatement au personnage de Sharpless une réelle humanité, c’est un consul normal, humain mais distancié, pratiquant le « rien de trop » avec un jeu équilibré d’une très grande dignité. Quant au Pinkerton de Bryan Hymel, il faut être Cio-Cio-San pour lui faire la moindre confiance : sans dignité, sans relief, sans aura, il est exactement le personnage veule et presque vulgaire voulu par l’histoire, et respire la légèreté ; de ce point de vue, Alvis Hermanis l’a très bien caractérisé ; il s’oppose à l’apprêt et à l’artifice de toute la partie japonaise en un contraste saisissant. C’est sans doute le personnage le mieux dépeint de la production et le plus juste peut-être.
Dernière ambiguïté enfin, une scène finale traitée à la manière un peu pleurnicharde de La Bohème qui lui ôte toute grandeur : il y a là aussi du second degré dans l’air. D’une part un rituel très précis de Hara Kiri, où Cio-Cio-San s’égorge, selon la tradition des femmes nobles pratiquant le Jigai ((Jigai : forme de suicide rituel pratiqué par les femmes et filles de samouraïs)), d’autre part Pinkerton qui se précipite sur son cadavre en pleurant tel Rodolfo et hurlant ses fameux Butterfly !, mais pour l’abandonner bien vite, aller ôter le bandeau à l’enfant et le regarder dans les yeux, comme pour lui dire « comme tu vas être heureux avec moi là-bas ». L’avenir est assuré. Rideau. Oubliée Butterfly, parenthèse japonaise d’une vie de marin.
On peut saluer dans cette vision de Pinkerton une des rares idées d’une mise en scène où se font face caricature de Japon et caricature d’Amérique.
La caricature est lisible, mais pourtant pas totalement affirmée. Cette mise en scène n’est pas légère comme une opérette pour touristes de passage, elle ne se donne pas, sert ce que j’appelle plus haut l’ambiguïté du propos et pourrait même être mal comprise. Tout simplement parce qu’il y manque l’émotion, il y manque l’empathie : le deuxième acte, où Butterfly s’affirme la Signora Pinkerton dans un décor de casa americana –l’idée n’est pas neuve- , en affichant sa conversion au christianisme d’une manière plus frontale – ça, c’est plus neuf – est aussi une manière de caricature, et la succession des scènes où le personnage nie obstinément l’évidence pourrait être plus travaillée à travers les gestes, car l’habit occidental – et c’est aussi une bonne idée d’Hermanis – ne masque pas la culture japonaise d’origine (marquée par la jolie scène des cerisiers), on pouvait tout aussi approfondir le ressort psychologique : ce n’est pas le cas.
Aussi reste-t-on sur sa faim. L’image finale est sans doute voulue et revendiquée, mais la lecture peut passer aussi pour un « sauvetage » du jeune enfant, une sorte de revendication raisonnable de l’occident pour l’arracher à un avenir oriental forcément dégradant. Si c’est lu comme le pis-aller raisonnable on peut faire de ce spectacle non une lecture conservatrice, mais authentiquement réactionnaire. Le prix à payer de la pax americana.
Ainsi l’excès de couleur locale arrive à effacer le drame en le distanciant : la tragedia est certes giapponese, mais elle l’est all’italiana, de Puccini, sur un livret de Giacosa et Illica. Le prisme du regard est singulièrement biaisé et le Kabuki n’est qu’artifice ou exercice de style.
Du point de vue musical, la réalisation est sans conteste incroyablement travaillée par les forces de la Scala qu’il faut célébrer à l’aune de leur exceptionnelle prestation, à commencer par le chœur éblouissant, magnifiquement préparé par Bruno Casoni, le coro a bocca chiusa de la fin du 2ème acte est notamment sublime. Quant à l’orchestre, il est exceptionnel à tous points de vue, sans scorie aucune, d’une clarté extraordinaire, avec des instrumentistes solistes remarquables à tous les pupitres. L’orchestre est certes dans son répertoire, mais il est au sommet, tendu, soyeux, juste, techniquement sans défaut.

La distribution réunie marque la difficulté à trouver des interprètes adéquats pour une œuvre qui en a souvent manqué à la scène dans son histoire. On a des Butterfly au disque, mais parmi elles, peu ont osé la scène. À part la phénoménale Kabaïvanska qui en avait fait un de ses chevaux de bataille je n’en ai jamais entendu de vraiment convaincante, sauf un soir à Garnier où Leontyne Price pour son unique apparition parisienne nous fit tomber du balcon dans un « Piccolo iddio » que plus jamais on n’entendra comme ça.
C’est un rôle écrasant, exigeant une présence quasi continue d’une nature très différente au début et à la fin, une voix très différente aussi, adolescente au premier acte, femme au troisième, avec un travail permanent sur le volume et la couleur. Pour Maria José Siri, c’était une prise de rôle et sans doute reviendra-t-elle sur son interprétation. Elle a les notes, elle les fait avec conscience, même si quelques-unes sont un peu tirées, elle a les passages, la technique, le volume, et tout cela ne pose pas de problème particulier. Mais elle ne réussit jamais à émouvoir et donc à être pleinement convaincante : il y a peu d’expression dans ce chant, peu de couleur, et peu de variété, je pense d’ailleurs que les exigences de la mise en scène y sont pour quelque chose et que son physique ne correspond pas tout à fait à ce qu’on lui demande. C’est dommage.
Bryan Hymel est un des bons ténors d’aujourd’hui mais on reconnaît à peine son timbre, qui semble voilé et légèrement opaque, l’émission et le phrasé sont problématiques : il n’a manifestement pas le style voulu. Hymel n’est jamais aussi bon que dans le répertoire romantique et notamment le répertoire français qu’il chante avec la précision et la couleur voulue. Que peut ajouter Pinkerton à sa gloire ? Le rôle est terriblement ingrat, tendu, et sans grand intérêt musical : il sert d’ailleurs avec les honneurs l’interprétation voulue par la mise en scène : il est physiquement le personnage, mais pas vocalement : on peut avoir les notes et être totalement en dehors de l’univers puccinien.
Le Sharpless de Carlos Alvarez est au contraire exactement le personnage attendu : Alvarez est toujours d’une suprême élégance, et le rôle convient à l’état actuel de sa voix. Le timbre chaleureux et noble sert particulièrement l’interprétation, on entend en arrière-plan le merveilleux Posa qu’il fut jadis. Le jeu est un peu distancié, mais naturel aussi : c’est totalement convaincant et d’autant plus notable que Sharpless n’est pas un rôle si intéressant : il faut vraiment une vraie personnalité pour occuper le personnage de l’intérieur et c’est ce que réussit Carlos Alvarez.
Annalisa Stroppa, découverte et appréciée à Salzbourg dans la Lola de Cavalleria Rusticana, confirme cette impression initiale. La voix est bien projetée, l’expressivité notable, l’interprétation vraiment émouvante. Elle sait parfaitement s’emparer du style voulu (le Kabuki) pour en user de manière personnelle, avec des expressions notables du visage et des accents dans la voix qui émeuvent. C’est de tous les personnages celle qui diffuse le plus d’émotion et qui va directement au cœur.
De l’ensemble des rôles de complément (il y a en a beaucoup dans Madama Butterfly) on notera l’excellent Goro de Carlo Bosi : voilà un chanteur qui prend la suite des grands comprimari de la Scala, comme Piero De Palma ou Ernesto Gavazzi : quoi qu’il chante, il est juste, expressif, dans le ton voulu. Certains chanteurs sont très corrects, comme le Yamadori de Costantino Finucci ou Nicole Brandolino dans celui très court de Kate Pinkerton, à qui néanmoins Puccini dans cette version réserve une intervention brevissime mais marquée. D’autres sont plus problématiques comme le Zio bonzo de Abramo Rosalen, au timbre opaque et à l’autorité vocale discutable là où on attend une intervention impressionnante de basse. Mais dans l’ensemble la compagnie est très digne, sans être exceptionnelle cependant.
Exceptionnelle, magistrale en revanche la direction musicale de Riccardo Chailly : c’est sans conteste elle qui fait toute la représentation, au point qu’on a quelquefois l’impression que les chanteurs accompagnent l’orchestre et non l’inverse, tant la ligne musicale s’impose avec une incroyable autorité. C’est frappant dans le deuxième acte où la fosse est une ligne continue, prodigieusement précise, lumineuse, montrant avec emphase ce que sont l’orchestration et la complexité pucciniennes dans leurs moindres détails, avec un jeu sur les volumes, sur les niveaux de lecture jamais entendu jusqu’alors. Même si l'intermède entre le deuxième et le troisième acte est un peu long dans cette version, on ne peut qu'être enthousiasmé de la manière dont Chailly fait tout entendre, et dont il valorise cette musique là-même où elle n'est pas toujours convaincante. Un diamant.
Chailly s’affirme comme un des tout grands interprètes-exégètes de Puccini des quarante dernières années, comme a pu l’être Maazel en son temps.
Ce qui frappe dans cette approche, c’est qu’elle affirme une exigence musicale de tous les instants et qu’elle fait de l’orchestre l’absolu protagoniste, aux dépens même du plateau, tant ce qui se passe en fosse est fascinant, voire hypnotique.
Cette perfection cependant fait perdre là-aussi en émotion, il y a chez Puccini (et c’est là son ambiguïté) quelque chose de légèrement « facile », d’attrape tout, d’un peu « sale » (c’est tellement net dans La Fanciulla del West par exemple) qui masque l’extraordinaire raffinement de la composition. Ce côté « facile » et l’accentuation mélodramatique qui fait naître aussi l’émotion directe, disparaît ici au profit d’une incroyable propreté, d’une construction nette, prodigieusement inventive et intelligente, monumentale, mais qui laisse un peu de côté l’émotion simple, pourtant l’un des grands atouts pucciniens. C’est une construction finalisée à elle-même, un peu narcissique qui concentre autour d’elle l’essentiel, aux dépens d’un plateau correct sans plus et d’une mise en scène ambiguë et suffisamment lisse pour ne pas gêner le chef.
Il manque, sur scène comme en fosse, la ligne directe avec l’émotion. Nous sommes en ligne directe avec l’admiration du travail du chef, mais les lignes sont singulièrement perturbées pour le reste. Et on le sait, l’opéra est un trépied : le chef ne peut pas tout si le chant et la scène ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe en fosse. Et donc le spectacle ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. L’hirondelle ne fait pas le printemps et le printemps des cerisiers est bref.
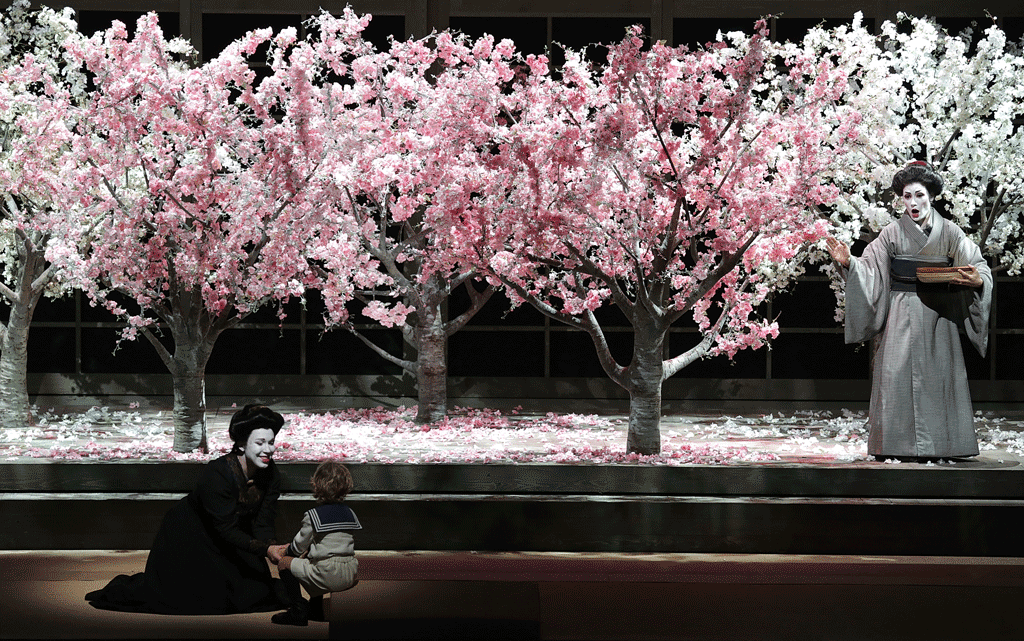

Vous êtes tres dur pour MARIA JOSE SIRI que je considére comme exprimant avec passion son rôle etcela chanté avec justesse et endurance sans faiblesse. Vous soulignez ,à juste titre, l'interprétation de ANNALISA STROPPA qui je le lui souhaite devrait avoir un bel avenir si les Directeurs d'opéra ont une bonne écoute des prestations actuelles. Pour ma part c'est plutôt du coté des hommes que le bât blesse surtout avec BRYAN HYMEL. Ce spetcacle nous a, ma femme et moi beaucoup plu, et il ya bien longtemps que nou s n'avions été aussi touché par cet opéra ; comme vous le faites à juste titre remarqué seule la tres grande soprano KABAIWANSKA a laissé une interprétation inoubliable. Merci de toute façon pour vos comptes-rendus d'une immense culture et finesse d'analyse.