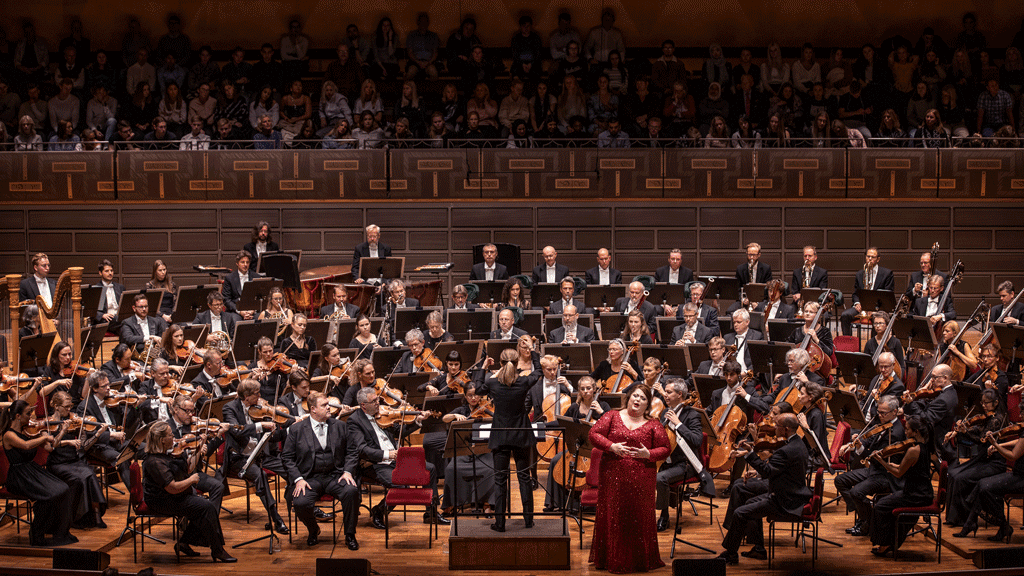Stockholm aime bien Karina Canellakis et la réciproque est sans doute vraie. De fait, elle dirige régulièrement les deux grands orchestres de la ville : le Kungliga Filharmonikerna et le Sveriges Radios Symfoniorkester.
Nous l’avions entendue en avril à Berwaldhallen diriger la Symphonie de Requiem de Britten et la 7e de Beethoven et nous avions alors été moyennement convaincus par sa direction plutôt raide et sèche. Ce récent programme centré sur la triade Beethoven/Berlioz/Wagner fut intéressant à plus d’un titre pour finalement apprécier la chef dans ses œuvres.
Le Beethoven lui convient mieux en effet : un tempo assez vif mais mesuré, de beaux volumes, une direction très précise, assez analytique, sans recherche d’effets ni d’emphase, avec un orchestre visiblement très en phase avec la chef (sourires des violons) dans cette quête du son, clair et précis, net et sans taches.
Le Berlioz est exécuté dans la même lignée mais le rendu est globalement moins satisfaisant : si le son est là, le sentiment fait défaut. De très beaux pupitres certes (cordes, bois, vents), d’autres un peu moins (quelques bavures aux cors) et une direction au cordeau mais pas de place pour les épanchements, la poésie, les sentiments. La partition, rien que la partition. Avec de beaux moments suspendus, et notamment une attention particulière aux silences, cette fois-ci assez marqués contrairement à ceux de l’Ouverture d’Egmont. Berlioz joué comme du Beethoven, c’était sans doute l’intention et une belle aventure sonore mais cela n’emportait pas.
Son interprétation de Wagner prend elle aussi le contrepied de l’attendu avec un prélude orageux, plutôt lent, mais pas mou du tout, là où j’attendais des rafales de cordes et un déluge de cors. Assez surprenant : comme si la nuit de Romeo et Juliette s’était prolongée sur celle (à venir) de Siegmund et Sieglinde. Là encore, Canellakis fait ressortir la filiation avec Beethoven avec toujours cette même quête d’un son pur, d’accords de masses sans chercher à être démonstrative, ni assourdissante (les voix ne seront jamais couvertes). Ce n’est ni raide, ni sec mais jamais émouvant, ni même emporté. On est tout le temps dans l’intellectualité du son. Même lors du solo de violoncelle (tout simplement parfait), on reste dans le beau son. Compassion, certes, mais idéalisée.

L’émotion vient d’ailleurs. Du duo incestueux, Melton et Skelton, aux noms et physiques appariés et aux surprises qu’ils dévoilent. D’abord dans le jeu : on était resté sur l’image d’une Heidi Melton ((Melton sur Wanderer :https://wanderer.legalsphere.ch/2017/04/macabre-nucleaire/ )) un peu empâtée et empruntée, dans la captation du Ring Castorf/Janowski, ici, sur la scène du concert et malgré de nombreuses embûches (l’arrivée de Sieglinde dans la cabane, ici une forêt d’instruments à cordes, sous tension, avec une question cruciale : comment ce corps-là va-t-il se frayer un passage dans le gigantesque orchestre wagnérien ?), elle tient à jouer vraiment. Regards, discrets, lancés à Siegmund lors de la préparation de la Nachttrunk, barrage de son corps devant Hunding pour protéger le Wälsungen (Feige nur fürchten den), tension amoureuse et retenue lors du duo d’amour. Voilà une véritable chanteuse wagnérienne (sur)puissante, qui a décidé de miser, aussi, sur son jeu d’actrice. Évidemment, elle n’a pas la mobilité plastique désormais nécessaire aux Sieglinde modernes mais l’effort est louable et très réussi. D’autant que la voix est là. Une puissance d’émission incroyable plutôt sur la retenue d’ailleurs (elle sait qu’elle peut), de belles notes, de superbes échappées sur les hauteurs, de belles couleurs, variées, mais comme avec l’orchestre de Canellakis, peu d’émotions (vocales). Et puis, peut-être que la fraîcheur nécessaire à Sieglinde n’est plus là, et que Melton, avec ses couleurs plus moirées, malgré des aigus vifs et saillants, devrait maintenant se concentrer sur Brünnhilde, vraiment faite pour elle aujourd’hui.

Stuart Skelton((Skelton sur Wanderer :
https://wanderer.legalsphere.ch/2019/09/petites-deceptions-et-belles-surprises/
https://wanderer.legalsphere.ch/2019/04/un-corset-nomme-robert-wilson/
https://wanderer.legalsphere.ch/2016/11/amour-amour-je-taime-tant/ )) a lui aussi une voix monstrueuse et il gardera tout au long de l’acte une certaine concentration, axant son travail sur le jeu d’acteur, comme Melton, mais en tirant, pour sa part, la carte de l’émotion. Et c’est aussi inattendu ! Dans une matinée concertante, visiblement vouée au son, par une chef et des chanteurs en pleine maîtrise de leurs instruments, Skelton occupé à ciseler son chant, brusquement, oblique sur l’émotif lors d’un Nun weißt du, fragende Frau, warum ich Friedmund – nicht heiße, d’anthologie, réellement poignant, totalement inouï pour ma part. Plus attendu, mais tout aussi beau, un Chant du Printemps, tendant au lied, peut-être un peu rapide et un peu bancal après une performance ahurissante, bien que prévisible, sur les Wälse, notamment le premier, montée en puissance sans faille de fusée sonore, avec un second étage lâché avant la saturation (ce fut moins vrai pour le second mais comment reproduire cela ?). La fin de l’acte est donc plus difficile, avec moins de clarté dans les aigus et un timbre un peu plus gris dans les registres graves et mediums mais le ténor reste totalement héroïque (même si on l’apprécie également en guerrier harassé et lassé refusant de répondre aux questions pressantes de Hunding).

Face à ce duo impérial et très uni, Ain Anger ((Anger sur Wanderer (en italien) :https://wanderer.legalsphere.ch/it/2018/01/lumanita-in-scena/)), lui aussi assez joueur, roule ses basses qui ne sont qu’une maigre défense devant les coups de butoir des Wälsungen. Emission nette et sans bavures, rondeur et profondeur, diction fine. C’est un bel Hunding, fort, stable et vigoureux.
Triomphe mérité pour un premier acte qui semble beaucoup trop court, plein de surprises de la part d’interprètes qui ont donné ce qu’on n’attendait pas : un peu d’humanité dans un monde sonore un peu trop ordonné par (le triomphe de) la volonté. Wagner bien compris en somme.