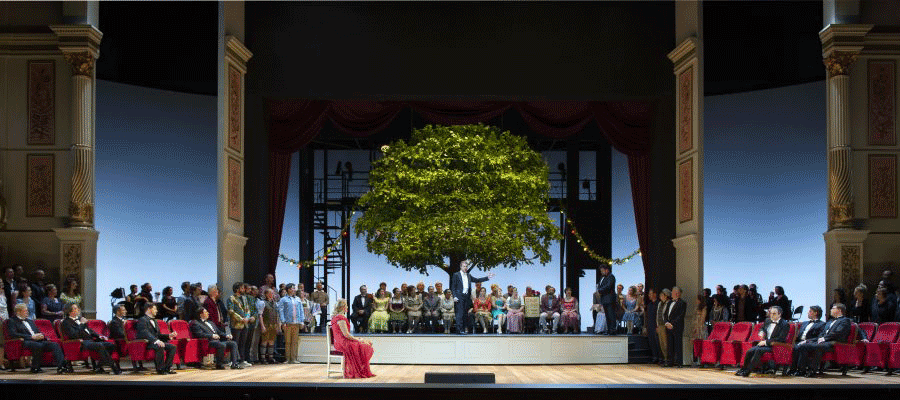
Deux productions de Meistersinger von Nürnberg en 5 jours, c’est exceptionnel . C’est un privilège que de pouvoir écouter deux parmi les orchestres les plus prestigieux de l’ex-Allemagne de l’Est, la Staatskapelle Berlin et la Staatskapelle Dresden, qui sont essentiellement des orchestres de fosse comme leur alter ego le Gewandhausorchester de Leipzig, dans une œuvre aussi emblématique du répertoire allemand.
La distribution réunie et le chef sont d’autres garanties, avec la prise de rôle du plus difficile des rôles wagnériens par Georg Zeppenfeld, une des basses les plus réclamées actuellement sur les scènes internationales ; les ingrédients qui composent cette production sont donc d’une qualité indiscutable et laissent espérer une grande soirée.
Et pourtant, quelque chose n’a pas fonctionné qui a produit une déception personnelle à la fin de la représentation, bien que le triomphe public soit extraordinaire et c’est heureux pour les participants.
La production de Jens-Daniel Herzog ne réussit à imposer ni vision, ni direction. La lecture en est assez confuse. A priori nous nous trouvons dans un théâtre, le décor (de Mathis Neidhardt) monumental et hyperréaliste représente la scène bien connue de la superbe Semperoper de Dresde (couleur, forme des loges…) où la production sera proposée la saison prochaine.
À Dresde, ce sera ainsi une authentique construction en abyme et, nous le verrons plus avant, il est probable que toute la représentation, y compris la distribution, ait été calibrée pour Dresde et non pour la salle du Grosses Festspielhaus de Salzbourg.

Théâtre dans le théâtre donc, où l’on assiste à une répétition des « Meistersinger » dans un décor d’église gothique, dont Hans Sachs est le metteur en scène, du moins le comprend-on à sa manière de discuter avec le petit groupe des maîtres dans la salle, avec un cahier de régie dans les mains. À la fin de la scène de la messe, baisser de rideau, qui se relève pour laisser place au manège habituel des théâtres, machinistes affairés, chœur qui gagne la coulisse, décors démontés, montrant au passage quelques authentiques techniques théâtrales (le roulé des toiles peintes par exemple), il y a là quelque chose d’anecdotique, qui distrait le regard, mais sans que le spectateur ne comprenne clairement l’enjeu.

Tout d’abord, le statut de Sachs, qui est bien le patron, mais qu’on retrouve cordonnier au deuxième acte, même s’il l’est sur la scène, comme s’il jouait Sachs dans sa mise en scène ; mais on le voit évoluer, sur la scène aussi, dans son bureau, où il étudie ses textes et où il prépare la programmation. On le dirait au vu de sa lassitude plutôt Hauptregisseur ((Metteur en en scène résident)), veillant à la cohérence des spectacles, on comprendrait alors mieux qu'il soit las de remettre sur le métier (les fameux Wiederaufnahmen) des mises en scène poussiéreuses… homme de théâtre un peu ennuyé par le théâtre qu'il semble obligé de faire ? tout cela reste flou et l'on se demande souvent qui est qui ou qui est où. Le deuxième acte montre par le jeu d'un plateau tournant, le théâtre vu des coulisses, où l'on passe indifféremment du plateau aux remises, des remises aux bureaux ou aux magasins. Quant au monologue final, à rideau fermé coupé des participants à la Festwiese, il devient une sorte de leçon particulière de Sachs à Walther, sans doute insuffisamment convaincant puisque les amants s'en vont quand même…

La république de Nuremberg est donc d’abord une république théâtrale. Cela peut se comprendre tant le monde du théâtre est fermé, avec ses lois et ses rituels, et ses fonctionnements spécifiques, mais cela ne va guère plus loin. L’ensemble de la mise en scène ne porte pas sur le théâtre en tant que genre, mais en tant qu'institution, car elle assimile le rituel des maîtres vidé de son sens au théâtre de routine qui trop souvent encore règne dans beaucoup d'établissements.
Si l’on se projette à la fin, après la Festwiese dont on ne sait exactement si elle est représentée, ni à quel niveau (théâtre en direct, théâtre au second degré, théâtre dans le théâtre dans le théâtre…), et quand Eva et Walther s’enfuient, Sachs reste seul en éclatant de rire, comme s’il avait réussi à rompre le rituel suranné des maîtres chanteurs. La fuite finale des amants n’est pas une idée bien originale, déjà en 2006, à Genève, Pierre Strosser dans une belle mise en scène faisait fuir les amants (avec valise …) qui avaient nom Anja Harteros (Eva) et déjà Klaus Florian Vogt (Walther) tandis que Sachs était Albert Dohmen et Dietrich Henschel Beckmesser…on savait faire des distributions à Genève, merci Blanchard…
Cette fin n'est donc pas si inattendue, qui s'oppose aux mises en scènes bayreuthiennes de Wolfgang Wagner, très consensuelles, où à la fin tout le monde se réconciliait, voire à celle d’Andrea Moses à Berlin. Cette fin où Eva déchire le futur portrait de Walther en Maître et entraîne son amoureux affirme en plus l’autorité nouvelle du personnage, de cette femme qui ne suit pas son homme, mais qui l’entraîne à partir, est une idée dans l’air du temps et intéressante, notamment dans un opéra où deux femmes sont face à une quinzaine d’hommes…
Entre ce début et cette fin…il faut bien reconnaître qu’il ne se passe pas grand-chose.
Comme souvent dans les mises en scènes de « Théâtre dans le théâtre », ce qui séduit au départ (le monde, la vie du théâtre etc…) ne tient pas forcément la distance, on finit par s’y perdre, car tout le deuxième acte joue sur une tournette à l’intérieur de la scène « de Dresde » : plateau nu, bureau de Sachs metteur en scène ? intendant ? puis dans le magasin de cordonnerie qu’on suppose être celui du théâtre, au-dessus duquel se trouvent les remises à accessoires où se dissimulent Eva et Walther. Où est-on, qui est qui, ce n’est pas très clair et on semble passer du plateau en coulisse, sans vraiment de solutions de continuité ni de logique installée, mais l’intrigue se déroule sans heurts : il faut simplement et prudemment s’abstenir de chercher derrière les yeux.
La Festwiese, sur la scène plus ouverte, aurait sans doute eu besoin de figurants en plus grand nombre pour couvrir le plateau immense (à Dresde, ce sera différent, là aussi) : cette Festwiese très traditionnelle avec son chêne central , (le fameux Deutsche Eiche symbolique de l’Allemagne) méritait plus de spectaculaire, mais c’est peut-être voulu puisque la scène est celle du théâtre-bis, en modèle réduit, représentation de la Festwiese comme la scène initiale dans l’église.
Bien sûr le décor est impressionnant, bien sûr l’intrigue se déroule, mais sans propos affirmé et avec des moments qui ne sont pas sans développer – un comble – un certain ennui.
C’est bien la question d’un travail qui a priori est focalisé sur un Sachs fatigué des maîtres qui arrivent dans le théâtre dont on déplace les fauteuils, pendant que sur la scène est dressé un petit buffet devant lequel on perd un peu de temps avant de s’installer : ces maîtres au costume gris anonyme, ne sont que des bourgeois qui se réunissent par habitude pour boire un peu de Champagne mais finalement peu concernés par l’art et ses règles : le rituel a perdu son sens et Sachs (re)met en scène des Maîtres sans doute volontairement très traditionnels en costumes médiévaux, en se détachant de plus en plus de ce travail. Cela permet évidemment qu’on circule dans ces maîtres en costume d’aujourd’hui ou en costumes médiévaux : on est au théâtre, tout est permis et cela dissimule une manière de figer les choses et empêche l'innovation. Walther dans cette vision est un peu celui qui rompt la routine, et remet les choses d'équerre, sur le théâtre et dans la vie y compris personnelle de Hans Sachs.
Ainsi voilà un travail qui ne va pas au bout des éléments qu’il met en place ; d'ailleurs ce Sachs intendant et metteur en scène pourrait être celui de Nuremberg, comme double du metteur en scène Jens-Daniel Herzog lui-même, l’intendant actuel du Staatstheater de Nuremberg, mais le décor renvoie clairement à la Semperoper de Dresde.
C’est d’ailleurs un des nœuds du problème général posé par cette production, pensée scéniquement et musicalement pour espace de Dresde, bien plus ramassé (1400 places) que celui de Salzbourg (2000 places) et donc sans doute acoustiquement plus adapté.
Car le décor n’est pas suffisamment clos pour un renvoi efficace du son, notamment lorsque les voix sont en arrière-plan (et notamment sur la scène-bis), moins lorsqu’elles chantent au premier plan (le quintette par exemple). Il en résulte des conséquences un peu dommageables.

On entend mal les voix et notamment celles de Georg Zeppenfeld (Sachs) et de Jacquelyn Wagner (Eva), notamment dans les nombreuses scènes de conversation, où l’on perd bien des paroles que l’orchestre couvre. Ce problème acoustique est assez surprenant car il s’est très rarement vérifié au Grosses Festspielhaus de Salzbourg, mais il y a fort à parier qu’il ne se posera pas – en tous cas avec cette acuité- dans la salle de Dresde.Au-delà de cette question, la distribution est dans l’ensemble de très bon niveau. Georg Zeppenfeld, dont on connaît les qualités de phrasé et le timbre assez clair couvre sans problème l’ensemble du spectre, même si a priori on ne le voyait pas forcément dans Sachs. Pourtant il est déjà un Sachs imposant, qui n’accuse pas une once de fatigue au terme de ce parcours exténuant et qui s’affirme fortement notamment aux deuxième et troisième actes. Peut-être manque-t-il encore à la prestation cette agilité verbale que l’expérience et la fréquentation du rôle lui donneront, mais c’est un détail car c'est déjà remarquable.Face à lui l’excellent Adrian Eröd en Beckmesser, avec ses habituelles qualités de phrasé, de diction, d’expression et cette manière de prendre le rôle sans être risible ou ridicule. C’est un Beckmesser de belle présence scénique, digne, y compris dans l’adversité et ses qualités de projection font qu'on entend parfaitement cette voix qui n'est pas si grande.
Vitalij Kowaljow est un Pogner très solide, à la voix bien posée et projetée, avec quelques menus problèmes de phrasé cependant et un manque de couleur dans l'émission.

Plus discutable de David de Sebastian Kohlhepp, dont le style un peu plus héroïque tranche avec les David bien plus lyriques dont nous avons l’habitude. Ce jeune chanteur est sans doute un espoir du chant dont on entendra parler, car la prestation est honorable (il remporte un beau succès) mais il a eu quelques problèmes d’émission et de montée à l’aigu ce soir.Enfin Klaus Florian Vogt, à l’émission comme toujours parfaite, au phrasé de rêve, à la clarté cristalline. On peut ne pas aimer ce timbre si particulier, mais quel artiste ! On l’a vu ailleurs peut-être plus engagé scéniquement, et la mise en scène qui s'intéresse bien plus à Eva ne lui donne pas un rôle d’un relief si grand. Mais l’ensemble de la prestation ne souffre aucune réserve, il est bien le Walther de ces quinze dernières années.

Du côté des rôles féminins, Christa Mayer (Magdalene) s’impose sans aucun problème, voix bien posée et puissante, personnage énergique, et très présent en scène.
Plus problématique l’Eva de Jacquelyn Wagner, au très joli timbre, à la voix séduisante mais au volume nettement insuffisant et aux graves et centres inexistants. On entend en revanche ses aigus, bien contrôlés, sans aucune scorie, comme si elle s’était concentrée sur les aigus parfaitement maîtrisés et puissants en négligeant les autres registres. La conséquence est qu’on l’entend peu dans les scènes de conversation, mais qu’elle est magnifique dans un quintette par ailleurs magnifiquement réussi dans l’ensemble. Enfin, la mise en scène visiblement s’est intéressée tout particulièrement au personnage, qui a du relief et à qui sont réservés des costumes (de Sybille Gädeke) très remarqués et remarquables, le rendant "visible", une énergie et un esprit de décision presque inhabituels.
Tout le reste de la distribution, et notamment le Kothner de Levente Páll, n’appelle pas de reproche et se montre très homogène. À noter tout particulièrement l’excellent Nachtwächter de Jongmin Park.
Le chœur de la Staatsoper Dresden dirigé par Jörn Hinnerk Andresen, renforcé par le Bachchor de Salzbourg dirigé par Alois Glaßner offre une prestation de grande qualité culminant au fameux « Wach auf » d’un beau relief et d'un volume impressionnant.
Last but not least, la Staatskapelle Dresden confirme (en doutait-on?) qu’elle est l’une des toutes premières formations d'aujourd’hui, aux cordes charnues et virtuoses, aux bois très solides, au relief particulièrement marqué et aux cuivres magnifiques. Le son si particulier un peu ambré, de cet orchestre très idiomatique, d’une clarté étonnante, reste toujours séduisant, d’une rare solidité, et aussi d’un grand raffinement, notamment grâce à la direction spectaculaire de Christian Thielemann, d’une incroyable précision, dosant chaque note, attentif à chaque son, chaque couleur : un travail d’orfèvre de l’orchestre qui est ciselé comme rarement on a pu l’entendre. C’est un travail véritablement exceptionnel, quasiment parfait, au niveau de la concertazione et de la mise en ordre technique. Pour ceux qui aiment les sons chavirants, les notes plus tenues, l’exposition enivrante du son orchestral, les tempi mesurés, ce fut sans doute un moment d’exception et le public lui a répondu avec chaleur, puisque le chef remporte le grand triomphe de la soirée.
Du point de vue de la dynamique théâtrale, il en va autrement. Dans cette comédie en musique, il est peut-être plus nécessaire que l’orchestre soit moins exposé et plus en soutien et en éclairage du dialogue et du texte qui restent pour moi l'essentiel de la nouveauté de cette œuvre. On a plutôt l’impression que les chanteurs de ce point de vue sont moins guidés et soutenus (surtout face aux problèmes acoustiques évoqués plus haut), et que l’attention extrême portée à l’orchestre se fait au détriment d’une impression d’ensemble qui frappe par son relief sonore aux dépens de la vie.
Certaines scènes (par exemple celle de David au premier acte, celle de Beckmesser et Sachs au dernier) manquent de cette vivacité et de cette alliance texte-musique qu’on attend ici, et comme en plus, la mise en scène n’en fait à peu près rien, l’ensemble résulte plutôt parfait formellement, mais sans l’âme ni la vie dont cette partition merveilleuse regorge et qui fait sa nature profonde. Il y a quelque chose d’un peu narcissique dans cette approche, qui laisse peu de place à l’émotion et aux élans. Pour ceux qui aiment la musique avant toute chose, ce fut sans doute un sommet, ceux qui aiment la Gesamtkunstwerk ce fut une frustration.
Au total et malgré ce triomphe flotte quand même un parfum vaguement nostalgique à la fin de ces Meistersinger qui marquaient la fin du Festival de Pâques 2019, 52ème édition. En quelques années, la Staatskapelle Dresden a conquis le public, Christian Thielemann est ici très populaire, le succès final l’a montré, mais on ne peut s'empêcher de penser que derrière le triomphe final, se profilaient les doutes qui pèsent sur l’avenir et que ce triomphe semblait un vrai soutien au sens politique : l’an prochain est la dernière saison de l’intendant Peter Ruzicka et de Christian Thielemann qui a clairement déclaré qu’il n’était pas question qu’il travaillât avec Nicolaus Bachler, l’actuel intendant de Munich et futur intendant du festival de Pâques. Le départ de Walther à la fin de ces maîtres aurait-il quelque chose de prémonitoire ?

