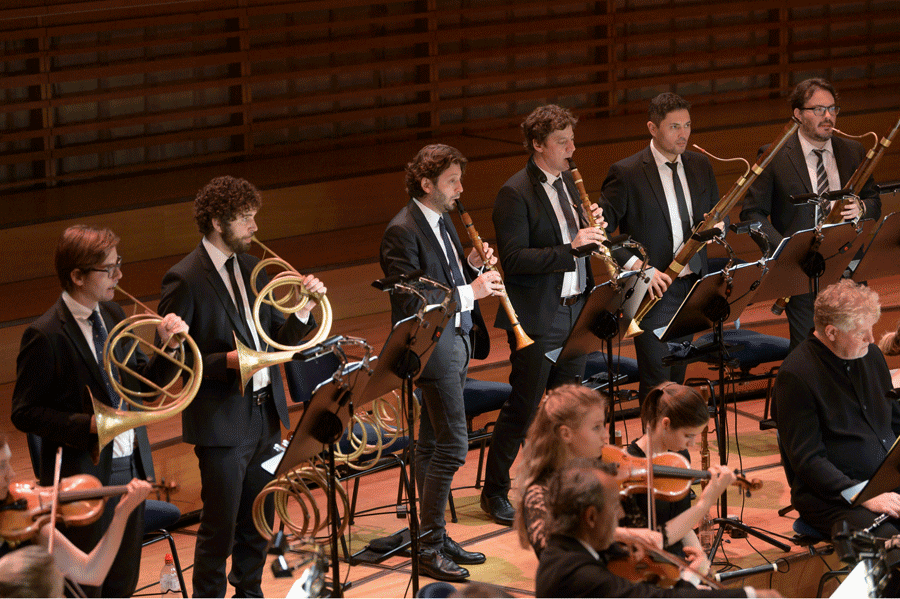
Depuis plusieurs décennies, l’interprétation mozartienne connaît des évolutions notables, notamment avec l’arrivée sur le marché des baroqueux, qui ont induit à une écoute différente, sur des instruments différents, avec des rythmes et des sons différents.
Il en va de même pour le chant et l’opéra. Il existait naguère des chanteurs et chanteuses dont on connaissait la veine mozartienne, il existait des grandes Comtesses par exemple, comme une Janowitz, une Margaret Price, et face à elles des immenses Susanna, comme Lucia Popp, ou Mirella Freni, il existait aussi des Cherubino d’exception, Teresa Berganza, Agnes Baltsa, Tatiana Trojanos, mais aussi de très grands Figaro ou des comtes Almaviva fabuleux : un Gabriel Bacquier est-il aujourd’hui remplacé ?
Aujourd’hui le chant mozartien s’est diversifié, qui pourrait aujourd’hui citer une Comtesse d’exception ? Une Susanna ? Un comte ? Il y a quelques Figaro encore qui comptent, mais on serait bien en peine de citer des souvenirs vibrants d’un porgi amor chavirant. On a des comtesses qui ressemblent souvent vocalement à des Susanna, des Almaviva assez interchangeables. J’avoue avoir des difficultés à identifier un Don Giovanni idéal aujourd’hui. J’ai grandi avec celui de Ruggero Raimondi, il y a eu depuis Keenlyside, Peter Mattei bien sûr, et après ? On trouve des Figaro et des Leporello tout à fait extraordinaires, et durant ces trois jours de Mozart-Da Ponte, on a eu le Figaro d’Alex Esposito, un modèle, et le Leporello de Kyle Ketelsen, autre modèle. Mais autant on a souvent des Figaro ou Leporello d’exception, des Luca Pisaroni, des Bryn Terfel par exemple, ou plus ancien un José Van Dam qui fit les grands soirs de Paris et de Salzbourg, autant certains rôles n’ont plus de « titulaires » incontestés et cela concerne plus d’ailleurs les rôles féminins. Cela ne signifie pas que les distributions soient mauvaises, elles sont très professionnelles dans l’ensemble mais assez interchangeables.
Loin de moi l’idée de chanter mon air « c’était mieux avant » avec récitatif et cadences. C’est un élément de réflexion qui me saisit à chaque Mozart entendu. Il est clair aussi que si il y a quarante ou cinquante ans le répertoire XVIIIe était largement et presque exclusivement limité à Mozart et un peu à Gluck, il est aujourd’hui si foisonnant que la présence de Mozart dans les programmes s’est un peu relativisée et que les chanteurs se sont souvent « dispersés » dans un répertoire qui s’enrichit chaque année de nouvelles découvertes.
Et pourtant, les quatre jours passés à Lucerne, comme pour me contredire, recentrent le débat sur Mozart, et montrent des distributions presqu’idéalement composées notamment du côté féminin : il semble par exemple, on le verra, qu’on tienne une Donna Anna et une Fiordiligi magnifique en la personne de Nadezhda Pavlova qui chantera Anna à Salzbourg l’an prochain.
Mais les distributions réunies ont pour point commun le rapport au chef, déterminant, au point qu’on peut se demander ce que la même distribution vaudrait avec un autre chef que Teodor Currentzis. Les Mozart que Teodor Currentzis nous a offerts à Lucerne ne ressemblent à aucun autre Il faut ici s’y arrêter longuement.
Les auditeurs de Salzbourg ont déploré que l’Idomeneo proposé cette année ait été plutôt ennuyeux et peu inventif. Ceux qui avaient entendu et vu La Clemenza di Tito en avaient été enthousiasmés, et Wanderer a rendu compte avec gourmandise et du concert genevois, et de la production, vue à Amsterdam.
La différence avec cette année à Salzbourg : l’orchestre, qui était les Freiburger Barockorchester et non MusicAeterna, son orchestre, duquel il fait ce qu’il veut.
Currentzis a tissé avec les années une relation très spéciale avec sa formation, qu’il a formée, élaborée, sculptée en une respiration mutuelle qui fait que chœur et orchestre font corps avec leur chef, au point que les concerts qu’ils font ensemble sont singuliers, notamment grâce au fantastique premier violon qu’est Afanasii Chupin. C’est d’ailleurs avec MusicAeterna qu’il fera à Salzbourg Don Giovanni, et non avec les Wiener Philharmoniker, pour la saison du centenaire (1920–2020), ce qui ne laisse pas d’être surprenant pour un titre aussi emblématique et salzbourgeois que Don Giovanni .
Et pour cette série de Mozart, l’impression qui prévaut d’emblée, c’est que ce Mozart est ailleurs, et pour plusieurs raisons.

- D’abord, on l’a dit, la respiration commune de l’orchestre et de son chef, médiatisé par Afanasii Chupin, un premier violon d’exception qui entraîne l’orchestre dans cette vision syncopée, hyper dynamique, hypercontrastée. Celle d’un Mozart fantasque, violent, rude aussi, à l’opposé du Mozart bonbonnière qu’on aime à rappeler. Certes Il y a longtemps que Mozart est plus dramatisé et moins mellifère (déjà Solti…), mais ici, c’est élevé au rang de système. Pour traduire la chose en images, c’est exactement le Mozart vu par l’Amadeus de Milos Forman, un adolescent éternel, rieur, vif, étourdissant, agaçant aussi. Symbole, la mise en valeur systématique de timbales violentes, sèches, brutales qui surprennent à faire sursauter (voir par exemple son ouverture des Nozze di Figaro). C’est le point commun d’une approche spectaculaire, qui rend ce Mozart toujours haletant.
- Ensuite, la manière dont Currentzis tient en main les chanteurs, avec une gestuelle rapprochée, insistante, particulièrement démonstrative à la limite du supportable. Quand il ne les tient pas trop, c’est qu’en eux-mêmes l’approche des chanteurs est proche de la vision de Currentzis et qu’ils ont une suffisante autonomie pour adhérer librement : c’est le cas du fabuleux Figaro d’Alex Esposito, ou du Leporello de Kyle Ketelsen, personnages complètement incarnés, quels que soient les chefs, et qui font en eux-mêmes spectacle. C’est évidemment ce qui rapproche ces artistes du chef : ils partagent le même souci.
- La notion de spectacle : il y a une approche entertainment qui se lit dans la dynamique même de chaque opéra. Spectacle dans la manière de diriger, à la fois précise et dynamique, mais qui en même temps focalise le regard sur le chef qui bouge, se promène, va tout contre le chanteur pour l’accompagner, ce qui peut agacer certains habitués à plus de réserve, mais aussi de mettre systématiquement les musiciens debout lorsqu'ils jouent : les cordes sont quasiment debout en permanence, comme au XVIIIe((Abbado l'avait fait aussi pour les Brandebourgeois à Lucerne 2003)). Currentzis fait spectacle de tout, car la version présentée voit les chanteurs sans partition, à l’opposé des traditionnelles versions de concert, amorcer des esquisses de mouvements scéniques impliquant quelquefois les musiciens de l’orchestre et utilisant l’espace scénique même réduit, de manière à ce que la trame soit globale, avec les musiciens, le chœur, les chanteurs et que l’ennui soit une parole bannie. C’est virevoltant à tous les étages (encore Amadeus…). Et c’est fabuleux.
On regrette d’autant plus que la « metteuse en scène » Nina Vorobieva ne soit pas citée dans le générique, comme si tout se déroulait naturellement à l’initiative des artistes. Elle est metteur en scène attachée à l’Opéra de Perm que Music Aeterna et leur chef viennent d’ailleurs de quitter.
12 septembre : Le Nozze di Figaro
C’est peut-être ces Nozze di Figaro, premier pan de la trilogie (donnée chronologiquement), qui ont laissé entendre la distribution la plus équilibrée et la plus totalement convaincante.
La folle journée fut à Lucerne en ce 12 septembre l’occasion d’une folle soirée, menée à un train d’enfer : des Nozze di Figaro qui offrent un Mozart vif, étourdissant, un Mozart qui semble procéder directement du film de Forman, juvénile, fantasque, violent. Un Mozart joué debout par les cordes de MusicAeterna, et chanté de manière exemplaire par une distribution presque essentiellement slave, signe de l’excellente santé de cette école de chant.

Il en est résulté un triomphe, et notamment pour le Figaro infatigable d’Alex Esposito, l’italien de la troupe, désormais irremplaçable dans ce rôle.
Dès l’ouverture, la mise en valeur des timbales et leur scansion violente nous avertit : ces Nozze n’auront rien du Mozart gracieux de jadis. Nous ne nous aviserons pas de dire où est la vérité de Mozart, chaque époque ayant sa vérité. Le fait est qu‘Amadeus, le film de Milos Forman dont il était question plus haut eut dès 1984 l’intuition d’un Mozart espiègle, gai, rieur, volontiers paillard et c’est de ce Mozart là dont Currentzis s’est emparé, ou du moins, c’est ce Mozart là qu’il nous montre, brutalement, formidablement convaincant. Il faut alors s’habituer au spectacle du chef qui bouge, qui se place sous la barbe des chanteurs, qui obstrue leur liberté corporelle, qui risque de les étouffer.

Alex Esposito est suffisamment habitué au rôle qu’il promène sur toutes les scènes du monde pour se sentir libre de sauter, de circuler, parce qu’il respire un Figaro qui convient bien au chef. À côté de lui la Susanna formidablement poétique et pleine de relief d’Olga Kulchynska qui est sans doute aujourd’hui la plus convaincante des Susanna : son air de l’acte IV Deh vieni non tardar est un morceau d’anthologie. Magnifique.
Paula Murrihy est un Cherubino à la voix assez forte, bien posée, inhabituel parce qu’un peu plus brutal que les Cherubino habituels, plus vigoureuse et un peu plus rêche, mais formidablement intéressante.
Moins intéressante la Contessa d’Ekaterina Scherbachenko, très lyrique, mais pas vraiment expressive. Le personnage ne semble pas vraiment incarné et au total assez banal, tout comme Andrei Bondarenko, un conte très passepartout : chanté correctement, mais rien de plus.
Bien plus sentie la Marcellina de Daria Telyatnikova, claire, expressive, au chant coloré et particulièrement intelligent (son Il capro e la capretta est un modèle). Tous les autres sont très corrects et méritent d’être cités : Evgeny Stavinsky Bartolo à la basse bien timbrée, Krystian Adam, Don Curzio et Fanie Antonelou aimable Barbarina, tout comme l’Antonio sonore de Garry Agadzhanyan, ou le Basilio ironique de Danis Khuzin, tous deux membres de la troupe de Perm.
Au total des Nozze qui permettent de ne plus voir Mozart de la même manière, mais qui confirment que c’est l’habitude de travailler ensemble qui crée la cohésion et l’incroyable inventivité de cette manière de faire de la musique et faire sonner Mozart.
14 septembre : Don Giovanni

On connaît le Don Giovanni de Currentzis par l’enregistrement a suscité tant de commentaires contrastés. Don Giovanni avec l’ensemble MusicAeterna et une distribution voisine sera créé à Salzbourg la saison prochaine : autant dire l’intérêt tout particulier de la soirée. Et de fait, dès l’ouverture l’énergie qui va courir dans cette ultime journée de l’épouseur du genre humain emporte l’auditeur dans un tourbillon de violence et de tension, ménagée par une attente assez longue du chef qui s’installe et dont le premier accord explose littéralement, avec, sans transition, une sorte de calme avant le drame ou la tempête. Une entrée hyperthéâtrale, avec un orchestre phénoménal, très contrôlé, et encore une fois rythmé par la timbale de Dimitrios Desyllas, presque irremplaçable dans ces Mozart-là. Quitte à se répéter, il me semble qu’il faille tout accepter en bloc dans ce travail, au risque de trop analyser et finir par détruire la cohésion de l’entreprise. Il s’agit d’une entreprise globale où tout est représentation, du chef aux chanteurs et au chœur. À prendre ou à laisser dans son ensemble.
L’accompagnement de la première scène fait presque de l’orchestre le principal protagoniste, tellement il est l’âme de l’ensemble et entraîne les chanteurs. Currentzis reste attentif à tout, et notamment à ne jamais couvrir les chanteurs, à les suivre au millimètre mais sans jamais empêcher leur respiration, ni leur expression, ni étouffer leur volume sous un déluge sonore. Il sait ménager les silences, il sait attendre (la manière dont il accompagne le Commendatore de Robert Lloyd, basse fameuse des années 1990, aujourd’hui âgé de 79 ans, est presque didascalique). Et c’est là où Currentzis est étonnant : on est stupéfait de son côté invasif et à la fois de son côté respectueux des équilibres et de l’ensemble. Tout en contradiction productive.
Spectacle encore que ce final syncopé. À la mort de Don Giovanni, le spectacle s’arrête, applaudissements, saluts : on se dit version de Prague ? pourtant, c’est toute la version de Vienne qui a été chantée…
Et subitement d’un geste les chanteurs se remettent en place, pour donner le final de Vienne comme un bis, pour bien séparer l’histoire de sa morale ; une morale qui n’en est pas une d’ailleurs parce que la mort du héros ne résout évidemment rien, on a perdu celui qui motivait les actions de chacun et chacun va retourner dans sa solitude et son néant. Là aussi il y a la recherche d’un effet théâtral qui n’est pas gratuit, qui donne sens à l’ensemble. Tout cela est réfléchi.

La distribution est particulièrement étudiée, avec des chanteurs pas toujours connus mais particulièrement valeureux, à commencer par le commendatore noble et toujours en voix de Robert Lloyd et la magnifique Zerlina de Chistiane Gansch, toute fausse fragilité, au chant à la fois délicat et décidé (magnifique la ci darem la mano avec un sublime accompagnement d’orchestre jusqu’au fil sonore presque inaudible, et surtout magnifiques Batti, batti, o bel Masetto et le très subtil vedrai, carino). Un chant intelligent, plein d‘autorité et de finesse, qui fait face au Masetto réussi lui aussi, mais dans le genre plus brut de décoffrage de Ruben Drole, au chant vraiment bien dominé et affirmé, qui rend à Masetto une noblesse qu’il n’a pas toujours.
Kenneth Tarver est un Ottavio très contrôlé, impeccable de style et de raffinement, qui n’a pas le caractère effacé de certains Ottavio, qui sait chanter avec autorité avec un impeccable phrasé, une magnifique prestation.
Federica Lombardi est au contraire une Elvira qui semble décalée par rapport à la cohésion de l’entreprise, chantant son Elvira comme elle le ferait avec n’importe quel chef et dans n’importe quelle circonstance, c’est chanté avec exactitude, mais sans véritable engagement et presque sans âme. Elle fera pourtant partie de la distribution de Salzbourg.
Le Leporello de Kyle Ketelsen est évidemment le Leporello de l’époque, il le chante depuis longtemps avec une autonomie de style et une intelligence qui sont des modèles de « bel cantare », son air du catalogue est un chef d’œuvre d’ironie, de phrasé, d’expression avec des recherches subtiles dans les cadences. C’est un artiste du texte, avec une voix parfaitement contrôlée et un sens du théâtre inscrit dans le chant même. Extraordinaire.

Donna Anna est Nadezhda Pavlova, petit bout de femme à la voix qui au départ ne séduit pas, un peu métallique. Mais peu à peu elle conquiert le public par un chant incroyablement maîtrisé, subtil, contrasté, techniquement impeccable, des mezzevoci très sûres aux aigus et aux colorature redoutables, tout en interprétant le rôle avec beaucoup de vérité. Son or sai che l’onore est vraiment extraordinaire et la pose immédiatement au centre de l’attention. Elle remporte un immense succès mérité : il y a longtemps que je n’avais pas entendu une telle Donna Anna, elle n’a pas la voix de velours des grandes Anna à la Margaret Price, mais elle a une fantastique force de conviction. Elle sera Anna à Salzbourg.
Enfin Dimitri Tiliakos est un Don Giovanni à la voix en demi-teinte, sans autorité affirmée, mais au timbre chaleureux et à la technique bien dominée. Il est un Don Giovanni plus en faiblesse qu’en force. Non pas au niveau du chant bien maîtrisé, mais la voix a perdu en relief. Ce n’est pas gênant car ainsi ce Don Giovanni est plus une projection des rêves des autres que le personnage réel qu’il s’affirme. C’est un Don Giovanni un peu en retrait, subtil, moins spectaculaire que d’autres et c’est intéressant ainsi de profiter des qualités peut-être déclinantes d’une voix pour construire un autre personnage.
Au total, et avec le « coup de théâtre » du double final, qui pose une des questions dramaturgiques de l’œuvre, il s’agit d’une représentation de très haut niveau, d’un travail d’ensemble magnifiquement défendu. Une fois de plus triomphe.
15 septembre : Cosi fan tutte

Conclusion du cycle Mozart/Da Ponte, ce Cosi fan tutte donné en dernier (puisque l’on suit la chronologie des œuvres) est the last, but not the least, avec dans la distribution une Despina luxueusissime, Cecilia Bartoli, concluant ainsi le cycle et toute l’édition 2019 du festival alla grande. Mais Cosi fan tutte ne repose pas sur Despina, évidemment et si le reste de la distribution ne tenait pas la route, ce serait un naufrage.
L’accord initial de Cosi fan tutte, avec ce tutti qui dialogue avec les hautbois puis les bassons, est une merveille de mise en place d’un système d’écho « brutalité puis caresse », créant une incroyable dynamique sous la baguette de Teodor Currentzis, qui étourdit par sa rapidité, mais toujours hypercontrôlé. On accuse souvent Currentzis de protagonisme dans sa manière de diriger, peut-être parce qu’on le regarde et qu’on se dit « il joue à la star ». En réalité, il est très attentif aux équilibres et ne projette jamais l’orchestre au premier plan, mais comme un accompagnateur prolongé dans les trois opéras, aidé par un continuo absolument exceptionnel dont il fait un des protagonistes composé d’un Hammerklavier (la magnifique Maria Shabashova), d’un luth (Israel Golani) et d’un violoncelle (Alexander Prozorov ) d’une incroyable présence dans les récitatifs, mais aussi dans les ensembles. Vraiment exceptionnel.
La distribution ne tourne pas autour de Cecilia Bartoli – que bien sûr tout le monde attend- parce qu’elle est très homogène, chaque voix est à sa place, à commencer par le Don Alfonso assez jeune et pas trop « vieux libertin » de Konstantin Wolff, efficace et vif, le Guglielmo excellent de Konstantin Suchkov, au phrasé exemplaire et au chant particulièrement sensible. Mais dans les hommes domine le magnifique ténor d’origine chinoise mais formé aux USA, Mingjie Lei, timbre délicat, phrasé exemplaire, diction parfaite, d’une clarté cristalline, tenue de souffle fabuleuse, tout en subtilité et émotion. Son Un’aura amorosa est exemplaire dans la technique qui sert une émotion indicible. Un nom à retenir et à suivre avec beaucoup d’attention.
Du côté féminin, on retrouve la Bartoli de toujours, pleine d’humour, envahissant la scène par sa présence, au phrasé exemplaire et d’une intelligence confondante dans l’expression et la couleur (son air Una donna a quindici anni est une leçon), et qui par sa seule présence, par l’expressivité des récitatifs, nous emporte par son abattage et fait crouler la salle sous les rires.

Les deux sœurs s’imposent dès le duo initial Ah guarda sorella magnifiquement mené par Currentzis et chanté de manière exemplaire par Paula Murrihy, Dorabella très en place moins rêche que dans Cherubino, et très expressive notamment dans un smanie implacabili totalement haletant. Mais c’est une fois de plus Nadezhda Pavlova qui compose une Fiordiligi étonnante après la Anna qui nous a tant séduit. Une Fiordiligi impeccable de technique, mais imposante par un chant très habité (come scoglio d’une rare justesse et surtout bouleversante dans Per pietà, ben mio, perdona). La voix n’est pas séduisante au départ mais finit par emporter l’adhésion à mesure qu’on entre dans l’action par sa qualité et sa technique et son intelligence. Une chanteuse à suivre.
Ainsi cette cure Currentzis s’est conclue par un immense triomphe de la part du public de Lucerne, littéralement en folie à la fin du cycle. Le torrent tempétueux Currentzis emporte tout sur son passage. Mais si le personnage est discutable, l’approche musicale l’est peu tant tout est étudié avec une attention redoutable et une précision millimétrée. Mais il faut pour cela des chanteurs convaincus ou à la personnalité suffisamment forte pour savoir s’adapter sans renoncer à leur identité. Il faut un orchestre totalement préparé (aucune scorie pendant les quatre soirs, avec un engagement presque mystique au chef) ; il faut encore à ce stade souligner le rôle déterminant du second du navire, le premier violon Afanasii Chupin qui entraine les musiciens en respirant à l’unisson avec son chef et le chœur MusicAeterna magnifiquement préparé par Vitalii Polonskii au phrasé et la diction d’une clarté cristalline qui en font un des meilleurs chœurs aujourd’hui, ce qu’on avait déjà remarqué dans La Clemenza di Tito.
L’entreprise est unique. Sa réussite éclatante provient de l’habitude de jouer ensemble. Currentzis a mené un groupe de musiciens et chanteurs au départ anonymes à ce sommet par l’habitude de faire de la musique ensemble. Ce travail est le fruit de longues années. Et l’originalité de Currentzis ne peut se déployer, avec ses caractères, son relief et même ses excès que dans ce contexte-là. Il va devenir intéressant d’entendre Currentzis avec la SWR, son autre orchestre, pour entendre la différence. Currentzis a trouvé en MusicAeterna son paradis, ses Champs Elysées, son Olympe.
13 septembre : Concert Bartoli/Currentzis

Rencontre au sommet entre deux stars qui jamais n’avaient travaillé ensemble autour de Mozart, thème des quatre soirs de la « résidence » de l’Orchestre et du Chœur MusicAeterna sous la direction de Teodor Currentzis. C’est l’occasion de passer de Titus à Don Giovanni, de Cosi à la Musique funèbre maçonnique, avec une Cecilia Bartoli éblouissante, engagée, surprenante et même un peu tendue.
Le Lucerne Festival qui, comme on l’a souligné a besoin de hits, a donc fait une publicité autour de ce concert insistant sur cette « première rencontre » de deux géants, et de deux personnalités hors normes, farouchement originales et autonomes. Cecilia Bartoli est liée depuis longtemps au festival, Currentzis plus récemment.
Cecilia Bartoli conclut pour la deuxième année le Lucerne Festival, l’an dernier avec Rossini, cette année avec Mozart puisqu’elle est Despina dans Così fan Tutte le 15 septembre, dernier jour de l’édition 2019 du festival et que ce soir elle est la soliste d’un concert entièrement consacré à Mozart avec des airs d’opéra, des extraits choraux et orchestraux en lien avec la programmation choisie par Currentzis, les trois opéras de Mozart/Da Ponte qu’il a enregistrés.
Pour la première fois, elle travaille avec Teodor Currentzis dont elle découvre le Mozart enflammé, à l’incroyable dynamique et au tempo étourdissant. Au lendemain de Nozze triomphales, c’est un autre triomphe qui sonne sous les voûtes célestes du KKL.
Deux parties au concert, et deux habits pour Bartoli, correspondant aux extraits choisis :
Bartoli est apparue en première partie vêtue en travesti (à cause notamment des extraits de La Clemenza di Tito et du personnage de Sesto) et en deuxième partie en superbe robe de soirée verte. Ce fut par moments étrange parce qu’on avait l’impression que les deux monstres cherchaient à se mesurer, avec une Bartoli presque en sous-régime notamment au départ dans la cantate Davide Penitente KV469 ouverte par le magnifique chœur MusicAeterna et par Bartoli dans l’air Lungi le cure ingrate moins dominé qu’à l’habitude, mais toujours formidablement expressif.
Le chœur montre encore son incroyable qualité dans les extraits de La Clemenza di Tito, et Currentzis impose encore sa vision très dynamique dans une ouverture dirigée de manière haletante, tout en donnant à Bartoli l’occasion de se mesurer à Sesto, un rôle qu’elle connaît parfaitement dans les deux airs Deh per questo istante solo et surtout Parto, ma tu ben moi, l’un des airs les plus connus de la partition que Bartoli interprète avec un sens de l’expression rare, bouleversant même, sans jamais surchanter ou surjouer, avec un naturel mélancolique d’une déchirante vérité.
En deuxième partie, elle chante d’abord l’air de Donna Elvira du Don Giovanni Mi tradi avec un soin de l’expression encore stupéfiant, et une intériorité bouleversante, sculptant chaque mot et donnant du personnage une profondeur inédite, précédé de l’ouverture encore plus énergique et dynamique qu’elle ne le sera le lendemain pour la représentation de l’opéra intégral. C’est ici que Bartoli m’est apparue au sommet de son art, livrant une vision chavirante de cet air.
C’est ensuite le tour de Cosi fan tutte avec l’ouverture anticipant la représentation du dimanche, étourdissante s’il en fût et le duo avec Ferrando Fra gli amplessi in pochi istanti ou le jeune Mingjie Lei lui donne la réplique (il sera Ferrando le dimanche suivant), voix délicate et magnifiquement timbrée, belle technique, mais il semble singulièrement intimidé par la situation et le chant reste un peu raide. Tandis que Bartoli très à l’aise propose un chant d’une délicatesse souriante.
L’air final Ch’io mi scordi di te, extrait de Non temer amato bene KV 505, donne l’occasion d’une démonstration de raffinements et d’agilités avec l’accompagnement au Hammerklavier de la magnifique Maria Shabashova qui laisse la salle en délire.
En guise de conclusion
Difficile de conclure après ces quatre soirées étonnantes. Teodor Currentzis n’est en tous cas pas le phénomène de foire que certains dénoncent. Tout au contraire, il y a derrière cette très démonstrative direction musicale un travail où la partition a été creusée et digérée, qui produit une vision que le chef impose, allant jusqu’à imposer rythme et scansion sous les visages des chanteurs, comme s’il y avait volonté de leur enlever toute liberté d’initiative artistique en se soumettant au chef démiurge : Θεοδόρος παντοκράτωρ Teodor Pantokrator littéralement « Don de dieu tout puissant ». Certes, on peut adorer ou détester, il y a peu de demi-mesures devant cette manière de considérer Mozart, venue du baroque, mais pas seulement et devant cette manière de produire la musique.
Force est de constater l’adhésion des chanteurs qui donne à l’ensemble une grande cohérence musicale, un monde de couleurs nouvelles. Force est de constater aussi à mon avis que c’est le résultat d’un travail approfondi de l’orchestre et du chœur : il y a une correspondance bi-univoque entre chef et masses musicales construite avec les années. Ce Mozart-là, pourquoi pas, mais avec cet ensemble-là, comme un corps presque unique qui d’ailleurs montre le dynamisme de la Russie musicale, qu’on considère toujours comme défendant des approches plus conformes à la tradition, et qui nous démontre ici une audace défendue par perfection technique et surtout esprit de troupe. L’internationalisation de la musique classique a déterminé dans beaucoup d’orchestres un son moins idiomatique, du moins aux dires de certains critiques. C’est ici tout l’opposé : la culture de la spécificité d’une approche « disruptive » comme dirait l’autre semble être l’ADN de cet ensemble.
Enfin, la diversité des voix, et des écoles de chant n’est pas un obstacle non plus : c’est une vraie richesse que cette palette de voix venues du monde slave, du monde germanique ou du monde latin qui réussit à montrer une cohésion de phrasé, de couleur qui sans aucun doute frappe et emporte l’adhésion.
Alors, pour en rester dans les concepts de l’ancienne religion grecque, c’est ici Dionysos qui domine, dans un mystère presque éleusinien qui déchaine l’enthousiasme au sens originel : ἐνθουσιασμός ou possession par le divin.
On peut préférer aussi une relation plus laïque à la musique. Le débat est ouvert.

