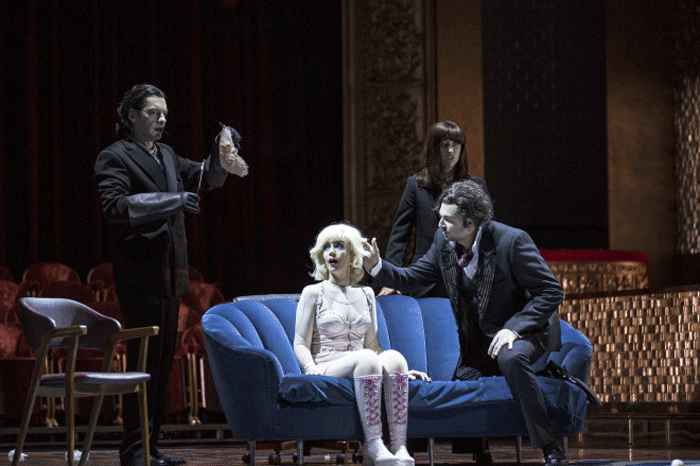Faute de version définitive, assister à une représentation des Contes d’Hoffmann, œuvre inachevée, rappelons-le, reste toujours une surprise. Malgré, ou à cause des recherches les plus poussées réalisées par les musicologues Jean-Christophe Keck et Michael Kaye, auteurs d’une édition critique qui fait aujourd’hui référence, qui ont permis de rétablir l’équilibre entre les actes, de corriger des erreurs et de réintégrer certaines pages oubliées, l’auditeur peine à s’y retrouver. Pour preuve les trois productions présentées cette saison à Bordeaux en septembre, à Bruxelles en décembre et à Paris en janvier, toutes différentes, toutes singulières, toutes légitimes. Mais pour complètes qu’elles soient, ces versions semblent plus que jamais s’appuyer d’abord sur des choix artistiques très spécifiques qui conduisent les chefs d’orchestre à se plier aux exigences du metteur en scène et à procéder à d’inévitables tripatouillages du fait des nombreuses variantes possibles. En d’autres termes les concepts scéniques de Vincent Huguet, Krzysztof Warlikowski ou de Robert Carsen sont devenus presque plus importants que la prétendue recherche historique de la partition, ce qui nous vaut de fréquentes interrogations.

Il serait fastidieux et stérile de relever ce qui les différencie, mais à ce petit jeu des adaptations nous sommes en droit de ne pas adhérer à chacune d’elle et à conserver nos préférences… En proposant à Warlikowski de mettre en scène l’ultime opéra d’Offenbach (seconde incursion du polonais dans le répertoire français après la Médée de Cherubini), le Théâtre de la Monnaie se doutait bien que sa lecture ne serait pas conventionnelle, ce qui explique l’étrange impression qui nous a saisi en visionnant ce document filmé avec talent par François Roussillon et ses équipes (en streaming sur Arte/Concert) : mais à trop en faire Warlikowski ne s’est-il pas perdu en route ?

Hoffmann est ici un comédien-réalisateur au bout du rouleau, sans doute broyé par le système hollywoodien qui l’a utilisé puis rejeté. Seul dans sa maison-studio il erre telle une épave, en sous-vêtements, se repassant les images de ses films passés et de ses amours pour une vedette du 7ème art (la Stella), première référence au film de George Cukor A star is born, le célèbre film joué par James Mason et Judy Garland. Ivre, il croit la revoir en chair et en os, lui demande sa main avant de la chasser. Sur les premiers accords musicaux apparait alors sa maîtresse-assistante, Nicklausse, elle aussi en petite tenue, qui va revivre avec lui l’histoire de sa vie et de sa désespérante quête amoureuse, son studio se transformant au gré de ses souvenirs en cabaret, en théâtre ou en salle de cinéma. Se succèdent alors, comme toujours chez Warlikowski, quantité de personnages interlopes, ballerines sur pointe, savants fous, travestis, jongleur, Joker, barmen, automate, pin-up qui envahissent le plateau et accompagnent ce voyage intérieur qui permet à Hoffmann de revoir les trois femmes qu’il a aimé : Olympia, créature mécanique sans yeux, Antonia une chanteuse camée, et Giulietta, une star du porno. Si l’on ajoute à ce dispositif déjà compliqué que les mêmes chanteurs interprètent plusieurs rôles, qu’Hoffmann est à la fois acteur lorsqu’il « rejoue » les scènes et spectateur, plus précisément réalisateur, puisqu’il ne quitte jamais les lieux, se réfugiant près du bar avec Nicklausse pour suivre le tournage sur un combo, capter les enregistrements ou surveiller la post synchronisation de son film, casque sur les oreilles tandis que son assistante tient le rôle de script…. Vous suivez ? Non ! Ce n’est pas grave, vous n’êtes pas les seuls. En surchargeant le propos, le metteur en scène ne nous facilite pas toujours la tâche, surtout qu’il n’hésite pas à insérer à l’intrigue des images filmées et des scènes parlées où les personnages s’adressent au public, comme lors de cette étrange remise d’oscar à Stella (seconde référence au film de Cukor), alias Betty Hemes, qui prend la parole en anglais puis en français avant d’être interrompue par Hoffmann, ivre mort, qui déclare à l’assistance chercher un emploi et être capable de jouer la comédie…. A trop vouloir courir tous les lièvres en même temps, Warlikowski semble s’être perdu en route !

Dans la fosse Alain Altinoglu tente de répondre à cette foisonnante proposition théâtrale et de coller au plus près aux impératifs scéniques, mais malgré la qualité de la prestation musicale, la tenue du discours et la fermeté du commentaire orchestral, la version retenue n’est pas la plus appropriée. Les scènes ne s’emboitent pas toujours idéalement, des longueurs subsistent et certains airs, tous ici chantés devant un micro, aux textes alambiqués ou tout simplement démodés, se heurtent de plein fouet à cette transposition résolument moderne.
Rompue à cet exercice de haute volée qui lie étroitement le jeu au chant, sous l’égide d’Olivier Py notamment, pour lequel elle a été Lulu, Olympia, Manon ou Blanche de la Force, ou de Joël Pommerat (pour le magnifique Au monde), Patricia Petibon endosse avec courage les quatre portraits féminins, l’artiste, la jeune fille, la courtisane et Stella. Présente à l’écran, filmée sous toutes les coutures, blonde, brune ou rousse, elle se plie aux fantasmes warlikowskiens avec abandon et maitrise. Vocalement la réussite n’est pas aussi irréprochable, mais la soprano a du cran et des réserves pour contourner habilement les suraigus assassins d’Olympia et offrir de surprenantes variations où elle hoquette, éructe, mâchonne, allant même jusqu’à faire l’oiseau ou la sirène. La tessiture d’Antonia n’est pas non plus celle qui sied le mieux à ses moyens actuels, même si le trio avec Miracle et sa mère, campée ici par une grandiose Sylvie Brunet, compte parmi les moments les plus intenses ; l’acte de Giulietta, écrit dans une tessiture plus centrale, est de loin le moins handicapant. Michèle Losier est une troublante Nicklausse, assistante et souffre-douleur toujours prête à épauler Hoffmann, qu’elle aime certainement en secret, et dont le timbre androgyne convient à ce personnage longtemps sacrifié. Avec son physique très typé, sa voix grave et son léger accent, Gabor Bretz incarne avec une belle assurance les multiples visages du diable, le reste de la distribution où l’on retrouve Willard White, François Piolino et Loïc Felix n’appelant aucune réserve.

Eric Cutler enfin, qui aurait dû interpréter le poète en septembre à Bordeaux, finalement remplacé par Adam Smith, corpulent mais vocalement délicat – une espèce de colosse à la douce la voix à la Depardieu – s’avère un Hoffmann en tous points remarquable. La netteté de son français, la souplesse de son phrasé, sa résistance vocale et la tenue de ses aigus sont d’indispensables attributs qu’il met au service d’une interprétation extrêmement fouillée, ou le flamboyant et le pathétique sont intimement mêlés.