
Jean-Pierre Ponnelle est un nom que les amateurs d’aujourd’hui connaissent sans doute de manière fugace : ce parisien de naissance a fait ses études pour partie en Allemagne et fit essentiellement carrière en Allemagne et Autriche. Il a été durant les années 1970 et 1980 l’un des très grands de la mise en scène d’opéra, à qui l’on doit ce chef d’œuvre qu’est la mise en scène de Tristan und Isolde à Bayreuth en 1981.
À Paris, on lui doit deux productions, essentiellement Cosi fan tutte en 1974 sous Liebermann, production solide, mais pas entièrement convaincante dont on se souvient essentiellement par le chef, Josef Krips, qui dirigeait là pour la dernière fois avant sa disparition. Bernard Lefort coproduisit en 1982 Les Contes d’Hoffmann avec le Festival de Salzbourg, mais destinée à l’espace immense du Grosses Festspielhaus de Salzbourg, cette production fut présentée à l’Opéra-Comique qui en terme d’espace ne peut être comparé… D’une production qui respirait à Salzbourg, on passa à une production qui étouffait à Paris, qui entre parenthèse possédait le chef d’œuvre qu’était la production Chéreau, mais elle avait le grand tort d’être une production du prédécesseur détesté Rolf Liebermann… L’absurde régnait déjà à l’Opéra de Paris.
Enfin, une trentaine d’années après (!) Nicolas Joel décida de proposer pour mémoire et en hommage pendant deux saisons (2011–2012 et 2012–2013) la production munichoise de La Cenerentola, qui est encore au répertoire aussi bien de Munich que de la Scala. 36 ans après la création munichoise de cette production (créée à Milan en 1973) et 23 ans après la disparition de Ponnelle, il était peut-être temps qu’on s’en souvienne. Et l’initiative de Nicolas Joel n’était pas une mauvaise idée.
Nemo profeta in patria (même si l’on avait parlé de lui pour l’Opéra Bastille). Il reste à l’amateur de très nombreuses vidéos avec les plus grands chefs de l’époque : hors les Rossini (Abbado), et Tristan und Isolde (Barenboim) ainsi que des enregistrements avec Böhm ou Karajan, il faut marquer d’une pierre blanche la trilogie Monteverdienne qu’il signa avec Harnoncourt et qui fit de beaux soirs à Zurich : cet enregistrement est sans doute ce qui lança dans le public l’ère baroque.
Ceux qui ont eu la chance de voir plusieurs de ses productions savent que Ponnelle, c’est d’abord un univers esthétique homogène puisqu’il signait mise en scène, décor et le plus souvent les costumes… Que ce soit pour ses Rossini, ou son Tristan à Bayreuth, on se souvient d’abord d’images.
Cette production de deux piliers du répertoire était évidemment destinée à durer – sa présence dans les programmes viennois aujourd’hui encore en est la preuve. Les productions précédentes des deux opéras dataient de 1959 et elles avaient fait leur temps après environ 150 représentations ; Cavalleria rusticana était signée Wolf-Dieter Ludwig dans des décors de Nicola Benois, et I Pagliacci (dont l’entrée au répertoire à Vienne en 1908 était dirigée par Bruno Walter) était une production de Paul Hager avec des décors de… Jean-Pierre Ponnelle qui était déjà en 1959 un décorateur apprécié.
Comme quelques autres décorateurs de grand talent, Ponnelle est arrivé assez vite à la mise en scène. Et cette production est en quelque sorte une production de fin de carrière, puis qu’il disparut trois ans après.
Pour les deux œuvres, il a conçu un décor de pierre brute, des maisons, des églises de pierre, des montagnes ou des falaises au loin, il n’y rien de vert, rien de riant : la sécheresse et la rudesse dominent. L’espace de Cavalleria Rusticana et celui de I Pagliacci se ressemblent, des places de village au pied d’une église, seuls les points de vue changent. Les deux opéras, liés pour l’éternité (en dépit d’efforts ces vingt dernières années pour les accoupler à d’autres œuvres brèves) racontent tous deux des drames de la jalousie, mais n’ont pas du tout la même genèse.
Cavalleria rusticana est une histoire sicilienne dont le livret de Giovanni Targioni-Tozzetti trouve son origine dans l’œuvre du très grand romancier sicilien Giovanni Verga, le créateur du vérisme littéraire, très influencé par le naturalisme français (on pourra en ces temps de confinement lire son chef d’œuvre I malavoglia, de 1881).
Pagliacci tire son origine d’une histoire d’enfance de Leoncavallo, élevé en Calabre, un fait divers dont fut victime son tuteur, assassiné par un mari jaloux. On passera sur les débats et les accusations de plagiat de Catulle Mendès contre Leoncavallo, accusé d’avoir copié la trame de La Femme de Tabarin, une « tragi-parade » de 1876, qui était aussi l’histoire d’un crime passionnel perpétré à travers une trame de « théâtre dans le théâtre », il est vrai très proche de la trame de Pagliacci.
C’est Leoncavallo lui-même qui signe le livret de Pagliacci.
En effet les deux histoires qu’on a désormais l’habitude de voir sous le même prisme sont conçues de manière différentes et racontent deux meurtres commis dans des modes très différents.
Cavalleria est une œuvre « chorale » au sens où l’on est le jour de Pâques, on va à l’église, tout le village est dehors et le drame se déroule sous les yeux de tous, les chœurs sont très abondants et se tressent aux scènes plus intimes : un peu comme l’acte IV de Carmen (un drame de la jalousie, là aussi) où le drame se déroule presque sous les yeux de tous, et où tout commence par la fête. C’est l’ambiance du village sicilien, sur lequel la religion pèse très fort, – encore plus un jour de Pâques‑, où les protagonistes sont une femme rejetée parce qu’enceinte hors mariage, Santuzza, qui se rend compte que Turiddu, l’homme qu’elle aime et pour qui elle a sacrifié sa réputation, la trompe avec l’épouse d’un bon bourgeois du village, Alfio. De désespoir, elle dénonce Turiddu à Alfio, qui en un duel au couteau tuera Turiddu. Crime d’honneur, Alfio ne pouvant tolérer d’être cocu aux yeux de tous. Les personnages sont dessinés d’une manière rapide mais précise. Le centre en est Santuzza, la désespérée, qui cherche consolation auprès de la mère de Turiddu, Mamma Lucia, un rôle souvent donné aux très grandes chanteuses en toute fin de carrière.
Il y a dans le drame quelque chose de la tragédie grecque avec le chœur et les protagonistes, évoluant exclusivement sur la place du village, espace unique du drame, sorte d’orchestra du théâtre grec. La durée très brève, en un seul acte, fait de l’histoire le dernier moment d’une crise qui couve depuis longtemps, et constitue l’ingrédient de la tragédie. Et Santuzza est une très lointaine cousine de Phèdre, qui envoie l’être aimé à la mort, par désespoir de ne plus être aimée en retour. C’est une Chanson du mal aimé.
I Pagliacci qui a aussi des chœurs est cependant une œuvre en deux actes, centrée autour des personnages où chacun joue un rôle, de manière plus complexe que dans Cavalleria rusticana, avec une dramaturgie plus élaborée, même si tout aussi ramassée.
Au centre Canio, le patron d’une petite compagnie théâtrale itinérante, époux passionné (et jaloux) de Nedda, bien plus jeune, qui le trompe avec Silvio avec lequel elle veut fuir. Silvio est extérieur à la compagnie, c’est l’ailleurs, au contraire de tous les autres personnages qui sont les comédiens du spectacle dont chacun va constituer un ingrédient du drame qu’ils jouent chaque soir, où Pagliaccio tue Colombina parce qu’elle file le parfait amour avec Arlecchino.
La réalité, c’est que Tonio est amoureux de Nedda, que celle-ci le repousse violemment. Comme il l’a vue avec Silvio, il va dénoncer la jeune femme à Canio, qui le soir dans les habits de Pagliaccio tuera sa Nedda-Colombina, comme il tuera Silvio accouru pour la secourir.
Plusieurs éléments originaux et intéressants d’une trame plus originale qu’on ne le pense habituellement.
D’une part le prologue, chanté par Tonio : c’est une manière de donner au baryton un rôle plus important et un grand air (n’oublions pas que le créateur en fut Victor Maurel, le créateur du Falstaff de Verdi), mais aussi démonter le système dramaturgique de l’œuvre, le théâtre dans le théâtre, la confusion entre vie et théâtre, réalité et fiction et l’impossibilité pour le comédien de faire abstraction de sa situation propre.
La présence du chœur n’est pas aussi importante dans Pagliacci que dans Cavalleria : les deux fois le drame se joue sous les yeux de tous, mais dans Cavalleria sa présence est structurelle parce que c’est un drame villageois, sur la place, au vu et su de tous.
Dans Pagliacci, le chœur est spectateur de l’arrivé des comédiens, puis du spectacle, sans tout d’abord comprendre que le drame qui se joue sous ses yeux est « réel », que la « commedia è finita » (dernière parole de l’opéra) depuis le lever du rideau sur le spectacle des clowns : ils s’attendent à une farce, et c’est un drame qui se déroule. Il y a là toute une réflexion sur le théâtre, sur l’acteur, sur le public qui est sous-jacente.
Enfin, les personnages, même en un temps court, sont tous dessinés, Canio le chef de troupe mur, Nedda sa femme plus jeune et lasse de sa vie, Silvio le jeune homme qui représente l’autre vie, Tonio le clown difforme qui passe de l’amour à la haine, et Beppe l’homme à tout faire qui joue Arlecchino dans la comédie, le séducteur un peu inoffensif, et les utilités derrière le théâtre.
Chacun des personnages est en place et chacun est acteur du drame. C’est beaucoup plus élaboré que dans Cavalleria ; dans Cavalleria, on est tout de suite dans le drame, dans Pagliacci, le drame se construit, d’autant plus rapidement qu’il correspond par sa rapidité à la transformation de Canio en héros désespéré qui passe du rire à la tragédie (Ridi Pagliaccio).
Pour autant qu’on puisse juger d’une mise en scène créée il y a 35 ans, par un metteur en scène disparu depuis 32 ans, il faut souligner que dans le système de répertoire, les cahiers de régie, le matériel de mise en scène est toujours précis et se transmet pour respecter au moins l’esprit original, au moins sur l’ordonnancement du travail. Moins évident est le respect de la conduite d’acteur : peu de répétitions, des successions alternées de personnalités différentes fait évidemment qu’entre Elena Obraztsova, Santuzza de 1985 et Eva-Maria Westbroek Santuzza de 2020 (qui interprétait le rôle pour la première fois à Vienne), tout comme entre Domingo en 1985 (qui était d’ailleurs ce soir dans la salle) et Alagna en 2020, les choses ont évolué et les personnalités sont diverses.
Cavalleria rusticana

La mise en scène de Ponnelle respecte la place de village comme lieu unique du drame, qui est le sens de l’œuvre (Philipp Stölzl à Salzbourg en 2015 ne respectait pas cette unité de lieu), et l’impression que tout se déroule sous les yeux de tous, et notamment le défi entre Alfio et Turiddu. De même la distribution des lieux : l’Église, écrasante qui est le monument, dont Santuzza est exclue (ou s’exclut), parce qu’excommuniée ‑elle est déshonorée par Turiddu hors mariage – qui ne peut se tourner que vers Mamma Lucia, dont la maison est à jardin, à l’opposé, au premier plan, tandis que celle de Lola et Alfio est juste à côté : resserrement des lieux qui donne à la présence des personnages une logique. C’était le choix qu’avait fait Strehler dans sa mise en scène à la Scala dans les années 1960 enregistrée par Karajan en 1968.
On sent d’ailleurs dans ce travail le soin du spectaculaire, notamment dans les déplacements du chœur, si important dans l’œuvre (Mascagni s’inspire de mélodies populaires et adorait le spectacle de l’opérette) Ponnelle dans son décor conçoit deux niveaux, celui de la place un peu surélevé et un espace au proscenium où les personnages se rencontrent : le lieu des conflits et des drames. Et tout cela construit une vision évidemment traditionnelle, mais avec de belles images, certainement plus sobres et souvent plus fortes que que celles de Zeffirelli auxquelles on le compare parfois (par erreur à mon avis). Il n’y a rien d’anecdotique chez Ponnelle, qui veut d’abord dessiner une ambiance.
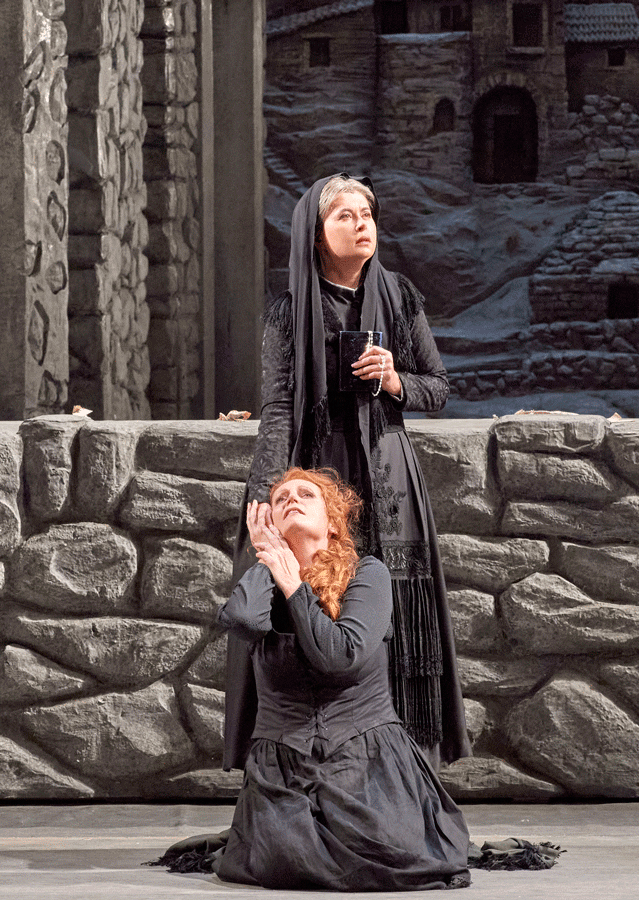
Eva-Maria Westbroek est Santuzza : un rôle dramatique, à la limite de l’expressionnisme. Toute vêtue de noir, selon la tradition des femmes siciliennes. Un personnage d’ailleurs typiquement tragique, d’abord par son statut d’exclue de la communauté parce qu’elle a péché hors mariage, et la musique le souligne bien quand le chœur entame le Regina coeli, symbole pour le chœur de la conformité à un ordre moral immuable face à une Santuzza isolée qui cherche auprès de Mamma Lucia un réconfort. Le chœur a une importance musicale et dramaturgique dans Cavalleria, il représente la tradition, l’habitude, la coutume, la religion. Tout l’opposé de ce que vit Santuzza.
Mais comme certains héros tragiques (on pense, mais oui, à Elektra) Santuzza est incapable de se venger seule, et utilise Alfio comme outil de sa vengeance, elle se venge par personne interposée, tout comme Elektra passe soit par sa sœur soit par son frère, pour assouvir sa haine. Santuzza est prisonnière des autres, prisonnière d’elle-même et de son amour qui lui fait se venger par un autre pour en assumer la responsabilité partielle, et même prisonnière de son nom car elle porte un prénom antithétique de sa situation : Santa (Sainte) comme l’appelle Alfio, dont Santuzza est le diminutif, le rôle requiert à la fois une grande expressivité et une voix puissante, mais aussi une expression de faiblesse, de contradictions, et la puissance de la voix est inversement proportionnelle à la (ou l’in)capacité d’agir du personnage, d’où une voix hybride, entre le soprano dramatique et le mezzo, et ainsi on relève (à Vienne) Grace Bumbry, Agnès Baltsa, Fiorenza Cossotto, Gwyneth Jones, Waltraud Meier, Elena Obraztsova, Elina Garanča, Violeta Urmana, Giulietta Simionato, c’est à dire évidemment des voix grandes, qui ont souvent navigué entre deux tessitures : l’aigu est très sollicité, le volume également. Eva-Maria Westbroek qui a tenu des rôles importants de soprano dramatique, peut être une Santuzza, mais on a vu aussi ailleurs (à Palerme) la Santuzza toute différente, encore plus humaine et encore plus fragile, d’une Sonia Ganassi. Malheureusement, méforme passagère, anxiété (c’était la première représentation), la voix passe certes, mais a perdu des harmoniques, de la profondeur et du volume : certes, l’interprétation reste dramatique, et engagée mais il faut un ouragan dans ce rôle, un ouragan qu’elle n’est pas ou plus, et elle n’a pas l’émission et la diction italienne qui pourraient compenser le volume par la couleur. La prestation est très honorable, mais on sent la chanteuse à la limite de ses réserves à l’aigu qui perd de l’assise, avec des stridences et des acidités ainsi que des instabilités dans la voix. C’est peut-être actuellement un rôle qu’elle devrait laisser de côté. Rien de délétère ni de scandaleux, mais rien d’exceptionnel non plus.

Turiddu n’est pas un rôle très sympathique ni très intéressant, et pas toujours distribué à des ténors de tout premier plan, face à une Santuzza ouragan. Brian Jagde qui faisait ses débuts à l’opéra de Vienne, ne correspond pas du tout à ce profil fade : le timbre est très chaleureux, lumineux, le volume important, la diction impeccable comme souvent chez les américains : il a une vraie présence vocale, claire, solaire et il a impressionné par une prestation vraiment solide, où il sait aussi rendre le personnage presque émouvant à la fin, quand il se rachète et montre sa dépendance à sa mère. Beau début.
Le couple est tout dans cet opéra, même si l’Alfio d’Ambrogio Maestri est comme on le suppose, très solide et exemplaire, c’est dans Tonio de Pagliacci qu’il va montrer qui il est.
Jolie Lola de la jeune Isabel Signoret, membre du Studio de l’opéra de Vienne, et enfin la très correcte et sobre Mamma Lucia de l’ukrainienne Zoryana Kushpler, à la voix profonde et juste, qui l’a chanté aussi lors de la dernière reprise (un rôle que Margarita Lilowa a tenu 67 fois dans cette maison, et que Martha Mödl chantait à Munich) : on rêve de voir Agnès Baltsa le chanter dans sa maison…
Dans un opéra où le chœur est aussi important, la prestation de celui de la Staatsoper préparé par son chef Thomas Lang est impressionnante d’engagement, de puissance, mais avec un phrasé exemplaire : les moments choraux sont vraiment exceptionnels.
Pagliacci

L’ambiance construite par Ponnelle apparaît dans Pagliacci légèrement différente, parce qu’essentiellement nocturne. Par ailleurs l’espace scénique ressemble à Cavalleria (une place de village) mais selon un angle différent. Un espace rude, essentiel, qui va accueillir le camion de Canio. L’époque est postérieure à celle de Cavalleria, et la scène va être essentiellement occupée par le camion, qui est « la » scène. Alors, le chœur, présent dans Pagliacci, occupe essentiellement l’arrière-plan, celui des spectateurs. L’une des originalités de la mise en scène est de montrer non la scène avec son public, mais les coulisses, l’arrière scène qui est le réel lieu du drame en rejetant le public en arrière-plan.
Ce jeu place donc les spectateurs en miroir, il y a ceux figurés de la scène, qui regardent le spectacle, et il y a les spectateurs « vrais » (nous) qui sommes avertis et regardons de derrière « derrière les yeux », c’est à dire la vérité. Ainsi Ponnelle construit-il l’œuvre en abîme comme le discours du prologue le souligne et place-t-il le drame au centre entre vrais et « faux » spectateurs.
C’est toute la mécanique théâtrale que Ponnelle choisit de montrer, dans une sorte de pittoresque désordonné, rendant aussi les déplacements difficiles parce que la scène est envahie d'objets : tout à l’inverse de Cavalleria ou le centre est vides et les circulations aisées. Cette concentration dobjets, d’où émerge la scène de la « commedia » qui vue du public ressemble à un échafaud où va se concentrer le drame, montre aussi la concentration d’éléments du livret qui conduisent au drame, amours secrètes, jalousies, rêves d’une autre vie, tout cela construit des fils qui s’entrecroisent dont le drame va trancher le nœud gordien.

Et si Cavalleria nous a fait penser au quatrième acte de Carmen, de nouveau nous revenons à Carmen à travers le personnage de Nedda, qui n’est pas la « pute abjecte » (« meretrice aietta » dont la qualifie Canio ) parce que jusqu’au bout, et même sous la menace du couteau, elle refuse de dénoncer son amant, tout comme Carmen sous la menace de la lame refuse d’aliéner sa liberté d’aimer. Il y a entre les deux femmes et entre les deux scènes une évidente parenté, et Nedda meurt grandie et non avilie. Une fois de plus se constate l’influence énorme que l’œuvre de Bizet peut avoir sur tout ce répertoire dit « vériste », qui doit tant au naturalisme littéraire qui s’attache à la description du réel, du réel des petites gens quand l’opéra était celui de dieux, des déesses, des princes et des princesses. On considère souvent aussi bien Pagliacci comme Cavalleria comme des standards un peu éculés, on oublie l’épaisseur culturelle et la transformation des modes, des idées, de la culture qui ne sont pas l’apanage des œuvres italiennes et qui vont aussi jusqu’à Wozzeck, autre drame de la jalousie chez les petites gens, la jalousie, cette ligne de force de l’opéra de la fin du XIXe, à partir d’Otello
Du point de vue du chœur, il est très au point encore dans Pagliacci, bien ciselé avec un beau phrasé et un parfait synchronisme avec l’orchestre, notamment dans son morceau de bravoure, aussi célèbre qu’inutile dramaturgiquement
« Din don, suona vespero,
ragazze e garzon, », un morceau de bravoure qui fait étrangement penser à España de Chabrier – qui lui alla en Espagne – (encore et toujours ces influences directes et indirectes de Carmen).
Et c’est une véritable fête vocale et scénique qui montre que la mise en scène fonctionne encore : Ambrogio Maestri est souverain, comme d’habitude d’ailleurs, dans Tonio et notamment dans un prologue impressionnant par la diction, l’expression, l’ironie discrète, et aussi les aigus percutants et la couleur, donnant à ce prologue une puissance impressionnante. Il change totalement d’allure et de style dans l’opéra, devenu à la fois terrible et dérisoire face à Nedda où l’amour se transforme en ressentiment, voire haine inexpiable avec une stupéfiante expressivité du chant. Vraiment grandiose.
À côté de lui, le Beppo élégant d’Andrea Giovannini, au timbre clair, membre de la troupe de Vienne depuis septembre dernier, donne sa « Canzone di Arlecchino » très réussie et une autre jolie découverte avec un Silvio interprété par Sergey Kaydalov, baryton russe qui a intégré lui aussi la troupe de Vienne en septembre dernier et qui ce soir faisait ses débuts sur la scène de l’Opéra. La voix est bien posée, la diction claire, et malgré une émission typiquement slave il montre un vrai souci de l’expression. La prestation bien maîtrisée laisse espérer un joli futur.

Et puis le couple de la soirée, Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, qui faisaient leur début à Vienne dans les deux rôles.
Alexandra Kurzak est parfaitement à l’aise dans Nedda, avec un jeu très fluide, très engagé et un soin du mot bien marqué et attentif. Vocalement la prestation est convaincante, notamment dans la manière de chanter son long air initial « Qual fiamma avea nel guardo ! » qui se termine dans la légèreté et l’insouciante, mais ses deux duos l’un avec Tonio et l’autre avec Silvio montrent deux autres facettes, l’une plutôt dramatique très réussie et l‘autre lyrique, avec peut-être une pointe d’aigu un peu grêle.
Et au climax de l’opéra dans sa scène finale avec Canio elle gratifie d’aigus puissants et très expressifs. C’est donc une Nedda très juste qui sait traduire intelligemment les différents états du personnage et au total vraiment réussie. On a vu plus haut combien le personnage doit à Carmen, et il faut une vraie personnalité scénique pour l'incarner et convaincre en peu de temps : nous y sommes.
Roberto Alagna vrai ténor lyrique au départ a abordé depuis plusieurs années des rôles plus lourds comme Otello ou Samson, rien d’étonnant à le voir chanter Canio, pour la première fois à Vienne où il a chanté à peu près tous les grands rôles de ténor italiens ou français.
Qu’il me soit permis d’évoquer un souvenir très personnel : il se trouve que j’ai assisté en 1989 à l’audition pour Traviata qu’il donna, tout jeune espoir du chant, dans la salle de la Scala de Milan, sous l’œil attentif de Riccardo Muti. Pour parodier Flaubert, « ce fut comme une apparition », déjà une incroyable clarté dans la diction et l’expression, déjà ce timbre juvénile et frais, déjà cette couleur solaire. Il ne faisait aucun doute que dans cette distribution jeune que Muti recherchait, il serait Alfredo parce qu’il était Alfredo. C’était une évidence.
Et en l’écoutant ce soir à Vienne, en écoutant encore ce timbre, cette diction, cet engagement, on se disait que les qualités initiales étaient encore là, à 57 ans avec une joie de chanter qui transpiraient, dès ses premiers mots.
Évidemment il gratifie d'un « Vesti la Giubba » bouleversant, incarnation du clown détruit avec une voix encore aussi lumineuse, une expressivité qui tire les larmes parce que le soleil de la voix fait aussi ressentir la couleur du drame : on entend évidemment Otello derrière ce Canio, qui est sans doute le modèle de Leoncavallo : qu’elle soit justifiée ou non, la jalousie est un moteur mortifère à l'opéra, comme la brûlure d’un soleil crépusculaire. Si Carmen plane au-dessus de Cavalleria et un peu au-dessus de Pagliacci à cause de Nedda, Otello plane au-dessus de Pagliacci, jusqu’aux finesses dramaturgiques du début avec son chœur initial d’où va émerger Canio déclarant son amour si exclusif pour Nedda, un peu comme du chœur va émerger Otello pour son Esultate : bien sûr le propos est différent, mais la mise en relief dramaturgique est voisine. Cette ombre portée d’Otello rend Alagna encore plus déchirant, encore plus vrai, et sans jamais exagérer, avec le naturel de l'évidence. Pouvait-il en être autrement ? Alagna a déchainé une de ces ovations dont seule Vienne a le secret, où des « bis ! » fusaient. On oubliait tout, Covid, masques, jauge réduite et on était à l’opéra, dans cet instant suspendu où tout s’efface quand le chant est exceptionnel. Ce soir, Alagna fut d’une vérité déchirante. J’ai vu Vickers, Carreras, Domingo, Kaufmann dans ce rôle, tous exceptionnels, tous inoubliables, et dans ce défilé de diamants, Alagna a sa place, avec sa singularité, qui s’appelle le naturel, la simplicité et l’énergie. Quel moment !

Et pour cette soirée exceptionnelle, un orchestre vraiment exemplaire : Marco Armiliato a dirigé avec feu, avec attention à la scène, en exaltant les richesses harmoniques des deux œuvres.
Il souligne le côté très charnu et symphonique de Cavalleria, mais aussi très pittoresque (Mascagni a utilisé des rythmes et des mélodies siciliennes) et assez spectaculaire sans jamais être surjoué, toujours avec un volume maîtrisé. Il y a dans Cavalleria rusticana un mélange de sicilianité notamment par le livret, une Sicile qui est un peu comme l’Espagne de Carmen ou plus tard le Japon de Butterfly : Puccini n’est pas allé au Japon (il se contentera de rencontrer la femme de l’ambassadeur du Japon en Italie), pas plus que Bizet en Espagne, mais ils ont représenté l’idée qu’on pouvait en avoir au point que pour Carmen notamment, cette musique est devenue un emblème d’Espagne. Mascagni est livournais, il a étudié au conservatoire de Milan, et même s’il va travailler à Cerignola, ville des Pouilles et donc du Sud, rien ne le relie à la Sicile. C’est donc ici une représentation de la Sicile, une sorte d’exotisme intérieur, comme la Sicile est vécue par certains italiens encore aujourd’hui. C’est ce côté « exotique », cette manière de représenter la tradition, d’intégrer des rythmes locaux, qui est peut-être part du succès immédiat de cet opéra, qui doit beaucoup à la Carmen de Bizet comme on l’a écrit plus haut. Il y a dans l’œuvre un incomparable parfum méditerranéen. Il faut méditerraniser la musique disait Nietzsche dans Le Cas Wagner ((F.Nietzsche, Le Cas Wagner, Ed.Garnier-Flammarion p.192)) et ce qu’il dit sur la musique de Bizet pourrait aussi au moins partiellement s’appliquer à cette musique de Mascagni, qui connaissait évidemment Carmen. Et Armiliato dans sa conduite de l’orchestre fait respirer fortement cette odeur-là, cette sève méditerranéenne qui parcourait ce soir l’orchestre viennois.
Dans Pagliacci, il est encore plus attentif aux chanteurs parce que l’opéra est plus « joué », plus conversatif, et il fait sonner l’orchestre de manière à montrer aussi ce que la partition peut avoir de plus inattendu que celle de Mascagni antérieure de deux ans ; Pagliacci sonne presque plus « moderne », avec des mélodies discontinues, construites sur des contrastes, sur des changements brutaux de rythmes, sur des ruptures, accompagnant les hoquets de la comédie, avec des allusions à la musique de cirque et en même temps émergent des trouvailles mélodiques superbes (l’intermezzo). Il y a dans la musique de Leoncavallo une volonté d’être dans le réalisme, presque cinématographique et comme pour Mascagni, de s’adresser à un public populaire, le cirque, le village, le sud (ici la Calabre, encore plus désolée que la Sicile) sans rompre cependant avec un public plus averti, avec son jeu de références, sa dramaturgie plus raffinée, et sa musique peut-être plus diversifiée et plus complexe répondant à une construction plus subtile.
On sait qu’Armiliato est un des chefs qui comptent dans l’opéra italien, et il confirme ici sa belle réputation car il dirige cette représentation de répertoire loin de la routine que le mot pourrait induire ; il lit ces partitions si rebattues en leur donnant un relief surprenant qui éveille l’intérêt. Donnez-nous encore du répertoire de cette qualité ! L'orchestre de la Staatsoper a brillé de ses feux, avec ses cordes soyeuses, si marquantes dans Cavalleria rusticana et ses bois et cuivres sans faiblesses et stupéfiants dans Pagliacci. C’est une grande interprétation qui montre comment ce répertoire souvent méprisé peut sonner juste : avec cet encagement, avec la clarté de cette direction et de ce rendu, on pensait intensément à un Gianandrea Gavazzeni, qui savait exalter et rendre passionnantes des musiques de cette époque qu’on pensait superficielles et sans intérêt.
J’écrivais plus haut que le système de répertoire faisait partie de l’ADN de ce théâtre : nous en avons là la preuve, ce soir ou répertoire ne rime pas avec routine, ce qui peut être aussi quelquefois le cas. Dans cette période grise et dramatique qui a touché Vienne dont les théâtres fermaient trois jours après (le soir même de l’attentat islamiste) ce vendredi soir était un îlot de joie, de retrouvailles avec le beau chant et l’opéra : enthousiasme et sourire de l’opéra vécu comme une fête. Merveilleuse soirée.
