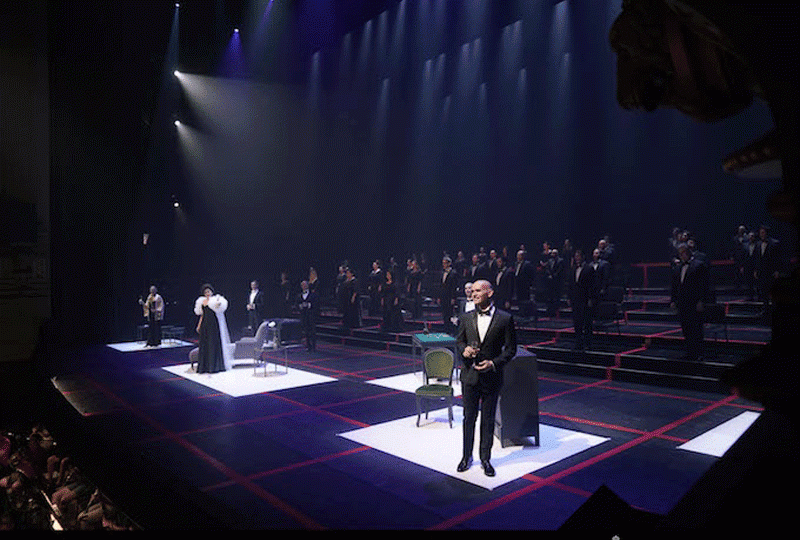Vingt-sept représentations, pas moins, pratiquement tous les jours du mois de juillet. Deux chefs d'orchestre, Nicola Luisotti et Luis Méndez Chaves ; cinq Violetta, Marina Rebeka, Ruth Iniesta, Ekaterina Bakanova, Lana Kos et Lisette Oropesa ; quatre Alfredo, Michael Fabiano, Ivan Magrì, Matthew Polenzani et Ismael Jordi ; quatre Giorgio Germont, Artur Rucinski, Nicola Alaimo, Luis Cansino et Javier Franco. La taille même de l'entreprise est déjà étonnante. Pour revenir à la réalité lointaine d'avant le déclenchement de la pandémie, les plans du Teatro Real étaient de proposer La Traviata dans la saison 2019/20 (celle qui a été tronquée) en deux séries de représentations, en mai et en juillet, dans la célèbre production de Willy Decker. Aujourd'hui, la distanciation sociale est devenue un présupposé de pratiquement toute activité de la vie commune, ou de la vie tout court, de sorte que la production de Decker ne pouvait pas être reprise.
À sa place, Leo Castaldi signe ce que le théâtre annonce pudiquement comme un "concept scénique", en réalité une véritable mise en scène de l'œuvre, bien que radicalement limitée dans ses possibilités, ses caractéristiques et ses prétentions en raison du protocole sanitaire. Le sol noir de la scène est tatoué d'une grille rouge, qui marque sans doute les espaces dans lesquels chacun des artistes sur scène peut se déplacer.

La “cellule” de Violetta se trouve au centre, près du proscenium, attirant l'attention de tous, mais aussi isolée des autres, de sorte que la solitude de la protagoniste a rarement été mise en évidence de manière aussi drastique et directe comme en cette occasion. La distance généreuse qu'elle maintient toujours par rapport à son grand amour Alfredo suggère à la sensibilité que peut-être il n'est, comme le reste des personnages, qu'une présence dans l'imagination fiévreuse de la courtisane, fantômes entre le réel et l'imaginaire, qui peuplent son délire final, dans le lit qui occupe la scène au cours du dernier acte. Cette distance suggère peut-être aussi l'absence d'un engagement profond chez ce jeune homme impulsif, comme l'a brillamment montré Tcherniakov dans son travail de décembre 2013 pour la Scala. Une bonne partie du drame de la Traviata réside (et c'est une des raisons pour lesquelles il s'agit d'une œuvre capable de transcender son temps) dans l'incapacité des protagonistes à s'affranchir du cadre de conventions qui leur est socialement imposé hic et nunc, ce qui fait du chœur, incarnation ou personnification collective des mœurs et de la morale, un protagoniste de l'action plus important qu'on ne peut le deviner d'après la partition.
Dans cette production, le chœur, sinistre, vêtu de noir (fossoyeurs ou bourreaux ou démons), occupe le fond de la scène, chacun de ses membres également équipé dans sa grille, un spectateur muet du duo d'amour du premier acte, plus ou moins visible dans chaque scène grâce au jeu réussi des éclairages, qui suffit à multiplier les espaces. Contrairement au travail de Simon Stone au Palais Garnier, qui, dans un souci de diffusion (cherchant à populariser le genre au-delà du cercle des fidèles initiés) a transféré l'action dans notre monde contemporain technicisé et frénétique (c'est-à-dire le monde d’avant), le concept de Castaldi ne cherche pas à éloigner l'intrigue de l'espace qu'elle a plus ou moins établi dans la convention du spectateur (fidèle), ni à donner à l'action un ton particulièrement agressif ou incisif. C'est une lecture essentielle, raffinée, pratiquement nue, d'un cadre simple, presque abstrait, à partir duquel l’imagination du spectateur doit se développer pour rencontrer la personnalité de chaque interprète, et surtout, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour retrouver la sublime musique de Verdi
Et la direction musicale, pour l'occasion, a été confiée à Nicola Luisotti, indispensable ces derniers temps à la ville comme à la cour quand il s’agit de répertoire italien, même s'il n'est pas, à proprement parler, un poète, convenons-en. Mais cette fois, l'émotion, grâce à sa direction, aux musiciens de l’orchestre, au compositeur ou à la longue période d'abstinence forcée, est incomparable dans le développement presque immatériel des cordes pendant les premières mesures de l'œuvre. Au centre d'une fosse agrandie (aux dépens du public), afin de permettre une plus grande distance entre les musiciens, Luisotti dessine avec une grande intensité les phrases des Préludes du premier et du dernier acte, en essayant d'accentuer au maximum les variations de la gamme dynamique, donnant à l'expression une atmosphère de feu qui semble parfois plus typique de l’opéra italien des années 1890 que celle de 1853. Ainsi, le volume de l‘orchestre atteint parfois des hauteurs qui ne sont pas très confortables pour les solistes ; à d'autres moments, les détails de l'écriture instrumentale sont soigneusement mis en valeur.
La distribution des rôles de complément a été confiée, une fois de plus en raison des l'exigences pandémiques, à une équipe locale, qui s'acquitte de sa tâche avec un professionnalisme irréprochable, et dans laquelle il n'est que juste de consacrer une mention spéciale aux accents émouvants que le vétéran (et excellente basse) Stefano Palatchi sait donner au rôle du Docteur.
De l'Alfredo du sicilien Ivan Magrì, on retiendra la couleur méditerranéenne, l'impétuosité de l'accent, l'extraversion et l'immédiateté avec lesquelles il conçoit un personnage d'autant plus authentique qu'il semble être fait d’un bloc, sans les nuances que lui ont prodigué d'autres interprètes ; si bien que certaines de ses phrases gagneraient probablement en impact si elles étaient abordées de façon un peu plus intériorisée.
C'est précisément la voie que le splendide Nicola Alaimo a choisie, en utilisant la subtilité, la fantaisie et l'éloquence d'un véritable acteur-chanteur dans ses phrases. L'instrument, peut-être une conséquence directe de la température atroce en Castille en ce mois de juillet, ne se développe pas avec la rotondité et la générosité d'autres occasions, mais l'artiste sait donner à son personnage une réelle autorité et une subtile noblesse. Si La Traviata est l'histoire de la descente aux enfers de la protagoniste afin de rendre son bien-aimé à la vie sociale, Alaimo en vient à jouer le rôle d'un Charon hiératique, féroce et en même temps sensible.

Mais bien sûr, tout le spectacle tourne autour de la protagoniste. Pour les quatre représentations interprétées par Lisette Oropesa, il a suscité une attente tout particulièrement fiévreuse chez les fans madrilènes, qui il y a déjà deux ans avaient fait un énorme triomphe à sa Lucia. La carrière de la soprano américaine (récemment naturalisée citoyenne espagnole), déjà plus longue qu'il n'y paraît ((Les plus attentifs se souviendront peut-être de sa lumineuse présence dans le rôle d'Ismène dans le Mitridate, re di Ponto, qui avait été proposé par la Bayerische Staatsoper au Prinzregententheater en juillet 2011, Dir : Ivor Bolton / Mise en scène : David Bösch)), semble occuper une place encore plus importante ces derniers temps, grâce à des très grands succès comme sa célèbre Marguerite de Valois dans Les Huguenots de l'Opéra Bastille ou de sa passionnante Amalia dans I Masnadieri de La Scala. Oropesa a conçu Violetta Valéry précisément sur la base solide de la tradition belcantiste, en déployant un chant d'une rare pureté, d'une perfection vertigineuse, d'un équilibre admirable. Elle a un formidable contrôle de la respiration, ce qui lui permet au deuxième acte une exquise énonciation de Dite alla giovine, un moment de rare concentration, dans lequel elle rend le théâtre muet devant la qualité de l’expression, comme absorbée, rêveuse, obtenue grâce à la généreuse amplitude de la tenue de souffle. Et comme on pouvait s'y attendre de la part d'une chanteuse qui maîtrise si bien les ressources de son instrument, la fin du premier acte est admirable pour la limpidité et la précision de la colorature. Mais au-delà de tout cela, le plus remarquable dans cette Violetta est de voir à quel point le soprano, conscient des multiples facettes de son personnage, a su lui donner la dose nécessaire (mais pas plus que la dose nécessaire, car elle reste consciente qu'il s'agit d'une œuvre de 1853 et non de 1890) de drame et même de mélodrame, puisqu'il s'agit d'un mélodrame, jouant avec les ombres d'un instrument dont on dirait qu'il a gagné en consistance, qui (contrairement à la trop virginale Pretty Yende au Palais Garnier l'automne dernier) possède l'indéfinissable et tant désirée lacrima nella voce ((larme dans la voix)), qui sait raconter et transmettre par le chant bien plus que le texte ne le dit simplement. Dans une certaine mesure, il est contradictoire qu'une interprétation d'une telle délicatesse, d'un tel équilibre et d'une telle perfection formelle finisse par déclencher, dans la représentation du 28, la réaction excessive par excellence de l’air bissé, mais d'un autre côté, il est absolument conforme au caractère apollinien et à la personnalité de la chanteuse que ce bis ne soit pas à proprement parler un bis, mais plus simplement la deuxième strophe de l'Addio del passato, qui n'avait pas été proposée dans les autres représentations de cette série post-confinement du Teatro Real. Pour ce bis et surtout pour nous sortir de l'erreur qu'est la vie sans musique, Nietzsche dixit, on se souviendra de cette Traviata.